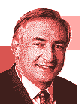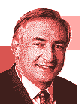| | Un jour où on lui demandait de citer un grand personnage historique qui ait marqué le destin du pays, l'historien Lucien Febvre, qui a longtemps enseigné ici-même en Sorbonne, a répondu : " l'Ecole primaire ". Un demi-siècle plus tard, l'école est encore au cœur de nos préoccupations mais le moins qu'on puisse dire est que le lyrisme n'est plus de mise. Du temps de Lucien Febvre, on citait les Lumières, on rappelait la longue œuvre d'émancipation qui avait conduit de la Révolution à la Troisième République. L'école, c'était le creuset de la nation, la fabrique du citoyen, la forge de la liberté, bref, pour citer Jaurès, " le vestibule des temps nouveaux ". Aujourd'hui, ces discours sonnent faux, ils rendent un son fêlé. Ils ne sont pas moins vrais qu'avant mais nous sommes moins prêts à les entendre. Ils s'effacent devant la réalité d'un malaise que tout le monde ressent. L'école, aujourd'hui, est l'objet d'une inquiétude générale. Elle est une souffrance pour tous, pour les élèves qui y échouent comme pour les enseignants qui y travaillent, pour ceux qui en sont exclus comme pour ceux qui redoutent de l'être, pour les couches populaires qui ont cessé d'y croire comme pour les classes moyennes qui ont cessé d'y gagner. Aux uns, la frustration des espoirs déçus ; aux autres, la peur du déclassement ; pour tous, une compétition sociale toujours plus serrée, un succès toujours plus incertain et puis surtout, le grand paradoxe : le diplôme est de plus en plus nécessaire, mais l'emploi est de moins en moins garanti. Ce malaise renvoie d'abord à un problème d'efficacité et à l'inquiétude que beaucoup partagent face à la récente perte de vitesse de notre système éducatif. Il nous faut affronter la mondialisation, et nous avons le sentiment d'être moins bien armés pour le faire. L'économie de la connaissance est à l'ordre du jour, avec, comme crainte, l'emploi, et comme enjeu, l'innovation. Face à des pays dont la main d'œuvre coûte dix fois moins que la nôtre, nous n'avons aucune chance de gagner si nous nous battons sur le terrain de la réduction des coûts salariaux, sur le terrain de la main d'œuvre peu qualifiée. Pour sortir de la compétition internationale par le haut, il faut miser sur la formation, il nous faut plus de diplômés, dans tous les domaines, il nous faut surtout développer des compétences et des qualifications que les autres n'ont pas. Or, après avoir beaucoup progressé, la place de la France dans cette compétition offre depuis quelques années moins de certitudes. 150 000 jeunes sortent chaque année du système sans diplôme. Le niveau scolaire des Français et des Allemands à 15 ans a été récemment rattrapé par des pays comme le Royaume-Uni ou les Etats-Unis, que nous avons longtemps crus incapables de rivaliser avec notre enseignement primaire et secondaire. L'accès d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat piétine alors qu'il avait doublé. Enfin, seulement 25 % d'une génération française sort diplômée du supérieur contre 37 % aux Etats-Unis et 80 % en Corée. Pire, pour la première fois depuis la Libération, le nombre de jeunes diplômés s'est mis à diminuer. Même pour les diplômés du supérieur, la situation est insatisfaisante : dans la compétition internationale, nos universités ont du mal à rivaliser avec leurs riches homologues étrangères, américaines notamment. A ce phénomène, il y a évidemment plusieurs explications, mais si nous avons choisi aujourd'hui d'aborder la question des inégalités à l'école, c'est que nous avons la conviction qu'on ne peut pas dissocier l'efficacité et la justice. L'élévation du niveau d'instruction a toujours puisé sa force dans l'ouverture numérique et sociologique du système. Le progrès des études est toujours allé de pair avec celui de la démocratisation. Et si depuis le milieu des années 90, les signes ne manquent pas qui indiquent que notre système ne progresse plus, ni en efficacité, ni en justice, ce n'est pas non plus un hasard. Les deux vont de pair. L'efficacité et la justice doivent être les deux fronts d'un même combat, les deux ressorts d'un même mouvement, celui qui pousse à rejeter le malthusianisme, à rechercher les talents partout où ils se trouvent, à ne pas se priver de capacités indispensables au pays. On ne gagnera pas le pari de l'efficacité sans gagner aussi celui de la justice. Voilà pourquoi la question des inégalités à l'école doit être au cœur de notre action. Or le constat, quel est-il ? C'est que notre système vit encore dans un décalage permanent entre un discours résolument égalitaire et une réalité qui l'est beaucoup moins. Le discours, la volonté, héritée des pères fondateurs, c'est d'assurer une éducation à tous les individus, de leur fournir les instruments de leur liberté, de leur attachement à la République, mais aussi de leur ascension sociale. Inutile de dire que nous sommes tous un peu les enfants de cette volonté-là. Le problème est que cette volonté est souvent devenue une croyance et qu'elle a longtemps fait oublier que l'école était aussi le lieu qui consacre les inégalités de départ, qui disqualifie certaines classes populaires, qui les pousse, parfois, à s'éliminer d'elles-mêmes de la compétition scolaire, qui distingue, enfin, et couronne une élite dont la base de recrutement est, si l'on n'y prend garde, presque naturellement portée à se rétrécir. Cette croyance dans le discours égalitaire de l'école, beaucoup de socialistes ont été portés à la dénoncer comme héritiers du marxisme, sans cesser d'y adhérer comme fils des républicains. Enfants de Jules Ferry qui ne pourraient pas oublier Bourdieu, nous sommes au moins sensibles à une chose, c'est que cette tendance ne date pas d'hier, c'est qu'elle marque l'histoire de tous nos efforts. Le combat pour l'égalité d'accès à l'enseignement a été long, les proclamations plus nombreuses que les avancées. On cite souvent Jules Ferry, cette idole intouchable qui disait vouloir éliminer " la plus redoutable des inégalités de la naissance, l'inégalité de l'éducation ", mais on oublie que, pendant longtemps, ses réformes ont surtout consacré un cloisonnement étanche entre l'école primaire d'une part, école du peuple qui avait ses propres débouchés, et l'enseignement secondaire d'autre part, ce " tout-puissant du milieu ", chasse gardée de la bonne bourgeoisie, avec ses classes payantes, son encadrement napoléonien et sa pédagogie héritée des Jésuites du Grand siècle. Il a fallu au total quatre-vingts ans pour faire sauter le verrou inégalitaire qui barrait la route vers les collèges et les lycées. Et si la démocratisation des dernières années - ce que Louis Chauvel a appelé " la seconde explosion scolaire " - a marqué un grand progrès, elle n'a pas fondamentalement enrayé les mécanismes de reproduction des privilèges. Très tôt, dans l'enseignement, se confirment et s'accumulent les discriminations. Trop tôt les jeux sont faits. Une fois pour toutes. Ils sont des millions qui n'en sortiront plus. C'est la sélection par l'échec, sans rattrapage possible. Le plus formidable gaspillage se trouve ainsi consacré et institutionnalisé. La démocratisation de l'enseignement reste encore trop souvent un mot ; la mobilité sociale une exception. *
* *
1. L'école ne parvient plus à endiguer la montée des inégalités
La démocratisation de l'école : une réussite historique
Le paradoxe, c'est qu'il aura fallu vingt ans d'efforts et de progrès pour que les Français s'en rendent compte. Car, c'est vrai, notre système éducatif a relevé depuis vingt ans des défis immenses, il a dû faire face à une véritable explosion, et l'inachèvement de la tâche accomplie ne doit pas nous faire oublier la part très largement positive de ce bilan. En 10 ans, de 1987 à 1997, l'âge moyen de fin d'études a été accru de 3 ans, pendant que le taux de bacheliers doublait de 30 % à 63 %. Former et recruter des enseignants, construire de nouveaux établissements, mobiliser des moyens matériels qui furent longtemps insuffisants, et parfois dérisoires, abolir les cloisonnements et les restrictions qui régnaient partout, ont été des missions qui ont exigé un effort considérable (quelques grandes lois et 20 % du budget de l'Etat), effort que les gouvernements de gauche ont consenti et initié beaucoup plus facilement que les gouvernements de droite (on se souvient de 1986). L'ensemble du défi a été relevé sans que le niveau et la qualité des enseignements ne baissent : c'est un indice de plus que l'objectif d'une éducation pour tous a été poursuivi et en grande partie atteint. Il y a là un principe qui n'a jamais prêté à discussion dans nos rangs et il n'est pas besoin de détailler longuement la part que les gouvernements de gauche, y compris celui de Lionel Jospin, ont eu dans le résultat final.
Depuis le milieu des années 90, la démocratisation s'est enrayée : les inégalités se reconstituent
Après un tel effort et un tel choc, on aurait pu croire que la pause dans la croissance des effectifs aurait permis à un système scolaire très sollicité de reprendre son souffle et de progresser dans le sens d'une démocratisation qualitative du système. Force est de constater qu'il n'en a rien été. Notre système scolaire semble aujourd'hui en panne. La dynamique de la démocratisation s'est épuisée. C'est d'abord le pari de l'égalité scolaire qui est en train d'être perdu. L'école exclut toujours mais au lieu de rejeter massivement hors du système les moins favorisés, ou de leur en interdire l'accès, elle les retient dans des filières plus ou moins dévalorisées. Les deux tiers des enfants d'ouvriers sont en retard à l'issue du collège contre 10 % des enfants de cadres. Et non content de reléguer ces jeunes, notre système éducatif en élimine encore beaucoup d'autres, mais cette fois au-delà du baccalauréat. " Tout se passe comme si l'élimination des plus défavorisés n'avait été que différée dans le temps ", ai-je entendu. L'école force ces jeunes à étouffer en eux-mêmes les espérances qu'elle leur a elle-même inspirées. Autrefois l'échec, c'était d'interrompre sa scolarité. Aujourd'hui, c'est aussi de poursuivre une scolarité dont on sait qu'on ne peut rien en attendre d'immédiat. On continue sans conviction, et souvent avec amertume. L'inégale longueur des formations est donc un fait. Les différences entre des filières de prestige très inégal en sont un autre. Les familles les mieux dotées ont notamment réagi à la démocratisation de l'université en se réfugiant dans les filières les plus prestigieuses. L'assise sociale des grandes écoles est alors redevenue aussi étroite qu'au début du siècle. Polytechnique comptait 21 % d'élèves issus de milieux modestes dans les années 50, contre 7 % aujourd'hui, et la rue d'Ulm, qui recrutait un quart de ses élèves dans les couches populaires, a renoncé depuis plusieurs années à publier ses chiffres.
La grande désillusion : la promotion sociale en panneAinsi ont été réunies, une à une, les conditions de toutes les frustrations et de tous les mécontentements, de la part de tous les acteurs et au gré d'arguments, parfois contradictoires, mais qui tous convergent dans une critique du système éducatif, critique parfois injuste mais qu'il faut comprendre. On a vu l'hostilité croissante d'une partie des jeunes et de leurs familles à l'égard de l'institution scolaire. Les enseignants, eux non plus, ne sont pas en reste. Illettrisme, violences et incivilités, absentéisme, problèmes d'intégration, mauvais rapports entre les parents, les enseignants et les élèves. Longtemps, l'Ecole s'est voulue un lieu presque utopique où venaient se briser les rumeurs du monde et se dissoudre les inégalités. Avec la massification de l'enseignement, au contraire, les problèmes de la société sont entrés dans l'Ecole. Les réalités sociales ont été mises à l'ordre du jour, et notre système éducatif ne peut plus continuer à fonctionner en vase clos et à faire comme si chacun abandonnait ses problèmes sur le seuil de la classe. On peut regretter cette évolution mais l'ignorer, comme nous le proposent certains, c'est vouloir trouver refuge dans un monde de fiction. Dans ce concert de frustrations, il ne faut bien entendu pas oublier les parents. Beaucoup d'entre eux ont souvent l'impression d'être floués par le système. Il existe de fait un marché de l'éducation entre et à l'intérieur des établissements, et le moins que l'on puisse dire est que ce marché est fondamentalement injuste. Seule une minorité de familles privilégiées en connaît les règles et la lutte est souvent inégale dans cette nouvelle forme de compétition scolaire. Aujourd'hui, l'opposition ne se situe plus tant entre les écoles publiques et les écoles privées mais entre les établissements scolaires qui permettront de continuer des études supérieures dans de bonnes conditions et les autres. Ne nous y trompons pas : l'entre-soi a toujours été une règle de vie pour les classes privilégiées. C'était hier la manifestation d'une ségrégation sociale pré-existante ; c'est désormais une condition impérative de réussite sociale. A ce titre, l'acharnement et l'inventivité déployés par certains parents pour échapper aux rigueurs de la carte scolaire n'ont pas fini de nous étonner. En matière de stratégie scolaire, comme en matière de choix de résidence, les avantages se cumulent et les inégalités se redoublent. La longue marche de la démocratisation scolaire laisse donc aujourd'hui derrière elle un paysage bouleversé et contrasté. On a parlé de désillusion, de désenchantement, de ressentiment à l'égard de l'école, de frustrations évidentes, de révolte larvée, de génération abusée. Au fond, à chaque fois qu'un grand verrou inégalitaire est forcé, on se rend compte, dix ans plus tard, qu'il ne suffit pas d'offrir la même éducation à tous pour abolir les inégalités devant l'éducation, qu'il ne suffit pas d'accéder à une filière pour y réussir, et qu'il ne suffit pas d'y réussir pour accéder à un poste correspondant dans la vie professionnelle. Il en a été ainsi à chaque fois jusqu'à aujourd'hui. Il en est de même cette fois-ci encore. Le malaise actuel est seulement d'autant plus profond que les espérances ont été immenses. Dans ces moments où le souffle du progrès semble retomber, la tentation du renoncement et le sentiment de l'impuissance sont toujours proches. A première vue, tout nous prouve que nous ne pouvons rien, tout prouve que nous ne changeons rien. La gauche, dans son histoire, mais aussi tous ceux qui ont mis dans l'éducation un peu de leur utopie, n'ont jamais eu rien d'autre à vaincre que ces preuves-là. Pour la droite, la tentation est grande du retour en arrière. Cet égalitarisme éducatif serait inutile : il y a des inégalités naturelles, il serait vain de chercher à s'y opposer. Casser le collège unique, réintroduire les filières dès la seconde, proposer des options discriminantes dès le collège - telles sont les pistes que l'on voit poindre. Ce serait faire un bond en arrière de plus de 30 ans. Dans un contexte de compétition économique internationale sans cesse plus accrue, renoncer à former plus de diplômés est une grave erreur. Nous sommes obligés de continuer l'œuvre entamée depuis les années 60 : démocratiser le système pour permettre au plus grand nombre d'obtenir des diplômes élevés. Aujourd'hui plus que jamais, les socialistes doivent continuer ce combat de l'égalité à l'école. Il faut trouver de nouveaux moyens, plus efficaces, pour continuer à lutter contre les inégalités liées à la naissance. L'école ne peut pas tout, c'est dit. Sa tâche est même chaque jour rendue plus difficile parce qu'elle doit supporter les conséquences sociales d'évolutions économiques qui lui échappent. Son rôle dans la promotion sociale, ou dans la reproduction des privilèges, n'a cependant pas diminué. Elle détermine toujours autant les destins individuels, ne serait-ce que sur un marché du travail toujours plus exigeant sur le niveau de formation initiale. Voilà pourquoi elle doit trouver sa place dans un plan plus global de lutte contre les inégalités. *
* *
2. Quelles propositions pour réformer l'école ?
Comment rendre l'école plus juste ?
Changer de paradigme : vers l'égalité réelle à l'école
La lutte contre les inégalités, j'en ai la conviction, est le grand chantier pour la gauche de demain. Refuser une France en miettes, offrir aux Français un projet assurant la cohésion d'une société qui se défait sous nos yeux : c'est le défi que nous aurons à relever pour les années qui viennent et sur lequel les Français jugeront la politique. La France, comme tous les pays occidentaux, vit un retour de la machine inégalitaire. Dopées par un capitalisme nouveau plus agressif, renforcées par un gouvernement qui s'acharne à démanteler un à un les garde-fous de l'Etat-providence, les inégalités de revenus recommencent à se creuser, alors qu'elles avaient longtemps diminué. Au-delà, de nouvelles inégalités se font jour, plus inquiétantes encore, les inégalités de destin. Ce sont toujours les mêmes qui réussissent, toujours les mêmes qui échouent : c'est le constat que nous ressentons tous. Le diagnostic que je partage avec les intervenants de la première table ronde est que cette immobilité sociale a pour origine des inégalités de départ que notre société transforme en inégalités de destin. Selon qu'il naît à Neuilly, Montrouge ou Vaux-en-Velin, un enfant bénéficiera ou non d'un entourage porteur, d'un environnement urbain favorable et de toutes les conditions qui, jour après jour, décident du succès d'un individu. Dans les travaux qu'il nous a présentés aujourd'hui, Eric Maurin a démontré que ces inégalités de départ influencent directement les capacités scolaires des enfants. Les enfants des cités ont une culture spécifique qui les rend moins adaptés à l'apprentissage scolaire. Ils sont aussi limités par un état sanitaire moins favorable : il y a chez eux 30 % de naissances prématurées ou de faible poids en plus, 30 % de problèmes de vision non détectés en plus, deux fois plus de problèmes dentaires et d'obésité. Les conditions de logement ont également un effet direct sur les résultats scolaires : 66 % de ceux qui n'ont pas une chambre isolée pour travailler sont en retard scolaire, contre 33 % pour ceux qui en bénéficient. Or la plupart des familles des quartiers populaires souffrent de logements surpeuplés. Les conditions financières, enfin, sont fondamentales pour la poursuite des études : en l'absence de ressources suffisantes, les jeunes défavorisés abandonnent les études pour la vie active. Face à ce retour des inégalités, il faut renforcer notre Etat-providence pour lui permettre de mieux redistribuer les richesses. Mais cela ne suffira pas. L'Etat-providence corrige après coup les inégalités que le marché reproduit et aggrave. Une fois que le marché a fait son œuvre, les pouvoirs publics interviennent pour atténuer des inégalités insupportables. Mais cette volonté d'aider ceux qui en ont le plus besoin, nous l'ignorons largement pour tout ce qui se déroule en amont du marché, avant que les richesses ne soient produites et que les destins ne soient fixés. Là, alors que tous ne partent pas dans la vie avec les mêmes chances, la puissance publique se contente encore trop souvent d'offrir à tous des moyens plus ou moins identiques. Elle ne propose qu'une égalité formelle. Comment s'étonner, dès lors, que certains enfants aient plusieurs générations d'avance ? Tendre vers une égalité réelle, au contraire, c'est combattre les inégalités à la racine, là où elles se créent, c'est renouer avec une des premières intuitions du socialisme. Il faut compléter la logique de l'Etat-providence par une logique de correction en amont des inégalités, concentrer les interventions sur ceux qui en ont le plus besoin, donner plus de capital public à ceux qui ont moins de capital social. C'est ce que j'appelle le " socialise de l'émancipation ". La méthode, c'est la concentration des moyens publics. L'instrument, c'est le service public. Car la correction ne peut pas être uniquement financière ; elle doit aussi fournir les moyens humains et culturels de réussir. Il faut pouvoir donner à tous les moyens de sa promotion sociale et pas seulement garantir à tous un filet de sécurité en cas d'échec. Si la santé, le logement et la politique de la ville doivent évoluer dans cette direction, l'éducation doit être le terrain privilégié de cette démarche. Pour gagner la bataille de l'égalité réelle, je propose trois priorités. 1ère priorité : concentrer les moyens à l'écoleCe qu'il faut c'est donner plus à ceux qui en ont le plus besoin. Pour mettre ce principe en œuvre, les solutions du type " discriminations positives à l'américaine ", sur des bases ethniques ou religieuses, doivent être écartées. Elles sont contraires à notre tradition républicaine. Elles stigmatisent les populations concernées. Elles engendrent des frustrations dans la population. En première approximation, l'approche territoriale est une bonne approche, car les inégalités se cristallisent d'abord sur les territoires. Les zones d'éducation prioritaires (ZEP) constituent dès lors un bon instrument. Leur impact actuel, c'est vrai, a été amoindri par le saupoudrage auquel il a fini par donner lieu : le classement en ZEP donne lieu à seulement 10 % de ressources supplémentaires contre 100 % aux Pays-Bas. Il revient à n'alléger les classes que de deux élèves, si bien qu'au total, ce sont souvent les effets dits de stigmatisation qui l'emportent : le label ZEP est mal perçu, une zone qu'on classe en ZEP est une zone dont la réputation devient suspecte. C'est le signal de la fuite pour ceux qui le peuvent. Ce que je propose, c'est non pas d'étendre le nombre de ZEP et d'enfants aidés mais de permettre au système d'évoluer par approfondissement et accroissement de l'effort sur les zones où se concentrent réellement les difficultés. L'idéal consisterait à faire en sorte que le label ZEP ne soit plus stigmatisant, mais devienne au contraire un signe de dynamisme. Pour réaliser cet objectif, il faut s'en donner les moyens, il faut " ajouter un deuxième étage à la fusée ", et permettre à certaines ZEP de bénéficier d'un dispositif supplémentaire que l'on pourrait par exemple concevoir sur le modèle des EAZ britanniques. Il s'agirait d'un dispositif d'éducation compensatoire, beaucoup plus concentré géographiquement que les 800 ZEP qui totalisent aujourd'hui 20 % des élèves. Ce surcroît d'efforts financiers pourrait notamment s'attacher à réduire la taille des classes. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, Thomas Piketty l'a montré dans une récente étude : la réduction des effectifs d'une classe entraîne une amélioration très importante des performances des élèves. Ainsi, imposer des tailles de classes de 18 élèves en ZEP plutôt que 22, comme c'est le cas actuellement, permettrait de diminuer de 40 % l'écart de performances au CE2 entre élèves de ZEP et hors ZEP. Au delà, cet effort financier pourrait permettre de revaloriser les ZEP en accordant à leurs enseignants des primes plus importantes. Les incitations financières y sont aujourd'hui, en effet, insuffisantes. Par ailleurs, le turn-over y est trop important. Un avantage de carrière plus net pourrait être accorder à ceux qui restent suffisamment longtemps dans les ZEP. Mais le ciblage territorial demeure une approximation d'une réelle politique individuelle. Si un enfant a besoin de 30 heures pour assimiler son cours de mathématiques, au lieu des 20 théoriquement prévues au programme, l'école doit être capable de les lui fournir – quelles que soient ses origines ethniques, religieuses ou géographiques. On construit ainsi un " droit de tirage social ", fondé sur une différenciation légitime, car purement individuelle, et non ethnique, religieuse ou territoriale. C'est un des moyens d'aller au-delà du collège unique. Cette logique avait connu un début d'application sous le gouvernement de Lionel Jospin deux heures supplémentaires de cours de français et de mathématiques étaient réservées aux élèves en retard pour permettre leur rattrapage. Dans cet esprit, je propose de créer un poste d'" instituteur volant " dans les petites classes, et en priorité en CP . Non affecté à une classe, il serait chargé de donner du temps pédagogique supplémentaire aux enfants en difficulté d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Dans la même logique, je suggère que l'on étende l'expérience de la " terminale difficile " mise en place à Paris. Un lycée a en effet créé à la fin des années 1980 une terminale scientifique, réservée aux élèves en rupture scolaire rejetés de tous les autres lycées. Cette expérience a permis une véritable concentration des moyens associée à l'obligation de rester en internat. Le résultat est parlant : à l'arrivée, il y a eu 100 % de réussite au bac. Autant le busing américain s'est avéré inefficace, car il instaure une mixité sociale superficielle, les élèves favorisés et les élèves défavorisés coexistant sans vraiment se mélanger ; autant une politique volontariste d'internat pourrait être pertinente : elle conduit les élèves de banlieue à sortir d'un milieu socio-urbain défavorable, et permet une concentration à leur profit des meilleurs moyens éducatifs. Enfin, nous savons que l'activité après l'école, le mercredi, a un rôle important. Or ces activités ne sont pas réalisées dans de bonnes conditions dans toutes les familles. Pour compenser ces défaillances, un grand plan périscolaire pourrait combiner aides aux devoirs, activités sportives et éveil culturel, en coopération avec les collectivités territoriales, les mouvements d'éducation populaire.
2ème priorité : investir, à l'entrée du système éducatif, dans la petite enfanceConcentrer les moyens sur ceux qui en ont le plus besoin ne suffit cependant pas. Il faut aussi lutter contre les inégalités en amont et à la sortie de l'Ecole. On demande aujourd'hui à l'Ecole de s'occuper et d'être attentif à ce qui se passe en-dehors de ses murs, mais il appartient à l'Etat de s'intéresser à ce qui se passe avant et après. Voilà pourquoi il faut s'attaquer au grand trou noir de nos politiques pédagogiques, la petite enfance, et au point faible actuel de notre système, l'enseignement supérieur. Investir en amont, " investir dans les bébés ", pour soutenir les enfants dès le plus jeune âge est une nécessité parce que les inégalités sont massives à cet âge, entre les enfants sollicités activement par leurs parents et ceux qu'on abandonne à la télévision. Or, Gosta Esping Andersen l'a montré : la capacité à apprendre suppose un " capital cognitif " qui s'acquiert principalement entre 0 et 6 ans. Investir en amont, c'est aussi empêcher que la pauvreté des parents n'affecte leurs enfants, parfois avant même la naissance. La pauvreté expose les mères à mettre au monde un enfant prématuré ou de faible poids, c'est-à-dire un enfant beaucoup plus fragile que les autres et beaucoup plus exposé à des problèmes cognitifs. C'est pourquoi il faut faire émerger un grand service public de la petite enfance, couvrant la généralisation des crèches, les gardes d'enfant, le suivi médical et psychologique, la lutte contre la pauvreté infantile. Aujourd'hui, ces politiques sont parcellaires, éparpillées dans un faisceau d'institutions et de politiques particulières (CAF des partenaires sociaux, la Protection Maternelle et Infantile des conseils généraux, crèches municipales, aides financières de l'Etat). Pour que ces politiques puissent monter en puissance efficacement, il faudra les coordonner et les intégrer dans un grand service public. Un tel modèle a été mis en place avec succès au Danemark et en Suède. C'est loin d'être le cas aujourd'hui en France, tant dans les grandes villes que dans les campagnes.
3ème priorité : investir massivement dans l'enseignement supérieurC'est un point qui demanderait de longs développements. Je me bornerai aujourd'hui à rappeler que nous consacrons beaucoup plus à l'école primaire et secondaire que la plupart des autres pays (et notamment que les Etats-Unis), mais beaucoup moins à l'enseignement supérieur. De tels choix permettent de comprendre la difficulté qu'ont nos universités à rivaliser avec leurs concurrentes, américaines notamment. Rappelons que les Etats-Unis comptent 50 % d'universitaires en plus que la moyenne européenne. L'écart entre les efforts financiers est patent : les Etats-Unis investissent 3 % de leur richesse dans l'université contre 1.4 % en Europe, la France ajoutant à cela une forte préférence pour les Grandes Ecoles. Même le financement public est supérieur aux Etats-Unis : 1,4 % contre 1,1 % du PIB. La France doit donc investir massivement dans ses universités. Or, il faut le dire parce que c'est vrai, négliger l'université a des conséquences non seulement sur la place de la France dans la compétition internationale, mais aussi sur l'ensemble de notre système et sur la façon dont s'organise, en son sein, la compétition entre les élèves de différents milieux. Laisser notre enseignement supérieur vivoter dans la pénurie financière, se perpétuer dans ses habitudes de classe et de cloisonnement, c'est laisser des filières comme le droit, les sciences, les Grandes Ecoles, rester la chasse gardée des plus favorisés, c'est favoriser la compétition en amont dans les établissements qui garantissent l'accès à ces filières. La compétition scolaire et résidentielle pour les meilleurs lycées et les meilleures filières supérieures est une réalité qui mine l'école et le collège de l'intérieur. Elle ne sera pas désamorcée tant que l'enseignement supérieur restera une institution aussi cloisonnée, où chaque inflexion de trajectoire est aussi un irréversible déclassement social. Nous n'aurons pas fini de démocratiser le baccalauréat tant que nous n'aurons pas démocratisé toutes les filières de l'enseignement supérieur.
Enfin, trois condition de succès : les enseignants, le budget, l'inscription dans un plan global de lutte contre les inégalités Petite enfance, école, université : les chantiers sont vastes. Pour aboutir, ils doivent respecter trois conditions de méthode. Réformer avec les enseignantsTout d'abord, la réforme doit obtenir le concours de ceux qui ont à l'appliquer. Je suis enseignant de profession et je n'ai jamais cessé d'enseigner, sauf pendant les périodes où j'étais membre du gouvernement. Cette année encore, je retrouverai chaque semaine mes étudiants. Je sais les efforts entrepris par les enseignants pour moderniser leur métier, adapter leurs matières, prendre en compte les mutations de la société. J'affirme que ces efforts ont payé, même si les évolutions sociales obligent à les renouveler encore. C'est un truisme que de le dire : aucune réforme n'a de chance de réussir sans un minimum d'empathie avec le travail de ceux qu'elle concerne le plus directement. Cela, tout le monde le sait, tout le monde en parle et s'accommode très bien de ne pas en tirer les conséquences. Or le paradoxe est bien là. Plus les projets s'accumulent et moins cela marche ; plus nombreuses sont les réformes et plus les enseignants perdent confiance ; plus la modernisation est à l'ordre du jour et plus les professeurs se sentent incompris, tant les initiatives qui leur parviennent du ministère leur semblent ignorer les efforts qu'ils ont déjà fournis et les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Les conditions d'un cercle infernal sont alors réunies, qui mine à l'avance la plupart des espoirs de coopération entre les enseignants et leur administration. Ces réformes engendrent souvent des réactions de méfiance et de suspicion qui accréditent dans l'opinion l'image d'un immobilisme du monde enseignant, ce qui renforce en retour ces derniers dans une attitude défensive. Vision d'autant plus injuste que bien peu de métiers ont autant évolué que ceux de l'enseignement. Le cours participatif est devenu la norme ; la motivation de l'élève est sans cesse prise en compte ; l'univers enseignant s'est élargi à des considérations éducatives et de nombreuses innovations sont apparues à l'échelle de la classe ou de l'établissement…parfois contre des hiérarchies réticentes. A la réflexion, je crois que si ça ne marche pas, c'est qu'aux aspirations légitimes des enseignants, aucune réponse n'est apportée et que si aucune réponse n'est apportée autre qu'abstraite et gestionnaire, c'est que les données les plus élémentaires de la condition enseignante ont été beaucoup trop sous-estimées. Ce métier s'est toujours distingué par la liberté de l'esprit qu'il procurait et par la liberté d'organisation du temps qui en est le corollaire. Or, sans aucune contrepartie, les nouvelles réformes ont eu tendance à assigner aux enseignants des tâches périphériques relatives à l'orientation ou à la vie de l'établissement. Plus fondamentalement encore, - et je rejoins là les remarquables conclusions d'Anne Barrère, dans son ouvrage Les enseignants au travail - les réformes n'ont pas assez tenu compte du problème central de la classe. Au cœur de la façon dont les enseignants vivent leur métier, quel que soit le type d'établissement dans lequel ils travaillent, se trouve la satisfaction ou la pénibilité avec laquelle chacun parvient à gérer sa classe. Enseigner, c'est d'abord gérer un composé des humeurs des uns et des autres, d'événements externes, des dynamiques de groupes, des " réticences " diverses et cumulées. Au cœur de ces conditions de travail, il y a alors une véritable cyclothymie qui n'est jamais complètement maîtrisable. Certains jours, nous avons cette joie si vive pour un professeur de ne voir pendant une heure que des visages attentifs et intéressés, de terminer au milieu de signes d'approbation et de satisfaction - ces jours-là, on pense sincèrement que ce métier est le plus beau du monde. D'autres jours, on le maudit et on a l'impression de gâcher son temps et son énergie. Cela, les enseignants l'ont tous vécu. C'est même la matière essentielle de leur vie professionnelle. Or, comment expliquer que des réformes qui supposent la collaboration étroite des enseignants ignorent si souvent ces conditions de base ? Comment expliquer que les solutions proposées soient si rarement au cœur des préoccupations enseignantes ? Réussir une réforme de l'école, c'est tenir compte de ces réactions, et de ce qu'elles cachent. Elles sont avant tout des réactions de défense professionnelle face au problème immédiat et central de la gestion de classe. Ainsi, une question pertinente politiquement est de se demander comment les enseignants peuvent gagner à une réforme. Les exemples de réussite ne manquent pas dont il faudrait s'inspirer : quand ils relient les propositions de réforme et leurs problèmes quotidiens, les enseignants s'approprient ces propositions. C'est le cas avec les TPE, avec les réductions d'effectifs en classe et plus généralement avec tous les projets qui permettent une amélioration de la relation avec la classe. Sur tous ces points, il faut établir un lien clair entre les objectifs de la réforme et ses incidences dans la classe, partir de la classe parce que c'est là que se réunissent les conditions du succès. Je mentionnerai enfin un autre élément. Revaloriser les conditions quotidiennes de travail entre les élèves et les enseignants n'est pas tout, c'est vrai. La relation aux élèves est une motivation, certes ; elle apparaît même depuis peu comme première cause de satisfaction pour les jeunes enseignants. Mais pour que les enseignants soient plus efficaces, ils doivent aussi éprouver de la satisfaction à enseigner leur matière. Pour motiver les élèves, il faut rester motivé face aux savoirs qu'on enseigne. Le travail enseignant présente ainsi un double aspect: il s'agit d'une part d'un travail avec autrui, pour autrui, d'autre part d'un projet intellectuel pour soi. Une politique de développement professionnel doit en conséquence être capable de jouer sur ces deux tableaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, les politiques de formation ou de mobilité professionnelle offrant des opportunités raréfiées ces dernières années. (suppression du congé mobilité, de bien des stages, ou encore offre exclusive sur des sujets de type violence, évaluation, etc…) Donner la priorité budgétaire à l'écoleAucune réforme ne peut aboutir sans financement suffisant. L'Education nationale doit redevenir la première priorité budgétaire. Notre école souffre à chaque passage de la droite au pouvoir. Comme vient de le montrer Yves Durand, secrétaire national chargé de l'éducation du PS, les établissements scolaires disposeront de près de 70 000 personnels en moins en 2005. L'argent public n'est pas extensible, il faut donc affirmer des priorités politiques : l'école en est une. Inscrire la réforme de l'école dans un plan globale de lutte contre les inégalitésJe le mentionne juste en passant car ce n'est pas le sujet du jour. Mais il est fondamental : aucune réforme éducative ne saurait réussir si elle ne s'inscrit dans un plan plus vaste de lutte contre les inégalités. Ce plan passe par des mesures fiscales de lutte contre la pauvreté infantile, des mesures immobilières visant à la mixité sociale, au développement des grands appartements familiaux, et des mesures sanitaires pour assurer le suivi pédiatrique des enfants les mois favorisés. *
* *
Concentrer les moyens publics sur ceux qui en ont besoin, agir à tous les niveaux du système éducatif de la petite enfance à l'université, veiller à ce que les enseignants gagnent à ces réformes, leur donner la priorité budgétaire, les inscrire dans un plan global : telles sont mes pistes pour l'égalité réelle à l'école. Ces pistes ont naturellement vocation à être versées au débat des socialistes. Elles contribueront, je l'espère, à l'élaboration du programme de la gauche. Un programme que nous devrons marquer du sceau du réformisme radical, si nous souhaitons vraiment qu'une autre France soit possible.
|