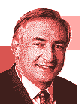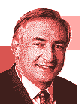| | Michel TaubmannMerci de nous recevoir, nous avons souhaité vous interroger sur quatre grands thèmes : la politique étrangère, la gauche et la social-démocratie, l’économie et l’identité de la France. Pour entrer dans le vif du sujet, et parce que cette question nous préoccupe, déplorez-vous que dans la gauche française ne se manifeste pas, face à l’islamisme radical, le réflexe antifasciste inhérent à sa tradition ? Une tradition qui, par ailleurs, joue pleinement contre le Front national.
Dominique Strauss-KahnCe qui me paraît le plus dangereux dans la montée de l’islamisme, c’est le risque de confusion que cela entraîne dans l’opinion, entre ce qui est l’exercice légitime d’une religion - par les musulmans français notamment - et ce qui est la perversion théologique consistant à instrumentaliser la religion à des fins qui se révèlent politiques, à faire de la religion le bras armé d’une politique. De ce point de vue, la diabolisation de la religion musulmane a tendance à créer l’amalgame. Une fois que l’on a clairement établi que la pratique d’une religion ne relève pas de l’intégrisme, on peut dénoncer la forme extrême que prend la volonté de déstabilisation des sociétés occidentales et le totalitarisme que porte cette version exacerbée de l’islam - d’ailleurs rejetée par la majorité des musulmans eux-mêmes.
Michel TaubmannVous employez l’expression « totalitaire », qui n’est pas utilisée par tout le monde en France pour caractériser, non pas le pays, mais l’idéologie qui domine, par exemple en Iran...
Dominique Strauss-KahnLa politique qui est aujourd’hui conduite en Iran sous la houlette d’Ahmadinejad comporte de nombreuses expressions du totalitarisme qui, en tant que telles, doivent être combattues. À ce propos, c’est pour moi une grave erreur d’avoir prétendu, comme l’ont fait Jacques Chirac et son ministre des Affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy, que l’Iran jouait un « rôle stabilisateur » dans la région. Cela entraîne une confusion sur la nature réelle de ce qu’est le régime iranien actuel. Cela revient à adresser un message erroné à un pays qui use largement de sa capacité de nuisance - on le voit au Liban via le Hezbollah, en Irak ou avec le chantage nucléaire qu’il cherche à exercer. En revanche, il faudra bien engager avec l’Iran une discussion sérieuse - à laquelle les Américains doivent être partie prenante - pour donner à ce pays les garanties de sécurité auxquelles il a droit, sans qu’il acquière l’arme nucléaire, conformément au Traité de non-prolifération (TNP).
Michel TaubmannPourriez-vous qualifier le Hezbollah, comme l’avait fait Lionel Jospin en son temps, d “ organisation terroriste“ ? Dominique Strauss-KahnLionel Jospin a utilisé cette expression à l’université de BirZeit en 2000. La situation est plus compliquée aujourd’hui car le Hezbollah n’est pas seulement une organisation terroriste ; n’oublions pas qu’il participe au gouvernement libanais, et que cette participation constitue sa face légale. Mais c’est aussi une organisation terroriste dont on attend le désarmement par le Liban comme le prévoit la résolution 1559. Ou bien on accepte l’idée que c’est une organisation terroriste, ou bien on considère que c’est une partie du gouvernement libanais. Si le Hezbollah est une composante du gouvernement libanais, le conflit auquel nous venons d’assister, et auquel nous pouvons encore assister demain, devient alors un conflit traditionnel entre deux États. Dans ce cas, il n’y a plus de fondement aux réticences que l’on a pu avoir par rapport aux réactions israéliennes. Nous avions un agresseur qui venait du Nord (le Liban), et qui a illégalement agressé un pays (Israël) se trouvant au sud de sa frontière. Si cet agresseur constitue une partie de l’État libanais, c’est alors le Liban qui attaque l’État d’Israël. Je ne crois évidemment pas que l’on puisse retenir cette interprétation. Il s’agit donc bien d’une organisation terroriste et il faut que les Libanais désarment le Hezbollah. La présence de la Finul renforcée en fournit l’occasion. Ce sera un service rendu à tout le monde : à la démocratie libanaise et à la sécurité d’Israël. Il faut aussi qu’Israël se retire des fermes de Chebaa pour cesser de donner un argument à la prétendue « résistance » du Hezbollah. Et chacun pourra se consacrer à la tâche essentielle dans la région : parvenir à la création d’un État palestinien viable, dans les frontières de 1967.
Michel TaubmannPour revenir à la question : est-ce que vous déplorez qu’une partie de la gauche échange sa tradition antifasciste contre une autre tradition, celle du tiers-mondisme ? Pourquoi avoir tant de facilité à dénoncer le fascisme dans un contexte européen, quand il s’agit par exemple d’un Haider en Autriche, et tant de mal à dénoncer l’Iran, le Hezbollah, à qui l’on trouve perpétuellement des excuses ? Pour le dire encore autrement, est-ce que cela ne vous gêne pas de voir au sein de la gauche, je pense au Parti communiste, à certains militants verts, au MRAP, des gens défiler dans les rues de Paris pour soutenir Hassan Nasrallah ?
Dominique Strauss-KahnJe n’aime pas la confusion des mots, et je n’aime pas utiliser le terme « fasciste » en dehors de son contexte historique. Restons donc sur la notion de « totalitarisme ». Cela ne me gêne pas de considérer le régime iranien, ou d’autres régimes politiques du Moyen-Orient, comme des totalitarismes. En revanche, je crois que l’on ne résout pas les problèmes en se contentant de les caractériser. Il y a, dans ces régimes, les aspects traditionnels du totalitarisme qui peuvent être des pulsions nationalistes enrobées d’aspects religieux, mais ce n’est pas le seul terreau qui nourrit l’oppression. La démocratie comme antidote est certes à encourager, mais la démocratie, à elle seule, ne suffit pas. Les problèmes de développement, par exemple, sont des facteurs que l’on doit tout autant prendre en considération. Il est d’ailleurs intéressant de constater que la seule zone du monde, depuis ces quarante dernières années, à ne pas s’être développée, c’est précisément la zone Moyen-Orient/pays arabes, et cela malgré la manne pétrolière. Le maintien de ces populations dans un état de faible développement - volontaire, disent certains - est une composante qui nourrit fortement la fragilité de ces populations. À cela s’ajoutent évidemment des facteurs politiques déstabilisateurs, comme l’absence de règlement de la question palestinienne ou les ambitions de puissance de l’Iran - qui ne datent pas de 1979. Ce sont toutes ces dimensions que l’administration Bush sous-estime en n’agissant qu’à travers le prisme de la lutte - au demeurant indispensable - contre le terrorisme islamiste. Pour en revenir à votre question sur le malaise à gauche, je constate que le débat est le même que sur l’antisémitisme. On est habitué en France à un antisémitisme de droite et d’extrême droite. Or on est obligé de reconnaître aujourd’hui qu’il existe un antisémitisme d’extrême gauche. Je le reconnais et je le dénonce. Et ce n’est pas parce qu’il vient de la gauche qu’il ne doit pas être dénoncé. Ce n’est pas parce que des mouvements totalitaires se développent en dehors de l’Occident que l’on doit renoncer à les caractériser comme des mouvements totalitaires. D’ailleurs, la partie de la gauche à laquelle vous faites allusion n’a jamais pris autant de gants pour dénoncer certains gouvernements tout aussi totalitaires en Afrique noire. Soyons clairs : tous les totalitarismes doivent être dénoncés. Mais on ne résume pas la question de l’islamisme extrême en le caractérisant comme un totalitarisme.
Élie CohenAu début de la guerre du Liban, après l’affaire de Cana, la troïka européenne a fait cette déclaration : « Rien ne peut justifier la mort d’un enfant. » Est-ce que l’Europe politique peut se construire sur une proposition de ce type ?
Dominique Strauss-KahnC’est une formule que j’approuve comme individu, comme humaniste, comme père de famille. Mais c’est une formule que je récuse comme responsable politique.
Michel TaubmannIl existe en France un consensus droite/gauche sur les questions internationales, et pas seulement depuis le début du mandat de Jacques Chirac. En quoi vous distinguez-vous de ce consensus, notamment sur les options prises ces dernières années concernant un positionnement hostile aux États-Unis, et notamment au moment de la guerre d’Irak ?
Dominique Strauss-KahnIl existe - et c’est heureux ! - un consensus sur les objectifs, la paix et le développement, ainsi que sur le multilatéralisme. Pour le reste, si consensus il y a, c’est sur une absence de position ! À droite comme à gauche, la faiblesse française en matière de politique étrangère se cache derrière des formules magiques répétées mécaniquement mais dont la justesse et l’efficacité mériteraient pour le moins d’être réévaluées. Exemple ? L’antiaméricanisme que peut partager aussi bien la gauche que la droite gaulliste... Sur cette question, ma ligne pourrait se résumer ainsi : « Ni Chirac ni Blair. » Ni l’arrogance stérile de Jacques Chirac, ni le suivisme de Tony Blair. Je crois que nous avons avec les États-Unis des valeurs à partager autant que des intérêts communs. Nous avons des deux côtés de l’Atlantique le plus grand intérêt à avoir un partenaire - avec lequel il s’agit d’être vigilant, avec lequel il convient d’être exigeant et duquel on ne doit pas tout accepter, mais un partenaire quand même. L’attitude qui consiste à dire systématiquement que, pour être sûr de ne pas se tromper sur tel ou tel sujet, on doit prendre la position inverse de celle des États-Unis, me paraît pour le moins superficielle et contre-productive. Si c’est cela le consensus que vous évoquez, c’est un consensus en négatif ! Autre exemple ? La fameuse politique « arabe » de la France. C’est une supercherie que le Quai d’Orsay réussit à vendre depuis des décennies à l’ensemble de la classe politique ! Elle nous permet de croire que nous sommes ainsi à l’abri de toute menace terroriste, ce que laisse entendre très régulièrement le chef de l’État. Cela me paraît tout à fait absurde. Le consensus que vous évoquez est en fait, je le répète, un consensus sur une politique étrangère devenue inexistante qui peut garder ici ou là du prestige mais qui n’a plus guère d’influence. C’est le consensus du renoncement. Or, moi, je ne renonce pas.
Michel TaubmannConsidérez-vous qu’au moment de la guerre d’Irak, Jacques Chirac et Dominique de Villepin sont allés trop loin, non pas en s’opposant aux États-Unis, mais en agitant la menace du veto, en menant campagne contre les États-Unis auprès de pays qui ne sont pas nos alliés, et dont certains sont des dictatures ?
Dominique Strauss-KahnOn est allé trop loin dans la mesure où on a échoué ! Car, voyez-vous, le problème de toute cette affaire, c’est que Jacques Chirac a échoué dans sa tentative d’éviter que les États-Unis ne s’embarquent dans ce que beaucoup d’Américains eux-mêmes, non pas à l’époque mais aujourd’hui, considèrent comme une erreur. Je pense qu’il a échoué parce qu’il a pris le problème dans le mauvais sens. Il a commencé trop mollement - pendant les mois d’octobre, novembre, décembre - sur le thème « nous ne sommes pas trop d’accord ». Il a fini très durement à partir du mois de janvier jusqu’à la fameuse séance du Conseil de sécurité. Les messages adressés aux Américains ont été parfaitement contradictoires et incompréhensibles. Je pense pour ma part qu’il fallait faire le contraire. Il fallait être plus ferme au départ et montrer aux Américains que ce n’était pas parce que l’on ne voulait pas les accompagner qu’on leur faisait part de notre désaccord, mais parce que l’on avait une expérience différente de cette région. Mais encore une fois on a préféré les effets de manche à une influence sur le cours des choses.
Michel TaubmannEn somme, c’est passer du statut d’un allié, d’un ami qui compte, à celui d’un adversaire qui prend la tête d’une coalition internationale contre les États-Unis... Et le Parti socialiste a soutenu le président Chirac à ce moment-là...
Dominique Strauss-Kahn« Coalition internationale contre les États-Unis » me semble être une formulation excessive. C’est celle employée à l’époque par l’administration américaine. Le PS a soutenu l’idée qu’il fallait être opposé à l’intervention américaine en Irak, et qu’il fallait faire ce que l’on pouvait pour empêcher les Américains d’y aller. En l’espèce, je partageais les motivations du chef de l’État, mais je considère que les effets concrets de cette position sur la crise irakienne ont été nuls. Car le vrai problème est qu’il ne soit pas parvenu à peser sur le cours des choses, ni que l’ensemble des Européens, à commencer par les Britanniques, s’expriment d’une même voix. Or, se situant entre la position continentale et celle des États-Unis, la position de Blair était plus nuancée au départ qu’elle ne l’a été à l’arrivée. En définitive, le résultat de la politique qu’a conduite Chirac, notamment la gestion de cette affaire dans un cadre franco-allemand exclusif, a au contraire renforcé le camp américain. Je suis pourtant convaincu, en dépit des Britanniques, qu’il était possible d’amener les Européens sur une position bien plus homogène. Et, à partir de cette position homogène, même s’il semblait difficile de faire totalement renoncer les Américains - parce que je crois que leur projet avait été planifié depuis longtemps - il était possible d’exercer une influence modératrice.
Michel TaubmannQuel que soit le prochain président élu en France, il aura à faire face à une crise internationale de grande ampleur ; je pense à la crise du nucléaire iranien. Alors que, depuis des années, les Européens négocient avec l’Iran, compte tenu aussi du fait qu’il existe aujourd’hui un accord entre plusieurs grandes puissances européennes pour refuser à l’Iran l’acquisition du nucléaire militaire, et que l’Iran semble déterminé à aller jusqu’au bout, que préconisez-vous ?
Dominique Strauss-KahnVous posez le problème de telle manière qu’il semble insoluble. Il faut envisager les choses autrement. Le problème posé est celui de l’acquisition de capacités militaires nucléaires par un pays signataire du TNP, qui plus est agressif et non démocratique. Avec cette crise, on mesure que s’arc-bouter sur le TNP ne résout en rien la question des moyens de coercition. On mesure que les Américains se sont trompés de cible : la menace ne venait pas de l’Irak mais de son voisin perse. On mesure que la négociation qui est aujourd’hui conduite avec l’Iran ne donne rien. Le cœur de cette affaire, c’est le problème russe et la connexion nucléaire qui se fait entre la Russie, les anciennes républiques russophones et l’Iran. Ma conviction est qu’il n’y a pas d’issue possible dans ce bras de fer diplomatique s’il n’est traité que par les Américains seuls, même avec le soutien des Européens. On ne sortira pas de cette crise iranienne sans l’implication de Poutine. Et il faudra être vigilant sur les contreparties qu’il demandera.
Myriam EncaouaSi la menace nucléaire s’avérait imminente, faudrait-il envisager une intervention militaire en Iran ou bien serait-elle trop dangereuse pour l’équilibre mondial ?
Dominique Strauss-KahnJe refuse de répondre à ces questions hypothétiques. L’essentiel, dans la dissuasion, c’est de toujours faire en sorte que celui avec qui on traite ignore tout de l’étendue de ce que l’on peut faire. De façon plus générale, dans une négociation, c’est toujours une mauvaise position que de dévoiler ses cartes à l’avance - l’Union européenne en fait régulièrement l’expérience dans les négociations à l’Organisation mondiale du commerce, le commissaire européen étant fragilisé par un mandat de négociation à la fois public et précis. Dans le cas de l’Iran, la capacité de réaction de la communauté internationale n’a aucune raison d’être totalement mise à plat. Dans ces conditions, on se doit de dire qu’il ne faut rien exclure.
Myriam EncaouaJe voudrais aborder la question de l’Europe. Le non français au référendum sur la constitution européenne a plongé l’Union dans une crise profonde dont elle ne s’est, pour l’instant, pas relevée. Quels sont les grands chantiers prioritaires à vos yeux pour relancer le projet européen et réconcilier les Français avec l’Europe ?
Dominique Strauss-KahnLa grande priorité, aujourd’hui, c’est d’avoir à la tête de l’État en France quelqu’un qui considère que l’Europe est l’une de ses priorités. Ce que nous vivons depuis onze ans - avec une situation ambiguë pendant la période de cohabitation - c’est exactement le contraire. Il n’est pas besoin de remonter à l’appel de Cochin pour s’en rendre compte : l’actuel président de la République ne considère pas la construction européenne comme l’une de ses missions historiques. C’est le moins que l’on puisse en dire, et on en voit les conséquences aujourd’hui. Pour ma part, je suis convaincu que la bonne santé de l’Europe se mesure à la capacité de ses dirigeants d’imaginer son avenir. Je continue de penser que le couple franco-allemand demeure irremplaçable pour faire progresser le système européen - même s’il doit s’ouvrir aux autres États membres et même s’il faut adapter ses modalités de fonctionnement. Or, aujourd’hui, le couple franco-allemand n’existe plus, nous sommes bien obligés de constater sa mort clinique. C’est d’ailleurs, selon moi, l’une des causes principales de la léthargie dans laquelle se trouve la construction européenne. Il est donc urgent de renouer avec nos partenaires allemands pour retrouver cette impulsion en mettant sur la table ce que sont, je crois, les trois principaux problèmes à traiter. D’abord, bien sûr, celui de l’identité européenne qui touche notamment à la question des frontières. Ensuite, le problème de l’efficacité ou plutôt de l’inefficacité économique du système européen : la promesse européenne qui était largement économique n’a pas été tenue et le « non » français est venu sanctionner cet échec. Enfin, la capacité de l’Union à peser diplomatiquement et militairement sur les affaires du monde et dans la gestion des conflits. Pour résumer : qui sommes-nous et que voulons-nous faire ? Comment créer des richesses pour y parvenir ? Et comment porter notre message dans le monde ? Voilà les trois grandes questions, les trois chantiers que le prochain président de la République devra reprendre pour relancer l’Europe. Si, à l’évidence, la France à elle seule ne suffit pas à construire l’Europe, une chose est sûre, rien ne peut se faire sans la France.
Myriam EncaouaDans le débat sur les frontières de l’Europe, vous n’êtes pas d’accord avec Nicolas Sarkozy. Le ministre de l’Intérieur ne cache pas son hostilité à l’entrée de la Turquie dans l’Union, au nom de l’Europe politique qu’il appelle de ses vœux. Cette Europe politique, intégrée, serait, selon lui, incompatible avec la Turquie tant d’un point de vue démographique, géographique que religieux. En quoi votre approche, votre vision de l’Europe, diffère-t-elle de celle de Nicolas Sarkozy ?
Dominique Strauss-KahnL’argument religieux me semble totalement intenable. Le jour où la Bosnie aura adhéré, on ne pourra plus dire qu’un pays à majorité musulmane ne peut pas faire partie de l’Union. Or il ne fait aucun doute que la Bosnie nous rejoindra un jour. L’argument démographique me paraît difficilement acceptable. Ce n’est pas parce qu’un pays, à lui seul, compte soixante-dix millions d’habitants que l’on a là un argument pour le récuser : même les critères de Copenhague ne considèrent pas qu’une natalité trop forte interdise d’adhérer à l’Union ! Reste l’argument géographique, avancé par un certain nombre de gens, sur le thème « ce n’est pas l’Europe ». Je raisonne autrement, en partant du long terme et en privilégiant les données géopolitiques, et géoéconomiques. Si on imagine le monde dans cinquante ans, il y aura probablement un très grand ensemble dominé par la Chine, dont on devine à peu près les frontières ; il y aura un très grand ensemble autour du sous-continent indien ; il y aura un très grand ensemble nord-américain, qui s’étendra du Mexique au Canada ; il y aura sans doute, même si c’est moins sûr, un ensemble sud-américain, autour du Brésil et de l’Argentine. Face à ces grands ensembles, sorte de nouveau Yalta mondial, la question se pose de savoir s’il y aura ou non un pôle européen. Cela ne me paraît pas certain. L’hypothèse selon laquelle les pays de l’Union européenne deviendraient vassaux de ce qui est la puissance la plus naturellement proche, c’est-à-dire les États-Unis ou plutôt l’ensemble nord-américain, est une hypothèse que l’on ne peut pas écarter. Ce n’est évidemment pas ce que je souhaite, mais c’est une hypothèse qu’à cinquante ans d’ici je ne peux pas écarter. Ce dont je suis sûr, c’est que si l’Europe existe, elle ne sera pas enfermée entre deux frontières ridicules que seraient le détroit de Gibraltar et le Bosphore. J’imagine un enseignant de géographie dans cinquante ans, il dira à ses jeunes élèves : « Voyez, là il y a la Chine, là il y a l’Amérique, là il y a le Brésil », s’il leur dit « là il y a l’Europe », montrant ce bout de péninsule asiatique que l’on appelle l’Europe, il leur montrera un ensemble allant des glaces de l’Arctique au nord jusqu’aux sables du Sahara au sud. Et cette Europe, si elle continue d’exister, aura, je crois, reconstitué la Méditerranée comme mer intérieure, et aura reconquis l’espace que les Romains, ou Napoléon plus récemment, ont tenté de constituer. En d’autres termes, nous avons là un ensemble qui est le berceau de notre civilisation et nous avons la coresponsabilité de cet ensemble. De deux choses l’une. Ou bien nous sommes capables de construire cet ensemble, et à ce moment-là une Union euroméditerranéenne peut équilibrer la puissance chinoise, la puissance indienne, la puissance nord-américaine, ou bien ça ne sera pas le cas, et là je pense que nous aurons échoué. Un jour lors d’un débat un député de l’UMP me disait : « Vous n’imaginez tout de même pas que si la Turquie rentre dans l’Union nous ayons une frontière commune avec l’Irak. » Je me rappelle lui avoir répondu : « Nous aurons de toute façon une frontière commune avec l’Irak. » La question est de savoir si elle est à l’est ou à l’ouest de la Turquie. Si la Turquie n’est pas dans l’Union, alors la Turquie sera absorbée par une autre zone d’influence centrée sur l’Irak ou sur l’Iran. Nous avons intérêt à ce que la Turquie soit de notre côté. Bien entendu, dans une telle hypothèse, l’organisation de l’Union ne pourra pas être homogène, c’est-à-dire la simple homothétie de ce qui a existé dans le passé. Il faudra définir des niveaux d’intégration différents et, pour moi, la zone euro a vocation à être l’ensemble le plus intégré.
Michel LavalQue devient la Russie dans ce grand ensemble ? Et quelle Russie ? La Russie européenne qui va jusqu’à l’Oural ou l’autre, l’asiatique qui s’étend jusqu’au Pacifique ?
Dominique Strauss-KahnC’est difficile à dire aujourd’hui. La Russie a sa dynamique propre. Tout l’enjeu sera de contribuer à une dynamique amicale avec l’Union - y compris pour faire contrepoids aux États-Unis. Cette dynamique doit être conforme aux principes de la démocratie, ce qui implique de ne pas rester silencieux sur la Tchétchénie. C’est important pour les Russes eux-mêmes mais aussi pour les pays qui, comme l’Ukraine, se trouvent aux confins de l’Union et de la Russie. La complaisance qui est la marque actuelle de la politique étrangère de Jacques Chirac à l’égard de la Russie ne mène nulle part. Mais il faut prendre en compte les intérêts de sécurité légitimes de la Russie pour aboutir à un équilibre avec l’Union.
Michel TaubmannConsidérez-vous que la politique étrangère doive rester le domaine réservé du président de la République, ou est-ce l’une des choses qu’il faut changer en France ? Le Parlement doit-il être plus concerné, davantage s’emparer des questions de politique étrangère ? Faut-il que les Français soient plus informés, en discutent plus et que finalement ce soit aussi un thème de la campagne présidentielle ?
Dominique Strauss-KahnFaut-il que la politique étrangère soit une question qui concerne au premier chef le président de la République ? Ma réponse est oui : je pense que dans la répartition des compétences au sein de l’exécutif, la politique étrangère est un domaine important où le président de la République a des orientations à donner. C’est un sujet dans lequel il est directement acteur, ne serait-ce que parce qu’il participe aux sommets internationaux : c’est lui, contrairement à d’autres chefs d’État, qui dirige la délégation française aux conseils européens. Vient ensuite une deuxième question : est-il souhaitable que le Parlement, l’opinion, débattent davantage des questions de politique extérieure ? Autrement dit, l’exécutif doit-il tenir la politique étrangère du pays à l’écart de toute forme de discussion ? Je ne le pense pas. Nous devrions avoir beaucoup plus de contrôle parlementaire, de discussions, de débats au sein des deux assemblées sur les questions européennes, sur les questions de défense et de façon plus générale en matière de politique étrangère. En d’autres termes, la théorisation du « domaine réservé » élaborée par le général de Gaulle il y a près de cinquante ans a vécu.
Gérard GrunbergJe voudrais à présent aborder avec vous les questions qui touchent plus particulièrement à votre sensibilité politique, à savoir la gauche et la social-démocratie. On parle le plus souvent de LA gauche mais il existe en France plusieurs partis de gauche de sensibilités très différentes. Comment voyez-vous les choses, y a-t-il une ou plusieurs gauches et qu’est-ce que cela veut dire ? S’il y a une gauche, qu’est-ce qui la fonde essentiellement ? S’il y a plusieurs gauches, qu’est-ce qui fonde leurs différences ?
Dominique Strauss-KahnIl y a évidemment DES gauches, que l’on se réfère aux organisations ou que l’on plonge dans l’histoire comme dans l’actualité. Il y a « deux gauches », si l’on écoute ce que dit... l’extrême gauche, dont l’objectif stratégique, depuis plusieurs années, est de constituer un « pôle de radicalité » qui a pour objet et qui aurait pour effet d’écarter durablement la gauche du pouvoir. Et pourtant, au risque d’aller à contre-courant, je pense qu’il est légitime de parler de LA gauche. Quel en est, pour moi, le dénominateur commun ? C’est l’idée, à la fois très simple et très complexe, que la maîtrise de l’avenir est à la portée des hommes, c’est-à-dire ni entre les mains de la divinité, ni dans celles du marché ou encore du hasard. Plus précisément, la gauche, c’est la volonté - qui peut d’ailleurs être partagée au-delà de la gauche - de construire une société plus juste et la conscience - qui, elle, est limitée à la gauche - qu’il est possible de la construire. Je tire de cette définition au moins deux conséquences. D’une part, que pour être fidèle à sa mission, le devoir de la gauche, c’est de conquérir et d’exercer le pouvoir ; ce n’est pas de se contenter d’une posture de résistance ni de se cantonner au ministère de la parole. D’autre part, que l’on n’est pas plus ou moins à gauche en fonction de l’intensité de ses revendications mais en fonction de la réalité de ses réalisations - et je n’hésite pas à considérer que, de ce point de vue, je suis plus à gauche que beaucoup ! Là encore, essentiellement, ce qui distingue les gauches, c’est la question du pouvoir et, donc, du réformisme. Pour ma part, je n’admettrai jamais que la gauche refuse de se salir les mains pour changer la réalité au motif que le changement serait trop modeste. Cela concerne aujourd’hui l’extrême gauche mais ce débat a longtemps occupé les socialistes eux-mêmes. C’est la formule que je ne me lasse pas de répéter de Paul Faure [secrétaire général de la SFIO de 1921 à 1940, N.d.l.R.], refusant « le socialisme en tranches dans le capitalisme maintenu », c’est-à-dire refusant les réformes qui, parce qu’elles amélioreraient le sort des plus démunis, reculeraient l’horizon de la révolution. Je suis pour le socialisme en tranches !
Gérard GrunbergAbordons la question de la social-démocratie. Il y a en France le sentiment d’une difficulté pour le Parti socialiste à s’assumer pleinement comme social-démocrate. Qu’est-ce qu’il faudrait changer dans les grandes orientations du PS pour en faire un véritable parti social-démocrate à l’image de ceux qui existent chez nos voisins européens ?
Dominique Strauss-KahnDans les grandes orientations, plus grand-chose... En l’espace de vingt ans, le Parti socialiste est devenu un parti social-démocrate. C’est vrai de son action au pouvoir, notamment depuis le tournant de 1983. C’est vrai de ses textes fondamentaux, notamment depuis l’adoption de sa nouvelle déclaration de principes au début des années 90 qui - avant le New Labour ! - marquait l’abandon des dernières traces révolutionnaires. C’est vrai de ses récents textes de congrès - je pense à la bataille que j’ai menée, et gagnée, en 2003, au congrès de Dijon, pour que la majorité parte sous la bannière du « réformisme de gauche ». Le problème ne se situe pas dans les paroles mais, parfois, dans la musique ! Pourquoi ? Parce que continue de peser sur le Parti socialiste un « surplomb » révolutionnaire. Parce que subsistent dans le Parti socialiste à la fois une tentation radicale - plus nombreuse et plus influente que dans les autres partis sociaux-démocrates - et une tentation populiste.
Gérard GrunbergOn a le sentiment d’assister à la naissance d’une nouvelle manière de faire de la politique... Une nouvelle manière qui se situerait dans le dépassement des doctrines et des appareils politiques et qui s’attacherait à forger un lien direct avec les citoyens. Une démocratie d’opinion là où jusqu’à présent s’exerçait dans le débat politique une démocratie de parti. Partagez-vous ce sentiment et si oui quel rôle auront les partis politiques dans nos démocraties de demain ?
Dominique Strauss-KahnNous ne sommes plus au début de la IIIe République, ni même de la Ve ! De nouveaux instruments sont apparus et ont changé profondément la donne démocratique - hier la télévision de masse, aujourd’hui l’Internet et ses déclinaisons en sites, blogs ou podcasts. Surtout, une nouvelle culture politique a émergé, plus individualiste, plus informée grâce à l’élévation du niveau moyen de l’éducation, plus défiante à cause des difficultés économiques, sociales et morales. Ce faisant, toutes les structures représentatives souffrent. C’est vrai du Parlement. C’est vrai des syndicats. C’est vrai des partis politiques pour lesquels s’ajoutent les conséquences du fonctionnement de la V e République avec l’élection du président de la République au suffrage universel direct et, plus récemment, l’adoption du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral. Dans ce contexte, que devient le Parti socialiste ? Qu’il se rénove me paraît heureux - j’ai même le sentiment qu’il y a mis trop de temps : ainsi, la relation avec les militants a profondément évolué, ils ont plus de poids, ils sont plus nombreux et c’est très bien. Qu’on le contourne me paraîtrait dangereux et le risque existe quand les débats politiques sont anémiés, quand la réflexion intellectuelle est délaissée, quand le fil de l’histoire est négligé. Il faut allier la modernité et la politique, j’ai la conviction que c’est possible !
Myriam EncaouaVous incarnez au sein de la gauche française la figure du social-démocrate par excellence, vous avez d’ailleurs baptisé votre courant « socialisme et démocratie »... Pourtant, alors que dans cette campagne présidentielle qui démarre tout porte à croire qu’il y a, cette fois-ci en France, une place pour la gauche moderne, vous donnez le sentiment de briguer l’investiture des militants socialistes davantage sur votre gauche. Ce positionnement a suscité l’incompréhension chez certains. Comment alors le justifier ?
Dominique Strauss-KahnJ’entends ce jugement. Peut-être certains ont-ils été surpris de me voir dénoncer sans retenue la politique du gouvernement : je ne le regrette pas car, compte tenu de la nature et des échecs de cette politique, il n’y a pas de retenue à avoir. Peut-être certains ont-ils été déçus de me voir prendre place au sein de la majorité du Parti socialiste : je ne le regrette pas non plus, car là s’est joué définitivement l’ancrage réformiste de ce parti. En définitive, je n’ai pas du tout le sentiment d’avoir changé. J’ai écrit La Flamme et la Cendre au début de l’année 2002. J’y développais l’ambition de refonder intellectuellement le socialisme moderne autour d’un axe traditionnel - la lutte contre les inégalités déjà - mais avec des concepts et des instruments renouvelés : c’est ce que j’ai appelé le « socialisme de la production », c’est-à-dire l’idée qu’il ne fallait plus se contenter de combattre les inégalités a posteriori par la redistribution mais qu’il fallait, en plus, les attaquer à la racine, dès qu’elles se forment. Depuis lors, en juin 2004, j’ai approfondi cette réflexion dans un autre essai - L’Égalité réelle - en précisant les points d’application concrets de ce concept sur l’emploi, l’éducation ou le logement. Je suis sur mon axe et je n’en bouge pas.
Gérard GrunbergIl y a une chose qui m’a beaucoup intéressé dans un article que vous avez écrit récemment. Vous dites : « Il y a une crise globale » et « Cette crise est plus profonde dans notre pays parce que nous avons donné à ce projet de socialisation du capitalisme une signification particulière. Nous n’avons pas simplement adopté le modèle européen de l’État-Providence, nous l’avons greffé sur notre génie propre, sur notre tradition républicaine venue de la grande révolution, fondée sur une confiance peu commune dans le rôle central de la politique et de l’État. Disons-le clairement, qu’on s’en félicite ou qu’on le déplore : c’est ainsi que la France est historiquement un pays structuré, tenu par la politique et qui supporte très mal le sentiment que cette dernière soit incapable de résoudre ses problèmes dans leur diversité. » Analyse qui reflète assez bien la pensée politique de la gauche. Elle prend en compte une nécessité française issue de son histoire : faire que la politique reste au commandement. À ce titre la perception du déclin de la France provient largement de ce sentiment d’un abandon du politique. Face à cela, comment concrètement remettre la politique au commandement ?
Dominique Strauss-KahnJe ne suis pas sûr que cette idée structure uniquement la politique de la gauche, je crois qu’elle structure la politique de la France. En effet, l’une des caractéristiques de l’universalisme républicain, c’est qu’il croit possible - à tort diront certains, à raison penseront d’autres dont je suis - de conduire et transformer un pays par la politique. Il y a des sociétés dans lesquelles le marché organise l’ensemble de l’activité. Il y a d’autres pays en Europe dans lesquels la négociation sociale occupe une place centrale - et il y a là une inspiration utile. Mais je pense que notre pays est dans une situation différente et c’est pourquoi la déception face aux échecs que rencontre le pays se cristallise sur la politique. À partir de là, il n’y a que deux solutions. Il y a la solution que préconise Nicolas Sarkozy. Celle de la rupture, celle qui dit « il faut rompre avec le modèle social français » et adopter un modèle libéral anglo-saxon, largement américain, parce que c’est celui qui est dominant, c’est celui qui marche, c’est celui de l’économie mondialisée. Pour moi, cette solution n’est pas une rupture mais un renoncement - un renoncement à ce qu’est la France, et c’est pour cette raison, je pense, que les Français n’en voudront pas. Et puis il y a une autre voie, celle du renouveau que je veux incarner. Ce modèle français - qui n’est pas seulement un modèle social, mais qui est aussi un modèle de la société française - a déçu les Français. Nous sommes face à un véritable malaise démocratique nourri de l’inefficacité économique. Ce qui nous oppose fondamentalement à Nicolas Sarkozy, c’est que, contrairement à lui, je pense qu’il est possible de retrouver ce modèle français en lui redonnant du sens, et en redonnant à la politique toute sa place.
Élie CohenQuand on lit le projet du Parti socialiste, une expression est saillante, celle d’« urgence sociale ». La gauche entend répondre à cette urgence sociale et tout dans son programme en découle. D’où un catalogue de mesures de redistribution. En lisant cela, je pensais à ce que vous aviez écrit précédemment. Est-ce que ce programme n’est pas la parfaite illustration d’un socialisme de redistribution qui oublie l’enjeu majeur du socialisme de production que vous aviez pourtant théorisé ? Est-ce que ce projet ne néglige pas fondamentalement la dimension de la création de richesse ?
Dominique Strauss-KahnD’un côté, il faut le dire, le projet du PS enregistre des avancées sur des sujets pour lesquels je me suis beaucoup battu : le passage de l’égalité formelle à l’égalité réelle, la recherche d’une meilleure efficacité de notre système de redistribution dans certains domaines ou encore une approche nouvelle des inégalités, notamment des « inégalités de destin », formule empruntée au sociologue Éric Maurin. La rénovation de notre corpus idéologique et de notre grille d’analyse du monde a donc été engagée. Mais d’un autre côté, le projet socialiste traite encore un grand nombre de sujets dans l’orbite de la redistribution traditionnelle. C’est nécessaire mais insuffisant. Ceci est directement lié à une erreur de politique économique de base héritée de l’idée traditionnelle, à gauche, que l’insuffisance du soutien à la consommation est toujours à l’origine des difficultés économiques. Voilà ce qui, intellectuellement, a constitué le terreau du projet. Or, si en 1997 l’économie française avait un problème de demande, elle a aujourd’hui aussi - et même d’abord - un problème d’offre.
Élie CohenComment endossez-vous une telle erreur de diagnostic ?
Dominique Strauss-KahnJe ne l’endosse pas puisque je la dénonce et j’ai passé mon temps à la dénoncer publiquement ! Je le dis clairement. De très nombreuses mesures apparaissent dans ce projet. Certaines sont d’ailleurs très intéressantes et mériteraient d’être étudiées plus avant pour en mesurer pleinement les conséquences. En ce sens, le travail réalisé était nécessaire. Mais, si mettre toutes ces propositions bout à bout constitue une ressource utile, cette « bibliothèque » ne constitue pas à elle seule une politique. Il incombera donc au président de la République de fixer ses priorités. Libre à lui d’ajouter ou d’ajourner telle ou telle mesure selon son appréciation de la situation économique française au printemps 2007.
Élie CohenAlors, que retireriez-vous et qu’ajouteriez-vous ?
Dominique Strauss-KahnCompte tenu de l’état des finances publiques, je ne suis pas convaincu - pour user d’un euphémisme - que la première priorité soit la renationalisation à 100 % d’EDF. Compte tenu de l’état de nos universités, je suis en revanche convaincu qu’il est indispensable de consacrer non seulement un effort financier mais aussi une réforme de grande ampleur de l’enseignement supérieur afin de lui redonner le rang d’excellence qui devrait être le sien.
Élie CohenSi vous étiez aux affaires en 2007, quelles seraient vos priorités d’action économique ?
Dominique Strauss-KahnJe pense qu’il y a trois priorités principales pour répondre à la crise actuelle de notre économie. Première priorité : l’investissement dans l’économie de la connaissance, c’est-à-dire l’éducation et la recherche. Ce domaine est capital pour l’avenir de la croissance française. Nous ne concurrencerons pas la Chine ou l’Inde en engageant une course à la compétitivité par les prix. Elle est perdue d’avance. C’est pourquoi il faut concentrer nos efforts sur les secteurs à forte valeur ajoutée. Dans ce domaine encore, nous accusons un retard sévère, notamment vis-à-vis des États-Unis. Les engagements pris à Lisbonne sont restés lettre morte. Or, les effets positifs d’un investissement massif dans ces secteurs ne se font ressentir qu’à moyen et long terme. C’est pourquoi nous ne pouvons plus attendre. Seconde priorité, l’Europe et la nécessaire coordination des politiques économiques de l’Union. Tous les économistes s’accordent sur le fait que nous perdons entre 0,7 point et un point de croissance par an du fait de l’absence de coordination des politiques économiques et de la non-convergence des économies de la zone euro. Il faut donc bâtir une gouvernance économique européenne. Sans vouloir paraître trivial, il faut un pilote dans l’avion. Cela passe par la création d’un gouvernement économique de la zone euro, la nomination d’un ministre des Finances européen ou encore la représentation unifiée de la zone euro sur la scène internationale. Troisième priorité : l’enjeu majeur de nos finances publiques. Nos déficits sont abyssaux. La situation est telle aujourd’hui qu’aucune politique, de droite comme de gauche, n’a de chance de réussir si le rééquilibrage de nos comptes publics, à échéance raisonnable - d’ici cinq ans - n’est pas assuré. Il y aura donc des décisions difficiles à prendre. L’objectif que nous devons nous fixer est celui, dans un premier temps, de la stabilisation de notre dette, condition sine qua non du retour de la croissance. Ne nous y trompons pas, la dette est l’ennemie de la gauche. Elle grève la capacité redistributive de l’État vers les plus défavorisés et fait peser sur les générations futures les choix que nous faisons aujourd’hui. Il y a donc des sujets de long terme, de moyen terme et des sujets immédiats sur lesquels les urgences sont très grandes. Mais, au-delà du programme d’action, il y a un autre élément déterminant, c’est la question de la confiance des Français dans l’avenir. Souvenez-vous, six mois après l’arrivée au pouvoir du gouvernement de Lionel Jospin, les conditions économiques en France étaient passablement différentes de ce qu’elles étaient auparavant. Les Français ont eu le sentiment que la conjoncture repartait dans le bon sens. Aujourd’hui, cette question de la confiance est absolument majeure. Ni les chefs d’entreprise, ni les économistes, ni surtout les salariés n’ont le sentiment que les choses vont dans le bon sens. Il faut doter le pays d’une stratégie de politique économique claire et lisible ainsi que d’un partage de la valeur ajoutée plus acceptable. Le rétablissement, quel que soit l’indicateur que l’on prend, de la confiance dans l’avenir est un élément déterminant de la capacité de l’économie à se redresser. La conférence sur les revenus qu’il faudra tenir dès le retour de la gauche au pouvoir trouve là sa justification. Voilà les principaux défis que nous aurons à relever au lendemain de l’élection présidentielle.
Élie Cohen Quand on lit ce projet, on a l’impression qu’un terme résume la nouvelle idéologie du Parti socialiste, c’est le terme de « services publics ». Est-ce que vous êtes d’accord pour dire que la colonne vertébrale de l’identité socialiste aujourd’hui c’est le service public ?
Dominique Strauss-KahnIl est vrai que c’est l’un des termes qui résume bien ce qu’il y a dans ce document. Cette question des services publics, dans sa conception large, au-delà de sa seule définition juridique, est essentielle et correspond pour une bonne part à ce que les socialistes français et européens ont à l’esprit aujourd’hui. Il y a dans le débat, et j’y ai contribué, une conception renouvelée des services publics à partir d’une nouvelle approche des inégalités. Je me suis beaucoup battu pour que la lutte contre les inégalités soit engagée en amont, c’est-à-dire au moment où ces inégalités se créent, plutôt que de se contenter d’un système redistributif qui ne fait que constater après coup l’ampleur des dégâts générés par le marché. De nombreux travaux d’économistes, comme ceux de Gösta Esping-Andersen, ont d’ailleurs montré que c’est entre deux et six ans que se créent ces « destins inégalitaires », quasiment impossibles à compenser par la suite. Par conséquent, il est donc juste humainement, mais également efficace économiquement, de tout faire pour sauver ces talents potentiels dont les chances ont été sabotées par un environnement socioculturel ou un système éducatif inégalitaire. Pour combler ces écarts de capital cognitif, la collectivité doit prendre en charge et pallier les faiblesses de l’environnement de certains enfants. Avec cette approche, on aboutit à la création d’un service public de la petite enfance. Un service public différent de l’Éducation nationale traditionnelle et qui correspond à une conception nouvelle du service public. Encore une fois, nous sommes dans une logique de la prise en charge du risque et de la réponse à y apporter.
Élie Cohen Je continue la revue du programme. Il y a en matière de politique de l’emploi une avancée majeure : le Parti socialiste semble se rallier à la notion de « flexisécurité ». Le problème est que si le PS est prolixe en matière de dispositifs de sécurisation des parcours professionnels il n’y a rien sur la flexibilité. Est-ce que, là aussi, cela fait partie des choses qu’un candidat doit compléter ou est-ce que cette notion de flexibilité n’est pas pertinente, qu’il n’y a pas lieu de la rechercher particulièrement ?
Dominique Strauss-KahnTout dépend de ce que l’on entend par flexibilité. S’il s’agit de dire que le marché du travail fonctionne mal et qu’il serait souhaitable pour l’emploi qu’il fonctionne mieux, je suis d’accord. S’il s’agit de dire qu’il suffit d’avoir un marché du travail dérégulé pour que celui-ci fonctionne mieux, je ne suis pas d’accord. S’il s’agit de dire qu’après avoir restructuré l’offre, investi dans l’éducation et stimulé le pouvoir d’achat, il reste un sujet que l’on ne peut laisser de côté, celui du fonctionnement du marché du travail, je suis d’accord. S’il s’agit en revanche de dire que le sujet principal à traiter est celui de la fluidité du marché du travail avant de traiter des problèmes de croissance potentielle et de finances publiques, là je ne suis pas d’accord. La fluidité du marché du travail (c’est-à-dire finalement une meilleure correspondance entre les besoins de l’économie et la formation des salariés) peut être améliorée mais c’est un sujet que l’on ne peut traiter qu’une fois la croissance revenue. C’est à cette seule condition que l’opinion sera prête à accepter des modifications à ce qu’elle considère, à tort ou à raison, comme un cadre protecteur.
Élie CohenPour en finir sur le projet, son coût global a été évalué à 50 milliards d’euros, ce qui équivaut à 3 points de PIB. C’est colossal !
Dominique Strauss-KahnCela signifie que la cinquième année il faut avoir fait 3 points de plus. Ce qui revient à moins de 0,6 point par année pendant cinq ans. Je le dis franchement, si nous n’obtenons pas 0,6 point de croissance de PIB supplémentaire chaque année, tout programme politique est bon à jeter aux orties !
Élie CohenIl y a un concept que vous avez forgé et que je n’ai jamais bien compris, c’est celui des « nationalisations temporaires ». L’État peut-il vraiment nationaliser une entreprise en difficulté, c’est-à-dire la soustraire au marché puis la remettre sur le marché ?
Dominique Strauss-KahnL’idée m’est venue en visitant une entreprise qui s’appelle Sediver, une PME dans l’Allier qui fabrique des cloches de verre servant au soutien des caténaires d’EDF sur les lignes à haute tension. L’entreprise, après des difficultés financières, s’est trouvée sur le point d’être fermée et délocalisée en Chine et au Brésil où, à juste raison du point de vue de ses actionnaires, les marchés sont potentiellement plus importants qu’en France. Mais cette entreprise est stratégique pour EDF. Elle garantit par sa présence sur le territoire national des délais d’approvisionnement courts. Souvenons-nous de la tempête de décembre 1999. De nombreuses lignes à haute tension ne fonctionnaient plus, privant ainsi des milliers de foyers d’électricité, mais également de très nombreuses entreprises. En peu de jours, l’ensemble du réseau était rétabli. Si les cloches de verre indispensables au fonctionnement des lignes avaient été fabriquées dans un autre pays, les délais de livraison auraient été rallongés et le coût à la fois humain pour les ménages et financier pour les entreprises aurait été nettement supérieur. Dans ces conditions, on peut donc considérer que cette entreprise est suffisamment stratégique pour être aidée. L’entreprise avait besoin d’une dizaine de millions d’euros. Entre trente et quarante entreprises tout aussi stratégiques connaissent chaque année des situations de ce type, ces entreprises constituent des goulets d’étranglement du système productif. Je crois que la collectivité a un intérêt à assurer leur bon fonctionnement. Ce financement doit se faire en capital et non pas en emprunt afin d’éviter un endettement durable. Or, si l’État assure ce financement, comme ce sont généralement des entreprises très peu capitalisées, elles deviennent formellement des entreprises publiques. Évidemment, cette nationalisation ne revêt qu’un caractère temporaire. Dès que les investissements ont été faits et que l’entreprise redevient rentable, il faut la remettre sur le marché. Il n’y a aucune raison pour que l’État la conserve. Voilà un exemple concret d’intervention publique face à des situations particulières qui frappent nos entreprises.
Michel LavalPour terminer je souhaiterais aborder avec vous les thèmes liés à la France... Vous avez ces derniers temps et encore cet été à l’occasion d’une fête de la fraternité organisée à Sarcelles, dénoncé avec beaucoup de fermeté et de sévérité la politique du ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy en matière d’immigration. On peut bien évidemment comprendre vos préoccupations inspirées d’un sentiment humanitaire, mais, en allant au-delà de la seule protestation, quel type de politique alternative préconisez-vous en matière d’immigration ? Non seulement sur le problème actuel et politiquement sensible des régularisations, mais de façon plus générale sur la question de la régulation des flux migratoires. Par ailleurs, êtes-vous partisan de laisser, comme l’extrême gauche le demande, les hommes circuler aussi librement que les marchandises - comparaison qui n’engage qu’elle - ou bien alors considérez-vous qu’il est absolument nécessaire de contrôler les flux migratoires, de régulariser les situations des clandestins en France, sur quels critères et selon quelle méthode ?
Dominique Strauss-KahnPour répondre à votre question, il faut partir d’un constat préalable : nous avons en France une croissance potentielle extrêmement faible. Une des causes sur le long terme réside dans la faiblesse démographique de notre pays. Partant de ce constat, je considère que, sur le long terme, nous avons besoin d’une politique d’immigration positive. Certes, nous devons mener des politiques de relance de la natalité. Certes, nous devons faciliter l’adoption. Mais les relances de natalité sont des politiques particulièrement délicates à mettre en oeuvre, et l’adoption généralisée par des familles françaises est inenvisageable. Reste le troisième volet du triptyque, l’immigration. L’idée que la France doit être, sur le long terme, une terre sur laquelle la population augmente par l’immigration est une idée que je crois juste. Cela ne veut évidemment pas dire que nous devons accepter n’importe quel flux migratoire et que nous n’avons pas besoin de réguler ces flux. À ce titre, deux questions se posent : à quel niveau voulons-nous les réguler et comment organise-t-on cette régulation ? Sur le principe, je suis de la même fermeté que celle dont le ministre de l’Intérieur fait montre. La priorité est de faire respecter la loi. Mais respecter la loi sur l’immigration clandestine, ce n’est pas exclusivement lutter contre les clandestins qui sont passés entre les mailles du filet. C’est surtout lutter contre les passeurs de clandestins, les logeurs clandestins, les employeurs clandestins. Il faut donc, pour lutter contre l’immigration clandestine, lutter contre ce qui la rend possible. L’autre aspect de la politique à mener, c’est la limitation de la pression migratoire sur le long terme. Cet aspect touche à la question du développement des pays qui sont à la source de notre immigration, c’est-à-dire les pays du Maghreb et les pays d’Afrique subsaharienne de langue française. Cela implique une concertation étroite avec ces pays, ce que Nicolas Sarkozy ne fait pas.
Dans le cas des familles d’élèves sans papiers, on est là typiquement devant le type d’immigration que l’on peut souhaiter vouloir garder sur notre territoire, et annoncer à l’avance que 30 % des cas seront régularisés en assurant dans le même temps que tous les dossiers seront examinés au cas par cas ne me paraît pas du tout la bonne manière de mener une politique d’immigration. Ce qu’il faut, c’est étudier régulièrement et individuellement les dossiers à l’écart de tout battage médiatique.
Michel LavalOn est confronté en France à un débat sur la question de l’intégration. On voit régulièrement s’opposer les partisans d’une intégration républicaine classique à la française et d’un communautarisme à l’anglo-saxonne. Où vous situez-vous dans ce débat ? Considérez-vous que l’intégration républicaine constitue un modèle dépassé et dans l’affirmative quelle est la solution alternative ?
Dominique Strauss-KahnLe modèle d’intégration républicain traditionnel n’est pas caduc. Mais pour que la République intègre, il faut qu’elle soit présente. Et, disons-le tout net, dans beaucoup de cités, la République est défaillante. Il faut donc, d’abord, revenir aux fondamentaux, c’est-à-dire aux instruments de la République : sans l’école, sans les services publics, sans la police, ce modèle d’intégration ne peut évidemment pas fonctionner. Pour autant, doit-on empêcher les citoyens dans ce pays d’avoir des références, des appartenances religieuses, culturelles ou ethniques qui font partie de la structuration de leurs personnalités ? Là, je réponds non. En France, l’État a précédé la nation. C’est l’analyse classique : la monarchie puis la Révolution française ont construit un pays uni, contre les féodalités et les particularismes. Aujourd’hui, la nation France est solidement bâtie sur ce substrat historique. Je crois donc que la République est assez forte pour que des Français d’origine bretonne se sentent d’origine bretonne ou que des Français d’origine algérienne se sentent d’origine algérienne. Ce qui compte, c’est que la chose publique soit républicaine, c’est que l’organisation sociale soit fondée sur les seuls principes de la République. Je mets donc une limite à la position consistant à vouloir combattre toute trace de singularité du citoyen français et à vouloir revenir à un système où il n’existe rien entre le citoyen et l’État. Je crois qu’il est possible de conjuguer des identités plurielles à partir du moment où elles ne sont pas exclusives les unes des autres. C’est dans ce cadre-là que se pose le problème de la laïcité. À ce titre, on s’aperçoit curieusement qu’aujourd’hui ses plus farouches défenseurs trahissent en réalité l’esprit de la loi de 1905. Cette loi a été faite pour permettre à des gens différents de vivre ensemble et non pas pour pourchasser les curés ou les imams, pratique plus en vogue aujourd’hui. Faire vivre la laïcité, c’est permettre la coexistence d’appartenances diverses, religieuses et/ou culturelles dans la limite du respect de la République. Cette condition, le respect de la République, suppose que celle-ci soit présente dans les lieux où justement ces Français en ont le plus besoin. Ce qui nous ramène à mon propos initial : plutôt que de signer l’avis de décès du modèle républicain, prouvons notre capacité à mettre en œuvre tous les instruments de l’intégration républicaine qui aujourd’hui font défaut.
Michel LavalAu travers de ce qui se dit et de ce que l’on entend sur les questions de l’immigration et de l’intégration, on voit bien qu’il y a ce que beaucoup s’accordent à considérer comme une sorte de crise de ce que Fernand Braudel appelait l’identité française, une remise en cause des valeurs et des principes sur lesquels ce pays s’est en grande partie constitué, et pas seulement depuis la Révolution française. On peut identifier les causes historiques, sociales, politiques, spirituelles, philosophiques qui sont à l’origine de cette crise. Vous êtes candidat à la candidature de la présidence de la République et vous ambitionnez donc d’avoir un jour la charge de ce destin deux fois millénaire. Qu’est-ce que le possible futur président de la République Dominique Strauss-Kahn appelle la France ?
Dominique Strauss-KahnL’histoire de notre pays est deux fois millénaire. Aujourd’hui, ce qui nourrit notre identité collective, c’est la philosophie des Lumières. Les révolutionnaires de 1789 ont porté ces idéaux dans la lutte historique et les ont transformés en principes politiques. Mais la Révolution française constitue moins un point de départ qu’un point d’accumulation. La Révolution est certes apparue comme une rupture fondamentale dans l’histoire de France. Mais elle n’a pas fait table rase. La Révolution française comporte aussi des éléments de continuité : elle a enregistré et absorbé les strates historiques des siècles précédents, et les a synthétisées, reformulées en un nouveau message. C’est cela, la France : cette volonté, ancrée dans l’histoire, de porter un message au monde qui est un message différent de la plupart des autres peuples. Les armées de Valmy ont porté partout en Europe les idéaux de liberté, d’égalité, de fraternité. La Résistance a incarné le refus de la barbarie et de l’oppression. Puis, des décennies durant, la France a été un moteur de la construction européenne, où elle a joué un rôle qui n’est pas exactement le même que celui des pays qui nous entourent. Quand on dit cela à nos voisins allemands, anglais ou italiens, ils ont tendance à nous regarder d’un air un peu narquois, sur le thème : « Vous autres Français, vous vous croyez toujours différents des autres. » Et ils ont raison de le dire, et d’autant plus raison que, oui, c’est vrai, la France c’est quelque chose d’un petit peu différent des autres ! Le grand défi de notre époque, c’est de réinventer un chemin français : une voie française dans le nouveau millénaire, une voix de la France dans le monde.
La France doit rester le modèle d’une société dont l’horizon est la quête de l’égalité citoyenne. Notre héritage est fait d’humanisme, de solidarité, de culture des droits de l’homme. Notre volonté est d’avoir notre mot à dire sur la planète, d’exister en tant que peuple. C’est ce qu’on appelle l’universalisme républicain. Pour être à la hauteur de notre tâche historique, nous devons mettre en œuvre cette belle intuition de François Mitterrand : la France est notre patrie, l’Europe est notre avenir. C’est pourquoi, le message de la France doit redevenir européen, doit de nouveau inspirer le Vieux Continent. Il y a un sens particulier à donner à la construction européenne à partir de ce qu’est la France. Même s’il ne s’agit pas de faire de l’Europe une grande France - idée qui paraîtrait arrogante - c’est à la France qu’il revient de donner l’impulsion pour avancer ensemble, préserver la paix et bâtir l’avenir.
|