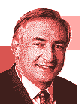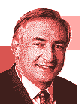| | Mesdames, messieurs, chèr(e)s ami(e)s, Je voudrais tout d’abord, en conclusion de cette journée de travail organisée par « Socialisme et démocratie », remercier tous ceux qui y ont participé. Je salue tous les élus de gauche qui sont venus aujourd’hui : les députés, Julien Dray et Jean-Yves Le Bouillonnec ; les maires de banlieue, François Pupponi bien sûr, Maurice Charrier (maire de Vaulx-en-Velin), Pierre Bourguignon (maire de Sotteville-les-Rouen), Claude Dilain (maire de Clichy-sous-Bois), Dider Vaillant (maire de Villiers-le-Bel) ; les responsables du Parti socialiste, Alain Bergounioux, Chafia Mentalecheta, Philippe Zitoun, Yvon Thiant ; et tous les autres responsables politiques présents aujourd’hui – qu’ils me pardonnent si je ne peux pas les citer tous.
Je remercie les chercheurs qui ont bien voulu éclairer nos débats : je pense notamment à Henri Rey et Christine Lelevrier, dont je suis les travaux. Je rends également hommage aux acteurs de terrain, qui ont partagé leur expérience avec nous : en particulier Fadela Amara, la présidente de Ni putes ni soumises, Akli Melouli, de l’association Déclic 21, Mohamed Jamjama, de l’association Avenir 84, d’autres encore. Pourquoi cette rencontre nationale sur les quartiers populaires ? Après s’être longtemps rêvée immuable et éternelle, rurale comme par essence, la France est entrée de plain-pied, depuis les grandes
mutations de l’après-guerre, dans l’ère de la civilisation urbaine. Avec ses réussites, ses améliorations, ses espoirs, cette civilisation a également apporté son lot de dérèglements. Or ces dérèglements se concentrent sur les quartiers populaires, ces trois cents communes les plus pauvres de France. La civilisation urbaine y est désordonnée et sauvage. Dans ces quartiers, les populations se trouvent confrontées à tous les handicaps, qu’ils soient économiques et sociaux, avec des taux de chômage élevés et une pauvreté préoccupante ; ethniques, avec les problèmes d’intégration rencontrés par les primo-arrivants ; urbains, avec des phénomènes de ghettos et d’enclavement qui s’accentuent, sans parler des problèmes d’insécurité. Face à ces dérèglements, la rencontre d’aujourd’hui, dans cette ville symbole de la banlieue qu’est
Sarcelles, et dont je suis l’élu, répond à une triple nécessité :  Une nécessité républicaine, tout d’abord : les banlieues doivent être réintégrées dans le territoire de la République Une nécessité républicaine, tout d’abord : les banlieues doivent être réintégrées dans le territoire de la République. Elles en sont exclues aujourd’hui. Nous ne pouvons l’admettre : la République doit se déployer partout, la France ne peut se résigner à voir une partie de son territoire se dissoudre
hors du champ du « vivre ensemble ».  Une nécessité démocratique, ensuite : les quartiers populaires sont la nouvelle terre de conquête
de la démocratie Une nécessité démocratique, ensuite : les quartiers populaires sont la nouvelle terre de conquête
de la démocratie. Il n’y a de vraie démocratie qu’universelle. La République bourgeoise de la France du XIX ème siècle ne l’était pas, qui excluait le prolétariat par le cens et la misère. Or aujourd’hui, on vote peu dans les quartiers populaires : où est la démocratie si des territoires entiers en sont en pratique exclus ?  Une nécessite politique pour la gauche, enfin Une nécessite politique pour la gauche, enfin. Léon Blum en son temps avait tenté d’intégrer à la République ces ouvriers qui, disait-il, « campaient aux portes de la cité ». Aujourd’hui, ce sont les « jeunes des banlieues » qui campent aux portes de la République. Regagner les couches populaires, pour la gauche, cela ne veut plus seulement dire mobiliser sur le parvis des usines. Cela veut également dire s’attaquer à la crise des banlieues : les quartiers populaires sont notre nouvel horizon politique. Disons-le : c’est dans la reconquête des quartiers populaires, dans notre capacité à apporter des solutions viables et pérennes aux problèmes quotidiennement rencontrés par les populations qui y vivent, que se joue l’ avenir de notre civilisation urbaine. Des solutions, les acteurs sociaux en expérimentent depuis toujours, sur le terrain, mais ils se sont longtemps battus seuls. Les chercheurs s’y intéressent depuis longtemps : Pierre Bourdieu, Alain Touraine, Robert Castel, Jacques Donzelot pour ne citer que les plus célèbres, mais les pouvoirs publics ne s’y penchent que depuis une date plus récente. Cela s’est fait avec la naissance de la politique de la ville qui n’a pas toujours été très efficace. Il est temps de mettre en place, maintenant, une grande politique nationale pour reconquérir le cœur des quartiers populaires. Je vous écoute aujourd’hui, j’entends vos propositions, je note vos expériences. Je vois bien que les principaux éléments sont déjà là, entre nos mains. Le défi est à notre portée, même s’il est immense : les quartiers populaires concentrent toutes les inégalités de destin. Pour lutter contre ces inégalités, nous avons besoin d’une politique de rupture au service de ces territoires : c’est à cette condition que nous parviendrons à maîtriser la civilisation urbaine.
1. LES QUARTIERS POPULAIRES
SONT AU COEUR DES INÉGALITÉS DE DESTIN
Les banlieues défavorisées concentrent tous les handicaps
Les Français ne sont pas égaux devant leur destin. Statistiquement, un enfant né dans une banlieue défavorisée a peu de chances de réussir sa vie. Il y a autant d’enfants intelligents et travailleurs à Sarcelles qu’à Neuilly. Et pourtant, ils réussiront souvent à Neuilly et ils échoueront souvent à Sarcelles. Bien sûr, il y a toujours des exceptions individuelles, des parcours brillants. Mais la réalité statistique est incontestable : on sort difficilement du ghetto. Pourquoi ? Un récent rapport du Conseil d’analyse économique en témoigne : c’est que les banlieues défavorisées concentrent sur un même territoire tous les handicaps.
 Les handicaps sociaux. Les handicaps sociaux.Toutes les statistiques le montrent : les inégalités s’accroissent entre les territoires qui s’en sortent et ceux qui s’enfoncent. Les quartiers populaires concentrent la pauvreté : 70 % des ménages vivant en zone urbaine sensible (ZUS) ont un revenu inférieur au revenu médian des Français. Et cette pauvreté s’accroît. Les indicateurs socio-économiques ne traduisent aucune amélioration de la situation dans les ZUS. La situation en Ile-de-France est parlante : entre 1984 et 1996, le revenu moyen des foyers fiscaux a fléchi de 3,5 % dans les ZUS alors qu’il a augmenté de près de 7 % dans les communes riches de la région. On constate les mêmes évolutions pour le taux d’échec scolaire ou les indicateurs de santé. Les déséquilibres sociaux « se sont durablement installés », comme l’indiquent les auteurs du rapport du CAE.
 Les handicaps économiques Les handicaps économiques. La situation économique des quartiers populaires est préoccupante. Une part importante des actifs est reléguée hors du marché du travail, dans le chômage et la précarité. La hausse des taux de chômage est plus rapide dans les quartiers défavorisés qu’ailleurs. En 1990, le taux de chômage s’élevait dans les ZUS à 18 %, il dépassait 25 % en 1999. Les femmes, les jeunes sont particulièrement exposés : en 1999, près de 40 % des jeunes de 20 à 24 ans résidant dans des ZUS étaient au chômage, contre 28 % dans le reste de la métropole. Les chômeurs de longue durée y sont de plus en plus nombreux.  Les handicaps ethniques Les handicaps ethniques. La concentration des populations étrangères ou d’origine étrangère dans les quartiers en difficulté est un obstacle supplémentaire à leur intégration. C’est qu’ici, les questions de l’intégration de l’individu au corps social, et des territoires à la République, sont intimement liées : il est d’autant plus difficile pour les primo-arrivants, comme pour les enfants d’immigrés, de s’agréger au corps civique, qu’ils s’installent précisément dans des quartiers eux-mêmes faiblement intégrés à la ville.  Les handicaps urbains Les handicaps urbains. La dégradation de l’habitat apparaît comme l’un des grands symboles de la crise des banlieues. Cette dégradation, au-delà des facteurs sociaux, a des explications proprement
urbanistiques. D’une part, on observe une très forte concentration du parc social, puisque plus d’un tiers des 4 millions de logements sociaux sont situés en ZUS. Or le parc HLM, construit pour l’essentiel entre 1960 et 1980, au moment des grandes vagues d’urbanisation, est aujourd’hui vétuste et pour partie délabré. D’autre part, les quartiers défavorisés connaissent un phénomène de non-appropriation : il n’y a pas de propriétaires, ce sont des zones où la propriété privée n’existe pas. Les habitants sont généralement locataires, et les offices HLM ont trop souvent abdiqué leur rôle de propriétaire. Dès lors, leur capital immobilier n’est plus entretenu, et rien ne vient enrayer la dégradation généralisée des logements sociaux.  L’insécurité publique L’insécurité publique. Les banlieues sont peu à peu devenues un lieu fantasmatique, où naissent la violence et l’insécurité qui menacent la société toute entière. Il est vrai que l’insécurité « globale », qui va des incivilités aux agressions en passant par la dégradation des biens publics et privés, y est élevée. Les incendies de voiture, en particulier, sont le symbole de cette violence urbaine incontrôlée. Dans l’imaginaire collectif, les jeunes des banlieues ainsi sont devenus la nouvelle classe dangereuse.
Ils ont pris le relais des classes laborieuses du XIX ème siècle, ou des vagabonds du Moyen-Age. Ainsi les quartiers défavorisés cumulent-ils tous les handicaps. Cette accumulation entraîne une stigmatisation du territoire, qui rend impossible toute amélioration autonome de ces quartiers laissés pour compte. Les personnes longtemps au chômage perdent peu à peu tout lien avec les relais institutionnels
et s’éloignent des circuits pertinents d’information et de socialisation ; ce seront celles qui ne profiteront
pas du retour à la croissance. La ségrégation urbaine produit une perte de mobilité géographique
et une discrimination par « l’adresse » : elle accroît encore la distance avec les circuits « intégrés » et renforce les effets du chômage de longue durée. Les discriminations à l’embauche frappent les minorités « visibles », black ou beur, et s’étendent à toute la population de la banlieue : le « jeune des banlieues », avec son comportement et son langage propres, est systématiquement écarté. Enfin, la concentration des élèves en difficulté s’avère un gage d’échec scolaire malheureusement très efficace : la reproduction des inégalités y est patente. La stigmatisation du territoire pousse par ailleurs les rares familles des quartiers populaires qui s’en sortent, par exemple lorsque le père ou la mère retrouve un emploi correctement rémunéré, à quitter dès qu’ils le peuvent leur quartier. Des ménages plus défavorisés viennent alors les remplacer, et la situation du quartier empire encore. On assiste ainsi à un phénomène paradoxal : les réussites individuelles, loin d’entraîner une amélioration, se révèlent au contraire, pour les territoires en difficulté où elles ont lieu, des facteurs aggravants. Tout ceci entraîne au mieux l’éloignement de la politique, l’indifférence à une vie civique inaccessible, au pire la révolte violente. L’évidente désespérance que traduisent ces attitudes vient de l’absence de perspectives d’intégration – aussi bien sociale que territoriale - au reste de la République. Le risque est alors grand de voir se développer dans cette partie de la population une intégration de substitution fondée sur des circuits économiques de remplacement (notamment dans l’économie souterraine) ou sur un intégrisme communautaire.
Loin de les corriger, les politiques publiques renforcent les inégalités territoriales.C’est le grand paradoxe des politiques publiques : elles sont inégalitaires, elles favorisent les territoires riches et génèrent des discriminations négatives contre les quartiers pauvres. Versailles possède davantage de moyens financiers et humains, de services publics, que Vaulx-en-Velin ou Clichy-sous-Bois. Il y a deux raisons à cela.  La première raison, c’est la fiscalité locale. Elle est par nature inégalitaire : les communes des banlieues populaires ont moins de moyens budgétaires parce qu’elles ont un potentiel fiscal plus faible. C’est vrai pour les deux grands impôts locaux. La taxe professionnelle (TP) y est peu importante, car les entreprises y sont rares. Il n’y a généralement pas de bassin d’emplois générant une TP abondante. Les statistiques montrent que la TP est très concentrée : 10 % des communes concentrent 93 % de ses bases. La fiscalité locale n’est pas simplement injuste pour les communes, elle est aussi injuste pour les habitants. La taxe d’habitation, surtout, s’avère d’une rare iniquité. Ses bases sont archaïques : elles font référence à des valeurs locatives cadastrales datant de 1970. Comme à l’époque, les logements HLM étaient considérés comme des logements modernes, il arrive aujourd’hui que la base taxable y soit plus élevée que pour une maison avec jardin. Qui plus est, les communes qui bénéficient de fortes rentrées de TP peuvent alléger le taux de la taxe d’habitation, ce que ne peuvent faire les autres. On peut ainsi être amené à payer plus de taxe d’habitation à Drancy qu’au Vésinet ! Cet impôt, sans lien avec les revenus de la famille, peut devenir insupportable. J’en ai fréquemment la confirmation. Quand je reçois dans ma permanence de député, ou en mairie, des familles qui ne peuvent pas payer leurs impôts, il ne s’agit jamais de l’impôt sur le revenu : les foyers modestes en sont exonérés. Non, le problème, invariablement, c’est la taxe d’habitation. Pour faire face à cette faiblesse du potentiel fiscal, les communes ne peuvent augmenter les taux
supportés par une population sans ressources. L’intercommunalité n’est pas non plus une solution
car les mécanismes d’aide sont transitoires et in fine, l’agrégation de communes pauvres construit
sans surprise une agglomération pauvre. L’intercommunalité n’a en fait de sens que pour les ensembles
incluant des communes riches.  La seconde raison qui explique que les politiques publiques renforcent les inégalités territoriales,
c’est l’insuffisance de l’action de l’Etat. Celui-ci a bien tenté de mettre en place différents dispositifs
pour soutenir les communes pauvres. Mais ils se révèlent globalement inefficaces. Il y a d’abord les dotations de péréquation. Elles visent à réduire les disparités de richesse fiscale entre les communes. Malgré leur importance (60 milliards d’euros), elles ne corrigent que très partiellement ces disparités : le Commissariat au Plan évalue à 30% la réduction des écarts de richesse ainsi opérée. De plus, ces dotations sont illisibles : il y a des mécanismes spécifiques (fonds national de péréquation, fonds départementaux, fonds de correction des déséquilibres régionaux, fonds de solidarité des communes d’Ile de France…) qui cohabitent avec des dotations généralistes (la dotation de solidarité urbaine, la part « aménagement » de la dotation globale de fonctionnement…). Au total, ces flux de péréquation ne sont pas suffisamment concentrés sur les banlieues
défavorisées. Le résultat n’est qu’un gigantesque saupoudrage. Au-delà des diverses dotations, l’Etat aide au financement des investissements locaux par la politique de la ville. Ces financements posent touteois un triple problème pour les communes très pauvres. Premièrement, la politique de la ville exige un cofinancement que les communes très pauvres ne peuvent pas fournir. Ces communes disposent de budgets qui ne leur permettent déjà pas d’assurer dans des conditions normales les missions communales de droit commun. Il leur est impossible de mobiliser des moyens supplémentaires pour cofinancer les investissements soutenus par la politique de la ville. Deuxièmement , même s’ils étaient financés à 100 % par l’Etat au titre de la politique de la ville, ces investissements leur poseraient des problèmes insolubles de trésorerie liés notamment à l’assujettissement à la TVA. Troisièmement, les communes en grande difficulté n’ont pas les ressources nécessaires pour financer les dépenses de fonctionnement induites par les investissements ainsi réalisés. L’Etat tente aussi de créer un tissu économique dans les banlieues défavorisées, au moyen de la défiscalisation des « zones franches urbaines ». Mais ici encore, le bilan est mitigé malgré le succès de la ZFU de Sarcelles-Garges que je veux saluer et qui sert un peu de contre exemple. En effet, les ZFU sont souvent à l’origine d’effets pervers. Elles se limitent trop souvent à un simple effet d’aubaine lorsque des entreprises déménagent de quelques rues pour bénéficier des avantages fiscaux. Elles voient aussi l’arrivée de « boîtes aux lettres », tandis que les activités « réelles », et bien entendu les emplois qui vont avec, demeurent localisés ailleurs : le système n’a dans ces conditions aucune répercussion sensible en termes d’emploi sur la zone. Enfin, l’implantation réelle de l’entreprise dans une ZFU ne s’accompagne pas nécessairement de créations d’emploi pour les populations de la zone en question : l’entreprise peut vivre en circuit fermé, et faire venir d’ailleurs ses employés. Dans ces conditions, l’irrigation du tissu local demeure faible. L’Etat, enfin, tente de corriger les handicaps scolaires des quartiers populaires à travers le déploiement
de zones d’éducation prioritaires (ZEP). Ici encore, l’idée est de concentrer les moyens éducatifs dans
les quartiers en difficulté. La création des ZEP a bien permis de stabiliser les écarts dans les résultats
scolaires entre les zones favorisées et les zones défavorisées. Mais elle n’a pas permis de renverser la
tendance. D’abord, parce que les moyens sont trop limités : ainsi, les primes données aux enseignants
sont insuffisantes à compenser les contraintes que peut représenter l’enseignement dans certains établissements
dégradés. Ensuite, parce que les ZEP ont elles aussi un effet pervers : le classement d’un
établissement en ZEP, par son effet de stigmatisation, entraîne la fuite des classes moyennes.
Derrière l’affichage, la réalité de la politique du gouvernement Raffarin s’avère nocive pour les quartiers populaires.La politique de la ville fait partie des priorités affichées du gouvernement. La loi de programmation sur la ville du 1 er août 2003 reflète cette ambition : suppression du surendettement des ménages ; doublement des zones franches urbaines ; et surtout un plan ambitieux de démolition et de reconstruction des barres HLM. Sur ce sujet, Jean-Louis Borloo s’est beaucoup battu. Pourtant, cet affichage volontariste cache, comme souvent avec le gouvernement de Jean-Pierre
Raffarin, une réalité bien différente. D’abord, les crédits budgétaires pour le plan de démolition /
reconstruction ne suivent pas : le projet de loi de finances pour 2004 n’inscrit que 50 % des crédits prévus par la loi du 1 er août 2003. Ensuite, tous les budgets destinés aux quartiers populaires sont en baisse : réduction de 10 % du budget de la délégation interministérielle à la ville ; réduction de 10 % des subventions aux associations de quartier ; chute de 40 % de l’aide au fonctionnement des services publics dans les banlieues pauvres. Enfin, le gouvernement contribue à détruire le tissu social des quartiers : suppression des aides-éducateurs, des emplois-jeunes, des contrats emplois-solidarité utilisés par les associations de terrain… C’est une faute inexcusable, au moment où le lien social fragilisé demande à être nourri, où les tensions ethniques se renforcent, où l’insécurité s’accroît. Ainsi, derrière
l’affichage, la réalité est que le gouvernement abandonne les quartiers défavorisés. Le projet de retrait
de la délégation interministérielle de la ville hors de Seine Saint-Denis, pour déménager dans le 15 ème arrondissement de Paris, en est la traduction symbolique. Cette politique renvoie à une logique de ségrégation urbaine. Les populations pauvres et immigrées, jugées dangereuses – implicitement – pour le corps social, sont exclues du territoire de la République et concentrées dans des banlieues que l’on voudrait closes. Typiquement, c’est la politique menée dans le passé par Jacques Chirac et Jean Tibéri à Paris. Songez qu’au cours des années 90 les offices HLM de la Ville de Paris n’achetaient plus de foncier sur Paris, mais uniquement en banlieue – afin d’éloigner les populations « allogènes » hors de Paris intra muros ! Songez que la politique parisienne des transports a consisté à casser les réseaux publics Paris / banlieue, afin que ces populations ne puissent plus rejoindre le centre de la capitale – au point que ce sont des entreprises privées qui assurent maintes liaisons sensibles entre Paris et les quartiers populaires de banlieue !
2. MAÎTRISER LA CIVILISATION URBAINE :
POUR UN REFORMISME RADICAL
AU SERVICE DES QUARTIERS POPULAIRES
Notre civilisation urbaine est violent et son évolution est mal maîtrisée. Le territoire de la République se
fragmente. On assiste, selon l’analyse de Jacques Donzelot, à une tripartition : d’un côté, les quartiers
riches des centre-villes « gentrifiés », avec une classe aisée qui a fait sécession du reste de la population et cherche à vivre « entre soi » ; à l’autre bout, les banlieues défavorisées, qui regroupent les exclus, cumulent les handicaps, dérivent hors du champ de la République ; au milieu, le territoire périurbain des classes moyennes, qui espèrent sans succès rejoindre les quartiers des classes aisées et
ont peur d’être rattrapées par la banlieue et le déclassement qu’elle symbolise. La République ne « fait
plus société » : elle se fracture en trois territoires, trois ordres, trois sociétés distinctes. Maîtriser la civilisation urbaine, c’est surmonter cette tendance à la fragmentation, mortelle pour le « vivre ensemble » collectif. Cela passe par le traitement des aspirations des classes moyennes périurbaines, que nous avons largement négligées par le passé : j’aurai l’occasion d’en reparler à une autre
occasion. Cela passe d’abord par le rattachement des quartiers populaires à la République. C’est ce que
je veux aborder aujourd’hui. Pour cela, si elles veulent surmonter les inégalités qui pèsent sur les quartiers populaires et enrayer la spirale de handicaps dans laquelle ils sont aujourd’hui enfermés, les politiques publiques doivent s’atteler à une véritable révolution. Cette révolution concerne tous les niveaux de l’action publique : le projet, les moyens, les politiques mises en œuvre.
Un projet pour les quartiers populaires : la renaissance républicaine.
La République doit reconquérir la banlieue. Elle peut le faire en y appliquant sa devise renouvelée : la liberté ordonnée, l’égalité réelle, la fraternité laïque. La liberté ordonnée.Il n’y a pas de liberté sans sécurité. Pour restaurer symboliquement cette sécurité, la tentation est forte de cristalliser sur des groupes particuliers, les « classes dangereuses », situées aux marges de la société, tout ce qu’une société porte de menaces. Les nouvelles « classes dangereuses », aujourd’hui, ce sont les « jeunes de banlieue », qui deviennent l’incarnation de la délinquance. Dès lors, garantir la liberté des citoyens se confond avec une politique répressive à l’égard de la banlieue. C’est toute la politique du Gouvernement. Cette politique conduit à une impasse. L’Etat répressif ne pourra que radicaliser des populations en rupture avec la société. La répression est certes nécessaire, car l’ordre républicain doit être respecté partout sur le territoire : on ne saurait accepter que certaines banlieues deviennent des territoires de non-droit. Mais la répression ne saurait suffire. Il faut éradiquer les causes de l’insécurité et des comportements délinquants des « jeunes de banlieue ». Ces causes sont à trouver dans l’absence de perspectives pour ces populations, dans les inégalités de destin qui grèvent leur avenir. Garantir une liberté ordonnée à tous, c’est leur redonner espoir dans leur destin.
L’égalité réelle, ou le « socialisme de l’émancipation ».Ceux qui naissent dans les banlieues défavorisées n’ont que peu d’espoir de réussite professionnelle, car le territoire où ils se réalisent cumule tous les handicaps. Pour garantir une réelle égalité de destins à tous les Français, pour remettre en mouvement la mobilité sociale et redonner un sens au pacte républicain dans les banlieues, je plaide donc pour l’invention d’un « socialisme de l’émancipation ». Le « socialisme de l’émancipation » repose sur l’égalité réelle au départ dans la vie sociale. Il ne s’agit pas d’une simple égalité juridique, qui se contenterait de distribuer les mêmes droits à tous. En soi, ce serait là, déjà, un progrès considérable pour les quartiers populaires, qui ont aujourd’hui
moins de moyens et moins de droits que les quartiers riches, alors qu’ils ont plus de besoin. Mais ce serait bien insuffisant. En effet, les habitants des banlieues défavorisées sont confrontés à une multitude de handicaps, et offrir des droits identiques pour tous ne permettrait pas de les surmonter. C’est pourquoi la collectivité publique doit rompre avec l’égalité en droit et concentrer ses moyens. Pour égaliser les destins, la seule solution est de donner plus à ceux qui ont moins, c’est-à-dire de fournir plus de services publics à ceux qui ont moins de capital hérité. Comment y parvenir ? C’est tout le débat sur la discrimination positive. Je n’aime pas ce terme, car il renvoie à l’expérience américaine. Or les discriminations positives « à l’américaine », sur une base ethnique ou religieuse, sont à proscrire. Elles sont contraires à notre tradition républicaine. Elles sont contraires à la Constitution, qui indique dans son article premier que la République « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». On peut craindre, de surcroît, que cette politique entraîne de vives réactions de rejet du corps social. Ce qu’il faut c’est donner plus à ceux qui en ont le plus besoin, ainsi les zones d’éducation prioritaires (ZEP) donnent davantage de moyens aux écoles situées dans des quartiers défavorisés. Cette approche est acceptable, car elle ne viole pas le principe d’égalité des citoyens. Elle est de plus logique, puisque les inégalités ont désormais une base territoriale. Même si, on l’a vu, elle n’est pas exempte d’effets pervers – notamment celui d’une stigmatisation des quartiers concernés, qui incite les classes moyennes à les fuir. Toutefois, mon sentiment est que la marche vers l’égalité réelle des destins devra aller plus loin. Elle doit aussi se faire sur une base individuelle : un enfant est issu d’un milieu défavorisé, il doit recevoir plus de la collectivité - quelles que soient ses origines, quel que soit le territoire où il habite. Bien sûr, statistiquement, les enfants en difficulté viendront surtout des banlieues pauvres et très peu des quartiers riches. Mais l’enfant en difficulté dans une ville aisée doit lui aussi avoir droit à l’attention publique. On construit ainsi un « droit de tirage social », fondé sur une différenciation légitime, car purement individuelle, et non ethnique, religieuse ou sexuelle.
La fraternité laïque.La fraternité est au cœur de la reconquête de la banlieue : il faut que des populations d’origine, de religion, de culture diverses aient envie de vivre ensemble, de « faire société ». Or ce « vivre ensemble » ne peut s’organiser que dans un espace laïc. La question de l’intégrisme est évidemment au coeur de ce débat. La République ne peut pas laisser la situation se dégrader plus avant. Les intégrismes de tous bords sont le signe d’un rejet politique du « vivre ensemble ». Ils visent à fragmenter la République en communautés distinctes. Le modèle républicain français n’est pas compatible avec une quelconque forme d’intégrisme communautaire. Dans ce contexte, une loi sur les signes religieux à l’école est peut être utile aujourd’hui pour répondre à l’appel de ces praticiens de la laïcité que sont les enseignants. Mais cette loi ne sera pas à elle seule une solution. Car c’est l’intégrisme qu’il faut combattre au moins autant que ses traductions les plus visibles. Il faut en combattre les moyens d’action et, de ce point de vue, la lutte contre les sources occultes de financement est indispensable. Il faut surtout en combattre les causes. C’est pourquoi il est nécessaire de lier la lutte pour le respect de la laïcité à une lutte intense pour empêcher les inégalités de se créer et de se creuser dans ces quartiers défavorisés. Ce sont les deux
faces d’une même pièce, les deux fronts d’un même combat. Car réclamer le respect de la République n’a aucun sens quand cette République n’est pas en mesure de garantir à tous les mêmes droits, quand le pacte républicain est rompu entre ceux qui en jouissent et ceux qui en sont exclus. Voilà, pour moi, un des plus grands défis de la période qui s’ouvre. Et pour y répondre, il faut accepter de réformer sans faillir.
Changer d’échelle dans les moyens publics consacrés aux quartiers populaires
On le sait, les financements actuels ne sont pas à la hauteur des enjeux. Deux pistes sont à explorer.
Il faut d’abord oeuvrer pour des finances locales plus justes.Je pense qu’il faut commencer par la suppression au moins partielle de la taxe d’habitation, cet impôt injuste qui rend pauvres les communes dont les habitants sont pauvres. La seule réforme de cette taxe me semble très difficile à mettre en oeuvre, à cause notamment des transferts de charges entre ménages et entre communes. C’est pourquoi je propose sa suppression et son remplacement par une dotation proportionnelle à la population de la commune. Je ne sous-estime pas l’importance des questions soulevées par l’autonomie financière des communes que certains pourraient ainsi trouver
entamée. Mais aujourd’hui l’enjeu est trop grand pour pouvoir tergiverser. Je propose ensuite de réformer la taxe professionnelle. Certains suggèrent une nationalisation. Un taux unique permettrait de redistribuer aisément le produit de la taxe entre les communes, là aussi en fonction du nombre d’habitants, avec un effort financier particulier pour les communes en grande difficulté. Je suis assez réticent face à cette approche : la nationalisation de la TP serait déresponsabilisante pour les collectivités locales, elle supprimerait toute incitation à développer les activités économiques. Je privilégie une autre solution, plus douce. Elle consisterait à transférer les mécanismes de péréquation au niveau des bassins d’emploi. La logique de l’espace urbain renvoie à une structuration par bassin d’emploi, entre “ communes de travail ” et “ communes d’habitat ”. Il est donc normal que la commune de travail qui concentre l’ensemble des produits de la TP la redistribue aux communes d’habitat qui hébergent les travailleurs assurant sa richesse. C’est d’ailleurs la logique qui préside à la TPU pour les communautés d’agglomération. Mais ceci ne fonctionne que si les communautés
d’agglomération couvrent les bassins d’emploi. Ce n’est notamment pas le cas en Ile de France où
le bassin d’emploi couvre pratiquement toute la région avec des emplois plutôt au centre et à l’ouest
et des habitants plutôt à l’est et au nord. Bertrand Delanoë est le premier maire de Paris à l’avoir
compris et à promouvoir la solidarité de l’espace francilien. Si l’on veut éviter un taux unique national,
une taxe professionnelle uniforme par bassin d’emploi représente une solution intéressante.
Il faut ensuite réformer la politique de la ville.Il faut maintenant passer à la vitesse supérieure. Nous sommes placés devant l’obligation d’investir massivement dans les cités. Le retard français en matière d’investissement en faveur des villes est patent : le dernier rapport du Conseil d’analyse économique indique que cet effort devrait être triplé pour atteindre le niveau allemand. Il faut également aller dans le sens d’une plus grande sélectivité des sites. Comme on l’a vu, la politique de la ville tend au saupoudrage. Nous devons y renoncer, et accepter la concentration territoriale des moyens. L’enjeu central, répétons-le, ce sont les 5 % des communes les plus pauvres. Il faut enfin résoudre le problème des « goulets d’étranglement » de la politique de la ville pour les communes les plus pauvres. Je propose trois mesures. Premièrement, la suppression du ticket modérateur : le financement des équipements locaux pour les banlieues défavorisées serait pris en charge à 100 % par l’Etat. Deuxièmement, il faut résoudre le problème de la TVA que doit débourser la commune. Troisièmement, je propose de faire porter par l’Etat, pour un temps, une partie du coût de fonctionnement des équipements réalisés dans le cadre de la politique de la ville, afin que ce ne soit plus un obstacle à l’investissement.
Réformer les politiques mises en œuvre : de grands chantiers pour demain.
Ces politiques doivent être guidées par deux grands objectifs. Premièrement, permettre aux individus
de s’émanciper, donner à tous les moyens de réussir. C’est l’objectif central. Mais il faut aussi émanciper
les territoires. On sait que la réussite individuelle peut paradoxalement avoir des effets négatifs sur
la situation du territoire, dans la mesure où elle entraîne la fuite de ceux qui réussissent et conduit ainsi
à un appauvrissement du territoire concerné. Nous devons faire en sorte que ces deux objectifs se rejoignent : les habitants qui réussissent doivent rester dans leur ville, non bien sûr par obligation, mais
par choix. Cela nécessite un traitement spécifique du territoire. Pour tendre vers ces objectifs - émancipation des individus, émancipation des territoires – je propose de travailler sur plusieurs grands chantiers :
Le premier des chantiers est celui de l’éducationTout d’abord, l’objectif qui doit guider la politique éducative est la concentration des moyens scolaires. Si par exemple un élève a besoin de 30 heures pour comprendre un cours de mathématiques prévu en 20 heures, il faut être capable de les lui donner. Claude Allègre avait tenté de développer des expériences dans ce sens : deux heures de rattrapage hebdomadaires en français et en mathématiques au collège pour les élèves en retard. Mais ce principe avait malheureusement été détourné, et les deux heures de rattrapage étaient devenues deux heures d’approfondissement pour les meilleurs élèves. La première piste est le renforcement des ZEP. Il s’agit évidemment de leur fournir beaucoup plus de moyens – moyens immobiliers, matériels (informatique notamment) et humains. Attirer les meilleurs enseignants dans les ZEP est crucial : cela passe une augmentation significative des primes et une valorisation du passage en ZEP dans leur carrière. Je propose ensuite que l’on étudie l’extension d’une initiative proche de celle qu’a prise l’Institut d’études politiques de Paris au profit des ZEP. Cette initiative a l’avantage de valoriser la scolarisation dans une ZEP et combat les effets de stigmatisation. Je suggère enfin que l’on étende l’expérience de la « terminale difficile » mise en place à Paris. Un lycée a en effet créé à la fin des années 1980 une terminale scientifique, réservée aux élèves en rupture scolaire rejetés de tous les autres lycées. Cette expérience a permis une véritable concen-tration des moyens associée à l’obligation de rester en internat. Le résultat est parlant : à l’arrivée, il y a eu 100 % de réussite au bac. Autant le « busing » américain s’est avéré inefficace, car il instaure une mixité sociale superficielle, les élèves favorisés et les élèves défavorisés coexistant sans vraiment se mélanger ; autant une politique volontariste d’internat pourrait être pertinente : elle conduit les élèves de banlieue à sortir d’un milieu socio-urbain défavorable, et permet une concentration à leur profit des meilleurs moyens éducatifs.
Le deuxième chantier est celui du logementIl faut en premier lieu repenser la politique de logement social, et ce d’un double point de vue. Du point de vue quantitatif, tout d’abord. La politique de destruction / reconstruction des barres dégradées commencée par le gouvernement de Lionel Jospin, est vitale. Il faut en accélérer le rythme et dégager des crédits budgétaires en ce sens. Mais une telle politique est insuffisante : on ne peut se contenter de « dorer le ghetto », comme on le dit aux Etats Unis. Derrière l’amélioration apparente des lieux, la condition réelle des habitants demeure largement inchangée. Les tours et les barres symbolisent la concentration de la pauvreté, elles ne la créent qu’en partie.
Il faut agir ensuite au point de vue qualitatif , en développant une politique de grands appartements.
A l’heure actuelle, les HLM ne s’engagent pas dans cette voie, car elle est moins rentable.
Or la réussite scolaire est largement tributaire de l’espace consenti à l’enfant pour qu’il puisse travailler
dans des conditions optimales. Les recherches d’Eric Maurin, en particulier, ont montré que
70 % des élèves – quel que soit le niveau social - qui ne disposent pas d’une chambre individuelle où ils puissent s’isoler pour faire leurs devoirs sont en retard scolaire en 3 ème. Par ailleurs, l’accession à la propriété doit être encouragée. L’objectif d’une politique visant à encourager
l’accession à la propriété est de recréer des petites zones pavillonnaires à côté des barres
HLM, afin de fixer les classes moyennes dans les quartiers populaires et d’éviter que « ceux qui
réussissent » ne fuient hors de la cité. Pour ce faire, on peut imaginer un dispositif très incitatif
d’aide à l’accession à la propriété dans les banlieues défavorisées. L’Etat prendrait en charge une
partie de l’achat, par exemple sous forme d’un impôt négatif du type « prime pour l’emploi ». Cela
équivaudrait en quelque sorte à un décalque de la loi Périssol / Besson / Robien : mais au lieu de
payer les riches pour loger les pauvres, on aiderait directement les ménages modestes. Un dispositif
complémentaire de prêt à taux nul permettrait de financer le reste de l’achat. Enfin, l’Etat pourrait
offrir une garantie auprès des banques, afin de sécuriser les accidents de la vie comme le chômage
ou le divorce et d’éviter ainsi les risques de surendettement et les refus bancaires.
Le troisième chantier est celui de l’emploi dans les quartiersL’une des priorités est la lutte contre les discriminations à l’embauche. Depuis 2002, le FASILD a signé, à cette fin, quelques chartes avec des grandes entreprises. La création d’une agence nationale contre les discriminations serait utile : elle aurait pour mission de faire appliquer les textes existants, notamment la loi de 2001. On peut aller plus loin, et imaginer que des entreprises qui bénéficient de contrats publics se voient imposer des conventions très précises sur leurs engagements en matière de lutte contre les discriminations, et doivent par exemple démontrer leurs
efforts pour recruter et former des jeunes des quartiers défavorisés. Il faut par ailleurs encourager directement le développement économique et la création d’emploi dans les quartiers. La mixité habitat/économie est aussi importante que la mixité sociale. Il faut avant tout revitaliser les commerces, que ce soit les petits centres commerciaux ou les pieds d’immeuble. Ces espaces créent un tissu indispensable à la vie du quartier. Dans cette optique, il faut imaginer des mécanismes permettant d’aider le transfert des baux commerciaux, la réhabilitation de locaux, ou la formation des commerçants. Il faut également inciter les initiatives locales d’emploi en développant les services d’aide au crédit ou au micro-crédit pour les habitants porteurs de
projets d’activité.
Le quatrième chantier est celui de la mobilité géographiqueRéduire la distance physique contribue à réduire la distance sociale. L’excellent rapport du CAE déjà cité, dont je crois utile de reprendre plusieurs propositions, parle de rétablir la « connexion sociale ». Les allers-retours entre la cité et le reste de la ville sont des facteurs de désenclavement pour les quartiers et les habitants. Mobilité sociale et mobilité géographique sont ainsi complémentaires. C’est pourquoi il faut mettre en place une politique de transport adaptée aux populations qui sont contraintes de résider dans des quartiers mal reliés aux zones d’activité économique. C’est ce que Jean Paul Huchon a entrepris en Ille de France et c’est ce qu’il se propose à juste raison de développer.
Une seule méthode : plus de démocratieChacun espère faire des habitants des quartiers les acteurs du changement souhaité. Et actuellement, une des causes de l’échec de la politique de la ville réside dans la faiblesse de la participation démocratique.
Mais nous sommes ici devant un paradoxe en souhaitant que les populations les plus en difficulté participent et s’investissent alors que c’est justement ce qu’elles peuvent le moins facilement faire ! Il faudra donc aller au-delà de ce qu’on fait pour les « conseils de quartier ». Il faudra leur donner de véritables pouvoirs, pour que l’apprentissage de la démocratie se fasse au plus près des préoccupations quotidiennes. Et, comme cela a été fait dans quelques endroits, il faudra pour cela les
doter de moyens propres.
L’objectif doit être de permettre à ces populations de réinvestir la vie collective, avant de réinvestir la vie politique. Le retour du vote dans ces quartiers est un impératif démocratique, qui seul permettra par la suite un véritable réinvestissement de la vie politique nationale. Mais avant même de
revenir au vote, il y a du chemin à parcourir.
Voilà le sens d’un combat politique. La déshérence des quartiers populaires serait un immense gâchis
car les potentiels y sont nombreux et les talents variés.
Nous ne devons plus accepter cette image de la banlieue colportée par les clichés collectifs. Les habitants ne le supportent plus. « Quand donc laisserons-nous les mots, pour nous intéresser aux choses ? », disait Pétrarque. En effet, derrière les mots, les idées reçues, il est une réalité dont on ne parle pas assez , celle de quartiers où l’on bouge, où l’on innove, où l’on réussit. Il est grand temps de valoriser, enfin, cette réussite.
Les quartiers populaires ont des atouts importants, et notamment sa jeunesse : la population y est plus
jeune qu’ailleurs dans notre France vieillissante. Quel sort maléfique a pu convertir un tel avantage en
faiblesse ? Il faut maintenant rompre avec le cliché du « jeune de banlieue », qui déforme une réalité
qui est bien plus prometteuse qu’on ne le croit.
Il y a dans les quartiers, une “majorité silencieuse” qui réussit, et surtout qui respecte la République,
ses valeurs essentielles. Cette majorité silencieuse n’attend qu’une chose, qu’on lui reconnaisse le droit
de s’intégrer, et qu’on lui offre, au-delà de ce droit, des perspectives viables et solides. N’abandonnons
pas cette majorité, ne la laissons pas se faire prendre en otage par une minorité qui pourrit la vie du
plus grand nombre.
Laisser s’éloigner aujourd’hui de la vie collective les habitants des quartiers populaires, c’est courir le risque de voir la République se désintégrer demain. Ces quartiers sont des hauts lieux d’innovation et
de création. Quel plus bel engagement politique que de valoriser cette jeunesse qui ne demande qu’à
réussir pourvu qu’on lui en donne les moyens ?
C’est une des grandes missions du socialisme d’aujourd’hui : faire renaître la promotion sociale en
donnant à chacun la chance de maîtriser son destin.
|