Le temps
du retour est là
Congrès de Dijon - 17 mai 2003
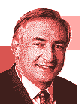
Discours de Dominique Strauss-Kahn, député du Val-d'Oise
Tribune du Congrès de Dijon
Tribune du Congrès de Dijon
Le temps | 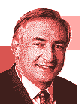 |
Discours de Dominique Strauss-Kahn, député du Val-d'Oise Tribune du Congrès de Dijon | |
 Mes camarades, mes amis, Mes camarades, mes amis, ce congrès, chacun le voit, se tient dans un contexte qui est bien particulier. Il y a celui de la mondialisation qui continue de faire des ravages, il y a celui par l'Europe qui piétine, mais il y a surtout celui de la France qui recule. Car c’est bien un recul, un recul pour la gauche et donc un recul pour la France, que nos idées soient aujourd’hui à ce point combattues, qu’il faille que les salariés soient dans la rue pour se battre pour les services publics et pour les retraites qui sont partie constitutive de la République que nous avons créée, ces retraites qui sont au cœur du mouvement social aujourd’hui. J’entends, sur ce sujet, une chose qui est vraie et deux choses qui sont fausses. La première, qui est vraie, c’est qu’il fallait traiter le problème, et de point de vue il n’est pas critiquable de vouloir l’aborder. D’ailleurs, Lionel Jospin l’avait dit dans la campagne présidentielle : la première année de la mandature serait celle où il faudrait traiter le problème des retraites. Mais ce qui est faux, d’abord, c’est de dire aux socialiste, et je l’entends partout, même dans nos rangs : « Vous n’avez rien fait sur les retraites. » Mes camarades, ceci n’est pas exact. Soyons fiers de notre bilan, ne nous laissons par emporter par la vague que la droite charrie. Quand a été créé le fonds de réserve des retraites, a été mis en place une contribution au problème des retraites qui est l’équivalent des trois quarts de ce que la droite fait aujourd’hui avec son plan, sans qu’il y ait de mouvement parmi les salariés, tout le monde approuvant cela. Voilà le consensus que nous avions créé. Et si les trois quarts ce n’est rien, qu’est-ce que c’est que le plan Fillon ? Nous avons fait cela alors que, chacun s’en souvient, Alain Juppé avait laissé le dossier des retraites dans un tel état que la France entière était à ce point exacerbée qu’il était impossible d’avancer. Et il fallait d’abord que nous soyons capables, tous ensemble, de recréer un consensus social pour pouvoir bouger. Et le consensus social, c’était sur le chômage. Et sur le chômage, le gouvernement de Lionel Jospin a fait ce qu’aucun gouvernement avant lui n’avait jamais réalisé. Nous avons recréé ce consensus, nous avons recréé les conditions d’avancée sur les retraites. Mais aujourd’hui, on le voit bien, cette confiance est cassée. Un an de gouvernement Raffarin, et la confiance n’est plus là. Ce n’est plus la confiance qui a été créée, c’est l’insécurité sociale dans laquelle vit notre pays. L’assurance maladie est un déficit, le chômage repart et malheureusement risque d’exploser, la litanie des plans sociaux envahit les journaux et le gouvernement lui-même casse les instruments de la politique de l’emploi. Mes camarades, nous ne le dirons jamais assez, en supprimant les emplois-jeunes, en limitant les contrats emplois-solidarité, en faisant pratiquement disparaître le programme Trace qui servait les populations les plus difficiles, ce sont 550 000 emplois que les députés de l’UMP ont supprimés dans la loi de finance. Mes camarades, le plus grand plan social dans ce pays, c’est celui du gouvernement. Nous devons refuser d’accepter 550 000 emplois perdus par la politique de ce gouvernement. Et ceci évidemment empêche d’avancer sur ce dossier qui est crucial et qui est celui des retraites. Comment ne pas comprendre l’anxiété des manifestants qui disaient, il y a deux jours encore, lorsqu’ils étaient dans la rue : « Aujourd’hui, c’est les retraites, et on ne sait pas ce qu’on nous prépare demain sur l’assurance maladie », qui disaient : « On veut savoir où on va. » C’est dans la globalité que cette question sociale doit être traitée, et pas techniquement, morceau par morceau. Oui, Jean-Luc, tu as raison. La question n’est pas une question technique. La question des retraites est une question politique. Et c’est la politique d’ensemble de ce que fait ce gouvernement dans le domaine social qui est en cause. La deuxième chose qui est fausse, c’est de dire : si vous aviez été au pouvoir, vous auriez fait pareil. Non, mes camarades, nous n’aurions pas fait pareil. Il y a bien d’autres voies. Certaines ont été annoncées avant moi. On peut en discuter. Je vous propose la plus simple : la contribution au problème des retraites, de ce que fait ce mauvais plan Fillon, c’est 13 milliards d’euros par an, mes camarades. Ce que Jacques Chirac a promis, dans la baisse de l’impôt sur le revenu, c’est une perte de 18 milliards d’euros de recettes. Alors voilà, la solution est simple : il ne faut pas toujours être contre la baisse d’impôts. J’en ai fait moi-même : la baisse de la TVA sur le bâtiment a été une bonne chose pour le pays. Mais lorsqu’il faut faire un choix politique, c’est devant celui-là que nous sommes, et qu’il faut affecter des ressources. Alors il faut savoir où nous voulons aller. Voulons-nous que notre pays fasse le choix politique de baisser les impôts pour les plus riches de 18 milliards d’euros par an, ou que ces recettes soient mises à la disposition des retraites pour qu’on avance dans la solution du problème des retraites, sans avoir besoin de passer par les mesures que proposent M. Fillon ? La nature de ce gouvernement ne fait de doutes pour personnes. Jean-Pierre Raffarin prend dans la poche de tous et surtout des plus pauvres, de ceux qui ont des petites retraites, pour donner à ceux qui sont les plus riches au travers de la baisse d’impôt. C’est la pratique de Robin des Bois, mais pour Raffarin, c’est le Robin des Bois des riches, et ça, nous n’en voulons pas. C’est dans ce contexte que se situe notre congrès. C’est dans ce contexte que le congrès marque le retour des socialistes sur la scène politique. Sans doute fallait-il attendre en peu, sans doute était-il démocratique de laisse à une nouvelle majorité le temps de s’exprimer. Mais aujourd’hui le temps du retour est là. Il est là parce que ce congrès a clarifié nos positions. Il est là parce que ce congrès nous a rassemblés. Et depuis le début du congrès, j’apprécie que quelles que soient les divergences des débats que nous pouvons avoir, ce soient tous les socialistes qui mènent ensemble le même congrès. Ce congrès, c’est le 73ème de l’histoire des socialistes, et pour moi, c’est un congrès majeur. C’est un congrès majeur parce que c’est un congrès où nous avons fait majoritairement le choix du réformisme, le réformisme de gauche qu’a lancé François Hollande. Vous me direz : « Mais nous sommes tous des réformistes ». Oui, sans doute, mais pas dans nos textes. Nous ne l’avons jamais été, depuis le début. Quand en 1920, une partie des socialistes ont quitté la vieille maison, comme l’appelait Léon Blum, pour aller créer le Parti communiste, la Troisième internationale, ce n’était pas parce que les uns étaient des révolutionnaires et les autres des réformistes. Tout le monde avait un discours révolutionnaire. Mais c’était pour refuser le centralisme démocratique, pour refuser un parti bolchevique. Et pendant toute la suite, notre discours est souvent resté ce discours révolutionnaire, à tel point qu’en 1946, au 28ème congrès de la SFIO, ce fameux discours qu’évoquait Yvette Roudy tout à l’heure, ce discours où Léon Blum dit aux camarades : « Vous avez peur de la nouveauté », c’est vrai, Yvette. Mais il leur dit aussi : « Vous avez peur d’être vous-mêmes, vous avez peur toujours que les communistes vous montrent du doigt et vous traitent de sociaux traîtres. Vous prenez un discours qui est plus à gauche que ce que vous croyez ou ce que vous voulez pour coller à la parole des communistes. Mais la gauche, dit Léon Blum, ce n’est pas de coller à ceux qui se prétendent plus à gauche que nous. La gauche c’est d’être nous-mêmes, de dire ce que nous voulons, de faire le choix du réformisme. » Dans ce congrès, Léon Blum, Daniel Mayer le perdent. C’est Guy Mollet qui gagne. Et le discours est révolutionnaire, et on connaît la suite : un discours extrême, toutes les compromissions dans les pratiques. Aujourd’hui, oui, Léon Blum, les socialistes à Dijon majoritairement te le disent : nous sommes nous-mêmes ! C’est comme cela que nous unirons la gauche, pour unir la gauche, pour tendre la main, pour organiser avec les autres la confédération dont nous avons besoin, nos partenaires communistes, nos partenaires verts, nos partenaires radicaux. Il faut que nous sachions d’abord clairement qui nous sommes. Et dans ce congrès, nous le disons. Nous le disons et nous pouvons reprendre, à la racine, le combat qui est le nôtre, le combat qui fonde notre engagement, celui de vous tous, mes camarades, celui qui i été le mien quand j’ai adhéré il y a plus de vingt-sept ans au Parti socialiste, c’est le combat de la lutte contre les inégalités, et pas seulement dans les discours, pas seulement dans le discours égalitariste, pas seulement dans les bonnes intentions. Le discours, c’est nécessaire, mais nous devons venir, mes camarades, plus profondément à l’action contre les inégalités. Je suis choqué, comme vous sans doute, de ce qu’après cinq ans au pouvoir, même si nous sommes fiers de ce que nous avons fait, que les inégalités aient si peu reculé, et dans certains domaines aient même augmenté. C’est, je le crois, que nous n’avons pas attaqué les inégalités là où elles se créent. Prenez l’école, mes camarades. Quoi de plus sacré pour les socialistes et pour la gauche que l’école ? L’école a été pendant des décennies l’endroit où s’est créée l’égalité. C’étaient les hussards de la République. Et nous le savons, depuis vingt ans, vingt-cinq ans, l’école est le creuset des inégalités. L’école crée les inégalités parce que les villes ne sont pas aussi riches les unes que les autres, et les écoles dans les villes pauvres sont moins bien tenues, moins bien dotées. Les enfants de Vaulx-en-Velin ont autant le droit à de belles écoles que les enfants de Neuilly, mais les moyens, nous ne les avons pas. Quand ils rentrent chez eux, ces enfants, le milieu culturel dans lesquels ils sont n’est pas le même qu’ils soient à Vaulx-en-Velin ou qu’ils soient à Neuilly, qu’ils soient à Sarcelles ou qu’ils soient dans les beaux quartiers parisiens. Ces enfants n’ont pas le même environnement, ils n’auront pas les mêmes résultats scolaires. Tous les rapports que l’on connaît le montrent. Avoir une chambre où l’on peut faire seul ses devoirs est une condition de la réussite scolaire. Mais qui, partout dans les banlieues, dans les cités ouvrières, une chambre pour faire ses devoirs tout seul ? Alors, les inégalités réelles sont là. C’est contre celles-là qu’il faut lutter. Mes camarades, les enfants de Vaulx-en-Velin ne sont ni plus feignants, ni plus idiots que ceux de Neuilly, mais les résultats ne seront pas les mêmes. Sur le marché du travail, ils ne seront pas dans la même situation. Et nous, la gauche, nous avons mis en place des instruments pour les aider lorsqu’ils ne pourront pas entrer sur le marché du travail. Nous avons organisé, et c’est notre fierté, depuis des décennies partout en Europe, un formidable système de redistribution, et nous avons eu raison de le faire, mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. La gauche, cela ne peut pas être simplement corriger les inégalités que le marché a créées en acceptant qu’il les crée pour les compenser ensuite. La gauche, cela doit être attaquer au cœur du système productif, là où se créent les inégalités, et empêcher qu’elles se créent, et d’abord à l’école. Mes camarades, nous sommes fiers de cette redistribution. Elle ne suffit pas, les faits le montrent. Il faut aller attaquer là où se produisent les inégalités. J’ai parlé de l’école, j’aurais pu parler de la santé, j’aurais pu parler du logement. Là où se créent les inégalités, à la production même, il nous faut attaquer ce que sont ces nouvelles inégalités. Comme moi, mes camarades, dans les campagnes de mai et de juin dernier, vous avez rencontré des hommes et des femmes qui vous disaient : « J’ai des petits revenus. Je suis smicard, je suis de gauche. Ce que vous avez fait pour les exclus, vous avez eu raison de le faire et comme vous, je le soutiens. Mais pour moi qui suis dans le monde du travail, qu’est-ce que vous avez fait ? » Et nous n’avions pas grand-chose à lui répondre. Mes camarades, oui, nous devons revenir vers ce monde du travail, revenir vers la production, revenir vers ce qui a fondé le combat des premiers socialistes, ne pas nous limiter, même si c’est absolument nécessaire, à ce que nous faisons pour compenser les méfaits du capitalisme après coup. Il faut l’attaquer dans son cœur, et c’est cela le combat qui commence maintenant. Mes camarades, ce congrès est un congrès de rassemblement, c’est aussi, je l’ai dit, un congrès de principe. Ce doit être un congrès où commence à s’élaborer notre projet. Nous sommes tous d’accord, notre objectif est la reconquête des classes populaires. Nous sommes tous d’accord, notre objectif, c’est plus de radicalité. Mais la radicalité, si cela veut dire quelque chose, c’est prendre les choses à la racine. Alors il faut partir à la reconquête des classes populaires, là où sont leurs problèmes quotidiens, à l’école, à l’hôpital, dans le logement, prendre concrètement ces questions, prendre tranche par tranche ce que le socialisme peut créer. N’ayons pas peur de mettre les mains dans la glaise, n’ayons pas peur de réformer étape par étape, ne faisons pas rêver sur ce qui pourrait arriver dans cent ans, regardons ce que nous ferons dans quatre ans si nous sommes capables de convaincre les Français. Mes camarades, c’est cette nouvelle question sociale qui pour nous est l’enjeu principal, ces nouvelles inégalités à attaquer là où elles se créent, comme ces nouvelles inégalités qui taraudent la société française dans la discrimination à l’encontre de ceux qui sont des immigrés de la première ou de la deuxième génération, qui sont français et qui ne veulent pas parler ou entendre parler d’intégration car ils sont français, mais qui veulent cesser d’être discriminés, cesser de subir ces inégalités nouvelles. Et c’est notre combat, peut-être un des plus importants des années qui viennent, que d’être capables de faire en sorte que, quand les socialistes sont dans la rue, ceux qui sont chez nous parce qu’ils sont français et qui sont nés de parents venus de l’immigration se reconnaissent en nous et disent : « Je suis socialiste avec vous, parce que vous menez le même combat que moi. » Mes camarades, un dernier mot pour finir. La S.F.I.O., la vieille maison, ce vieux parti avait bien des défauts, mais elle avait une qualité. Cette qualité, c’était que ses membres se disputaient, ils se tapaient dessus, mais il y avait entre eux la fraternité des socialistes. Mes camarades, nous sommes les champions de la solidarité, mais nous ne convaincrons pas les Français que la solidarité que nous prônons vaut mieux que l’individualisme si, en notre sein, nous ne savons pas vivre cette solidarité et cette fraternité. Mes camarades, ce à quoi je vous invite dans ce congrès, c’est à ce que, comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant, nous puissions ensemble saluer le large succès de la motion qui a été conduite par François Hollande, parce que ce large succès permet le rassemblement. Et parce qu’il permet le rassemblement, il permet de faire de ce congrès ce que je souhaite pour ma part qu’il soit, pour tous les socialistes, le congrès de la fraternité. |
|
|
 |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
| ||