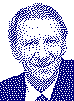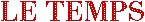| | On parle beaucoup, depuis l'arrivée au pouvoir du New Labour à Londres en juin 1997, de la troisième voie, à mi-chemin entre étatisme et ultralibéralisme. Le gouvernement Blair entend y convertir ses partenaires européens. Quelle est votre définition personnelle de la troisième voie ?L'expression troisième voie a été utilisée pour la première fois en France à la fin du XIXe siècle, pour être reprise épisodiquement par plusieurs générations de sociaux-démocrates. A l'origine, la troisième voie, c'est l'issue de secours entre le capitalisme américain et le communisme soviétique. Au début des années 70, cela signifiait aussi «socialisme de marché», mais aujourd'hui l'expression n'a plus vraiment cette signification, trop teintée d'idéologie.
Ce qu'elle signifie aujourd'hui est assez simple : comment répondre au dilemme politique posé par l'antagonisme dépassé entre deux écoles de pensée. D'un côté, les vieilles social-démocraties, fatiguées et obsolètes, bureaucratiques et keynésiennes et qui continuent à circonscrire le champ politico-économique dans les seules limites de la nation. A l'opposé, les politiques de ce que j'appelle la «nouvelle droite» sont marquées par une sorte de fondamentalisme du marché qui ne répond plus aux difficultés actuelles. Il faut donc une troisième voie, différente des deux philosophies que je viens de mentionner. D'ailleurs, de manière générale, je préfère le terme de «politiques de la troisième voie». L'expression troisième voie utilisée seule fait un peu formule magique… Ce que nous cherchons aujourd'hui, à mon sens, est de redéfinir les valeurs sociales-démocrates dans un monde globalisé, c'est-à-dire en acceptant la redéfinition philosophique de la notion de frontière. La dimension de la réflexion que cela implique dépasse le cadre de la nation.
Cette troisième voie est-elle déjà appliquée par l'un des treize gouvernements de centre gauche de l'Union européenne ?Les politiques de la troisième voie impliquent d'abord un sérieux lifting des social-démocraties. Et il n'existe à l'heure actuelle aucun parti de centre gauche au monde qui ne soit pas en train de se transformer profondément. Tout simplement parce qu'ils ne peuvent plus continuer à utiliser les mêmes vieilles recettes de la fin des années 70. Dans ce sens, le gouvernement français de Lionel Jospin, tout comme d'autres exécutifs européens (allemand, italien), n'est finalement pas très éloigné de la conception de la troisième voie que nous défendons ici. Mais n'allez pas croire que le concept soit neuf ! L'évolution interne des social-démocraties dure depuis quinze ans, depuis le début des années 80, quand elles ont constaté que, devant l'ampleur des changements du monde, elles devaient modifier leurs idées si elles entendaient revenir un jour au pouvoir. Depuis, le débat a évolué à grande vitesse au niveau planétaire et concerne désormais tout le monde. D'une certaine manière, la question de la troisième voie est aussi celle de Pékin, de la Corée du Sud ou de l'Amérique latine. Il s'agit d'inventer des garde-fous, de nouveaux systèmes de protection sociale face à la sauvagerie du grand marché mondialisé, et de réorganiser la société autour de ces nouvelles données de base que personne ne conteste. En d'autres mots, accepter la réalité de la globalisation ne signifie pas qu'il faille abdiquer la défense de certains acquis sociaux.
A la limite, la troisième voie pourrait en fait tout aussi bien être prônée par des gouvernements se réclamant du centre droit ?Je ne le pense pas. La substance du débat consiste à savoir comment les valeurs du centre gauche peuvent être amendées, puis appliquées à un monde globalisé. Dans mon esprit, la globalisation ce n'est pas uniquement un grand marché sans frontières, mais aussi et peut-être surtout une transformation complète de notre mode de vie, qu'il s'agisse des mutations de la famille, des structures gouvernementales, des systèmes de communications, des changements culturels. Bref, des mutations qui ont lieu à un échelon infiniment supérieur à celui de l'Etat-nation tel que nous le pratiquons.
La question est de savoir comment réorganiser une société qui prenne en compte la nécessité de protéger les plus démunis et de limiter les inégalités tout en acceptant la majeure partie des nouvelles règles «globales». Dans ce sens, les valeurs de la troisième voie relèvent davantage du centre gauche que de l'autre bord. Je note, il est vrai, que, même si gauche et droite continuent à définir leurs identités respectives par opposition mutuelle dans un certain nombre de dossiers, la globalisation aurait tendance à les rapprocher. La lutte contre la délinquance juvénile, le manque de sécurité, est aujourd'hui identique à gauche comme à droite. D'abord parce qu'il n'existe plus à proprement parler d'alternative socialiste cohérente.
On peut aussi se demander comment, dans une économie globalisée, prendre en compte non seulement les nécessités purement économiques mais aussi les valeurs sociales. Le débat n'est pas nouveau, mais cette fois-ci le monde change si vite en restructurant si fondamentalement nos vies que le défi prend une autre dimension, elle aussi globale. Prenez par exemple les politiques de la famille, c'est un sujet essentiel. Un changement structurel majeur touche la famille partout dans le monde, les relations homme-femme évoluent à toute vitesse, comme celles entre les parents et leurs enfants. Que signifie par exemple pour l'avenir un taux de natalité de 1,2 en Italie? On le constate, ces thématiques dépassent le simple cadre gauche-droite du spectre politique.
La presse britannique fait de vous le gourou informel de Tony Blair ; vous êtes donc particulièrement bien placé pour nous dire si la Grande-Bretagne post-thatchérienne, avec ses expériences ultralibérales parfois dramatiques, n'est pas un champ d'essai idéal pour une troisième voie… Plus par exemple que la France ou l'Allemagne, où les partis sociaux-démocrates n'ont pas encore totalement effectué leur aggiornamento libéral ?Le Royaume-Uni a besoin d'un processus de modernisation à deux niveaux, parallèles et complémentaires. Nous devons d'abord modifier notre système constitutionnel, très en retard par rapport à ceux des pays continentaux. C'est ce que le gouvernement Blair a commencé avec la prochaine réforme de la Chambre des lords, un projet d'élections législatives au système proportionnel, et la décentralisation du pouvoir (Ecosse, pays de Galles, Londres). Mais la seconde modernisation est à mes yeux bien plus importante, et elle est identique en Grande-Bretagne et ailleurs. Il s'agit de répondre au déficit sans cesse grandissant de la légitimité politique, que l'on constate partout, aussi bien en Europe qu'en Amérique du Nord. Les citoyens ont perdu confiance en leurs représentants. Il faut travailler sur un nouveau pacte entre gouvernants et administrés, «reconstruire» les exécutifs pour qu'ils répondent davantage aux soucis de leurs électeurs, tout en impliquant la société civile dans le processus de consultation. Il existe bien entendu des données spécifiques à la Grande-Bretagne, mais, très franchement, je pense que c'est exactement le même genre de questions qui se posent aujourd'hui à Paris et Bonn.
Avec cette troisième voie, Tony Blair a séduit la droite libérale française et agacé les ailes gauches des partis socialistes européens. Il semble plus proche de l'Allemand Gerhard Schröder. L'axe traditionnel Paris-Bonn (Berlin) pourrait en souffrir.Il existe une nouvelle génération de dirigeants européens que Schröder vient de compléter par sa récente victoire électorale. Il y aura donc inévitablement de nouvelles coalitions entre les pays, même si la Grande-Bretagne ne peut pas pour le moment «entrer» de plain-pied dans l'Europe en raison de sa non-participation à l'euro. Mais je suis certain que le Royaume-Uni jouera un rôle central à l'avenir dans la construction européenne. Celle-ci ne sera plus animée par le seul moteur franco-allemand, mais plutôt par un réseau renforcé d'Etats partageant les mêmes valeurs fondamentales. A mon sens, la question essentielle est de savoir quel genre de politiques ces quatre pays clés de l'Europe que sont la France, l'Allemagne, l'Italie et le Royaume-Uni appliqueront à l'avenir et si l'on pourra coller l'étiquette troisième voie sur leurs décisions. Je sais qu'il existe encore de profondes suspicions vis-à-vis de Tony Blair dans les rangs de certaines ailes gauches des partis sociaux-démocrates, qui le prennent pour un clone de Thatcher déguisé en socialiste. C'est à Blair de leur prouver qu'il ne s'agit pas de cela. En tout cas, dans le seul contexte britannique, la différence est claire.
Sur quelles politiques de troisième voie Blair et ses partenaires européens peuvent-ils s'entendre. L'emploi ?Tous les partis sociaux-démocrates actuellement au pouvoir en Europe essaient de trouver un compromis raisonnable entre la création d'économies dynamiques et compétitives et le souci de réduire le chômage. Le temps est révolu où l'on combattait le chômage avec la seule arme des subventions étatiques. Il faut une économie en croissance dans laquelle le gouvernement joue certes un rôle, mais en aucun cas celui de créer lui-même les emplois. Dans cette optique, il me semble que l'idée de réduire le temps de travail par des lois est erronée. On ne peut plus répondre aux questions d'aujourd'hui par les solutions toutes faites d'autrefois, ne serait-ce qu'en raison du bouleversement de la structure des classes sociales. Moins de 20 % de la population fait aujourd'hui partie de ce que l'on avait coutume d'appeler la «classe ouvrière», contre 50 % il y a seulement vingt ans. Aux Etats-Unis, c'est la classe moyenne elle-même qui se transforme en middle class «info-tech», complètement différente de l'ancienne classe moyenne – parce que ses lieux de travail sont décentralisés et que l'on ne communique plus que par PC interposés. C'est toute une population (notamment en Californie) qui travaille dans des environnements flexibles. Résultat, la vision gauche-droite du monde a disparu pour ces gens-là. Aux sociaux-démocrates de s'adapter à ces nouvelles conditions: leurs électeurs ne sont plus les mêmes qu'autrefois. La base électorale traditionnelle, l'ancrage syndical ne signifient plus grand-chose.
Il y a tout juste un an le gouvernement Blair lançait un programme de lutte contre le chômage chez les jeunes intitulé New Deal. Un projet caractéristique de la troisième voie dans le sens où il entend mettre un terme à l'assistanat par des politiques volontaristes de «remise au travail», menaçant même les réfractaires de suppression pure et simple des allocations chômage, parce que «le travail n'est pas seulement un droit, mais aussi un devoir».
Cela fonctionne-t-il ?La troisième voie n'est pas une formule magique que l'on emploie pour résoudre d'un coup des questions aussi complexes que le chômage. Le défi est de reconstruire des systèmes de sécurité sociale viables et justes sans vider les caisses de l'Etat tout en créant des conditions-cadres pour la croissance économique. Nous essayons de réfléchir aux nouvelles manières de réagir à la profonde mutation des structures mêmes du travail. Ce n'est plus seulement une équation entre emploi et sans-emploi, mais une question globale. Comment traiter de la place des femmes dans le monde du travail, de l'impact du travail sur la famille ? Comment redéfinir les rapports entre les sexes quand autant de femmes que d'hommes travaillent, comme c'est le cas au Royaume-Uni ?
Premier élément de réponse, le salaire minimum que le gouvernement Blair va prochainement introduire. Il faut accepter l'idée d'un marché du travail dynamique parce que flexible. Ce qui signifie, pour un certain nombre de pays européens, moins de régulations. Dérégulation ne signifiant pas forcément, dans mon esprit, diminution de la protection sociale. La dérégulation du travail favorise en général la création de nouveaux emplois. La London School of Economics a effectué une recherche sur ce thème, qui prouve qu'il faut à tout prix essayer d'échapper à ces situations insensées où les chômeurs préfèrent attendre patiemment leurs maigres allocations à la maison au lieu de chercher du travail.
Encore faudrait-il qu'ils trouvent des places de travail…Mais elles existent ! Si l'on prend en compte le volume total de travail créé, on comprend mieux quel est le fond du problème européen dans le domaine de l'emploi. En Allemagne par exemple, de nombreuses heures de travail ont été créées ces dernières années pendant que le taux de chômage ne cessait de progresser, mais elles ont été «réservées» presque exclusivement à certains corps de métier où le niveau de protection sociale était déjà particulièrement élevé.
A l'inverse, il n'y a pas eu création d'autant d'heures de travail supplémentaires aux Etats-Unis, mais elles ont été beaucoup mieux réparties, notamment par l'utilisation du travail à temps partiel. En réalité, il y a beaucoup plus de pertes d'emplois nettes aux Etats-Unis, mais on les recrée de manière différente. L'une des questions cruciales pour les pays de l'Union européenne est de savoir si l'on accepte ou non cette flexibilisation, que d'aucuns confondent volontiers avec précarisation. Aux Etats-Unis, on change en moyenne cinq fois plus souvent d'emploi qu'en Europe. Il en résulte bien sûr une plus grande instabilité sociale, que l'on retrouve dans un taux de divorces plus élevé.
|