Rendre la gauche possible
seconde partie
 Benoît Hamon  Arnaud Montebourg  Christian Paul  Vincent Peillon  Geneviève Perrin-Gaillard  Barbara Romagnan 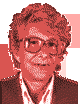 Yvette Roudy |
IV – RENOVER LA GAUCHE EN FRANCE
Le projet de Sarkozy, celui auquel il est en train de convertir progressivement toute la droite française, est clair: ultralibéralisme en économie, politique sécuritaire et répressive pour l'ordre public et les nouvelles classes dangereuses, communautés pour gérer les renoncements de l'état laïc. L'argent, la prison, la communauté, voilà les trois piliers du projet de Sarkozy. C'est le modèle américain devant lequel il est allé se prosterner outre-atlantique. C'est la fin du pacte républicain et social. Ce discours volontaire en séduit plus d'un car il se construit et se nourrit des difficultés, des ratés, des échecs du modèle français.
A ce modèle cohérent proposé par la droite américaine, nous devons opposer une autre énergie, une autre volonté, une autre modernité: un pacte républicain et social rénové qui ne fasse pas l'impasse sur ses échecs et affronte ses propres hypocrisies, qui accepte de se rénover en profondeur afin de réconcilier ses valeurs et ses pratiques, son idéal et sa réalité. Il y a une majorité de françaises et de français pour refuser l'aventure proposée par Sarkozy à la condition que nous soyons en capacité, sur nos valeurs, de répondre concrètement aux difficultés existantes et de tracer les perspectives d'un autre avenir. D'autant plus que les françaises et les français sont lucides. Ils savent que Sarkozy, Ministre de l'Intérieur, puis des Finances, puis à nouveau de l'Intérieur, toujours numéro des gouvernements et patron de l'UMP, premier parti de l'actuelle majorité, est comptable du bilan collectif de la droite depuis 2002 comme de son bilan individuel. Pour le bilan collectif il est simple et sans appel: augmentation du chômage, de la précarité et de la pauvreté; déficits des comptes sociaux et des comptes publics, explosion de la dette; diminution des investissements et faiblesse du commerce extérieur; mise à sac des entreprises publiques, appauvrissement de l'éducation nationale, blocage des dépenses d'avenir; baisse du pouvoir d'achat des salariés du privé et du public, mais augmentation de la pression fiscale sur les couches populaires et moyennes. Tout cela au prix de reculs sur les retraites, la protection sociale, le droit du travail.... Ce gouvernement est le plus mauvais gouvernement que la France ait connu depuis le début de la Vème République, pire encore que le gouvernement Juppé, et il fait de la France la lanterne rouge de l'Europe. Quant au bilan personnel de Sarkozy, s'il parle beaucoup, promet plus encore et se met en scène sans pudeur, il est soit nul, soit négatif. Immigration, Corse, collectivités locales, cultes, mais aussi, prix, impôts, dette publique, autant d'échecs de son action et de difficultés aggravées pour la nation!
Nos concitoyennes et nos concitoyens attendent de nous que nous disions clairement ce que nous voulons faire et que nous assumions pleinement, sans complexe, notre projet et nos valeurs. Pour tirer les leçons du 21 avril 2002, pour ouvrir une perspective mobilisatrice et remettre notre pays en mouvement, pour le réconcilier avec lui-même, nous devons nous adresser en priorité aux dix-sept millions de françaises et de français gagnant entre un et deux fois le SMIC que nous avons vocation à représenter, à défendre et à promouvoir, mais qui sont les oubliés de la croissance et des politiques publiques des dernières décennies, ceux qui supportent le poids de la crise.
Toutes les politiques publiques, fiscalité, éducation, travail, formation, logement, santé, services publics, transport doivent être mobilisées et conduites en leur direction prioritaire pour leur permettre de retrouver les chemins de l'optimisme. C'est la condition pour sortir notre pays de l'ornière.
1) D'abord rénover le projet
a) Renouveler nos actions pour la croissance et l'emploi
Cela suppose de s'attaquer aux situations de rente pour mettre l'investissement au service de l'emploi.
Cela suppose de remettre en cause la politique de la concurrence et d'être capable de s'en servir comme d'un outil de responsabilité sociale des entreprises et cela implique l'utilisation rénovée de la fiscalité des entreprises pour peser sur le partage de la valeur ajoutée. De nouveaux outils doivent être inventés pour discipliner l'économie de marché en imaginant des formes nouvelles d'encadrement des distributions de dividendes.
La question du partage des richesses est au cœur des problèmes que rencontrent les travailleurs : depuis plus de vingt années, depuis l'ouverture en 1983 de la " parenthèse " dans le projet socialiste, la frontière entre salaires et profits s'est peu à peu déplacée au profit des revenus financiers.
Reprendre ce qui a été ainsi perdu doit permettre tout à la fois de retrouver des marges de manoeuvre pour l'action collective en faisant sauter le tabou stupide de la baisse des prélèvements obligatoires, et d'ouvrir des pistes nouvelles à la nécessaire reprise de la progression du pouvoir d'achat de ceux qui vivent de leur travail.
Notre pays est en effet marqué par l'importance de plus en plus grande prise par les emplois à bas salaires et par la paupérisation relative de beaucoup parmi les travailleurs les moins qualifiés. Depuis trois années, les salaires stagnent, voire régressent.
Aujourd'hui 16% des salariés à temps plein sont payés au niveau du SMIC. Revaloriser les salaires est une nécessité sociale absolue, mais revaloriser le seul SMIC n'est pas suffisant. La situation actuelle, en effet, aboutit à ce que les salariés ne touchent que le SMIC pendant de longues années, sinon pendant toute leur vie professionnelle. Il n'y a donc plus de progression de carrière et la seule espérance de pouvoir d'achat supplémentaire est dans la recherche d'heures supplémentaires.
Cette situation est liée à l'insuffisance des salaires hiérarchiques, tels qu'ils apparaissent dans les accords salariaux : le salaire négocié est une virtualité, le SMIC est le salaire réel. Telle est la réalité.
Revaloriser les salaires suppose de revitaliser la négociation et de développer la démocratie sociale.
Pour cela, en s'appuyant sur l'obligation annuelle de négocier que les lois Roudy-Auroux ont instaurée, nous proposons que la discussion salariale dans les branches et les entreprises fasse l'objet d'un suivi collectif régulier : une conférence sur les salaires se tiendra chaque année dans le cadre d'un Conseil d'Orientation des Salaires, instance permanente réunissant l'ensemble des partenaires sociaux et les représentants des principaux groupes présents au Parlement.
Elle examinera les évolutions macroéconomiques (productivité, croissance, emploi) et les conditions d'évolution du partage des richesses ; elle constatera les évolutions salariales et l'état des négociations dans les différents secteurs. Les manquements à l'obligation de négocier seront sanctionnés et une norme générale d'évolution sera proposée qui s'appliquera en cas de carence de négociation.
Lutter contre cette situation nécessite de faire reculer la précarité, c'est-à-dire la flexibilité subie par le salarié. Pour nous, la logique de la flexibilité est incompatible avec l'ordre public social. Les Socialistes ont la responsabilité de le faire respecter et de le renforcer pour protéger les salariés.
L'intérim, les CDD et le temps partiel subi, qui concerne majoritairement les femmes, ne peuvent s'appliquer que dans des situations particulières, limitativement énumérées par le Code du travail. Chacun sait que ce n'est pas le cas : l'inspection du travail doit avoir les moyens de faire respecter les dispositions légales, elle devra être renforcée.
Au-delà, ces dispositions seront revues, afin de conduire à un meilleur encadrement, notamment - mais pas seulement - financier : les indemnités de fin de mission ou de contrat seront revalorisées et portées à un niveau supérieur aux 10% actuels et les prélèvements sociaux à la charge de l'employeur (chômage et retraite) seront relevés.
De même, les dispositions protégeant les salariés du licenciement seront renforcées. Dans le cas de plan sociaux liés à une difficulté économique mettant sérieusement en cause l'existence de l'entreprise, une reconversion conforme aux vœux des salariés devra être systématiquement recherchée.
Dans le cas de licenciements " boursiers " et de délocalisations, c'est-à-dire de suppressions d'emplois liées non à une difficulté réelle et sérieuse pour l'entreprise mais à la seule recherche d'un taux de profit supérieur, ce sont les procédures préalables à la définition du plan social qui seront renforcées afin d'assurer un véritable contrôle de la part des salariés, les pouvoirs publics doivent pouvoir refuser de telles opérations. De façon plus générale, l'organisation de plus en plus fréquente des groupes en réseau d'entreprises spécialisées et le développement de la sous-traitance en cascade, permettent aux donneurs d'ordre effectifs d'échapper aux responsabilités qui sont les leurs. Celle-ci devra pouvoir être mise en cause ; pour cela des instruments juridiques adéquats seront développés, comme, par exemple, la notion d'unité économique et sociale.
b) Protéger
(Cf. contribution thématique NPS : Retraites, santé, chômage et précarité. Face aux insécurités sociales et économiques : conforter la solidarité)
Une forte croissance et une baisse importante du chômage, faciliteront la solution aux problèmes de déséquilibres financiers qui demeureront. La gauche doit les affronter sauf à laisser la droite les régler par le démantèlement et la privatisation des prestations. Il faudra donc nécessairement faire contribuer plus les revenus du capital au financement de la protection sociale quant aujourd'hui 6 % seulement des recettes en proviennent.
Les socialistes portent haut et fort la remise en question de la loi Fillon. Ils doivent orienter leur projet de sauvetage du système de retraite vers l'égalité véritable en s'appuyant et en les corrigeant sur les écarts d'espérance de vie et de pénibilité dans le travail. Il est injuste et inacceptable que ceux qui cotisent le plus et le plus longtemps en profitent le moins.
En moins de trois années, c'est rien moins que l'essentiel de l'édifice de protection face aux insécurités sociales et économiques construit en un peu plus d'un siècle par le mouvement social, qui a été mis à mal. C'est sur ces ruines que nous devrons, demain, reconstruire une protection sociale solidaire et efficace devant l'âge, les problèmes de santé et ceux du chômage et de la précarité devant l'emploi.
La CSG, qui est une recette fiscale se substituant aux cotisations des salariés, a été créée par les socialistes en 1990 pour assurer le financement des prestations familiales ; elle a, par la suite, été étendue au financement de l'assurance maladie. Il faut compléter cette évolution en créant une CSG se substituant aux cotisations retraites pour autant qu'elles financent la part non contributive des régimes de base, c'est-à-dire celle qui assure à chacun un minimum de retraite. Cette substitution permettra de dégager un gain de pouvoir d'achat pour les salariés.
Il faut enfin poursuivre ce mouvement par une modification radicale du financement par les employeurs en créant une recette fiscale assise sur la valeur ajoutée. En élargissant l'assiette du financement au capital engagé, on permettra de réduire le coût du travail et ainsi de favoriser les secteurs fortement utilisateurs de travail.
S'il n'y a aucun tabou particulier à avoir en ce qui concerne la nature et le niveau des "prélèvements obligatoires", il ne faut pas, pour autant, s'interdire d'aller chercher toutes les sources de financement possibles ni de combattre énergiquement les situations de gaspillage avéré et de rente abusive qui se sont créées dans le système de santé, au détriment des assurés sociaux, c'est-à-dire de nous tous. Or les possibilités qu'offre la récupération de l'argent ainsi perdu sont très importantes.
Si l'on observe la politique du médicament menée par la France, notre pays a la dépense de médicament par tête la plus importante au monde: 537euros par habitant. Toujours en volume et par tête, notre consommation est 2,5 fois supérieure à celle des Danois, 2 fois supérieure à celle des Hollandais et des Suédois, de 80% supérieure à celle des Britanniques et de 50% à celle des Allemands. Même si l'on peut trouver bien des explications à cette surconsommation, elle n'en est pas moins un problème, aussi bien financier que de santé. Les économies envisageables sont, pour le moins, très loin d'être négligeables. Pour prendre les deux références extrêmes, la dépense de médicament et de dispositifs médicaux liée aux soins de ville représentant 20 Mrd d'euros en 2002 (131 Mrd F), l'économie serait de 12 Mrd d'euros, si notre consommation par tête était alignée sur celle des Danois, et, au pire de 6,7 Mrd d'euros, si elle l'était sur celle de nos voisins allemands. Une ferme rationalisation s'impose, source - sans aucun doute, la principale - d'économies qui seraient mieux utilisées ailleurs.
On connaît, au quotidien, l'impact des maladies professionnelles dans la morbidité. Il est scandaleux de constater que les dépenses de soins stricto sensu du régime accidents du travail et maladies professionnelles, qui est censé les couvrir, représentent moins de 3% des dépenses de santé, (soit environ 3,5 Mrd d'euros)! Il y a là une sous-estimation manifeste du coût réel des maladies professionnelles, dont une partie est ainsi indûment mise à la charge des assurés sociaux, alors qu'elle devrait être intégralement financée par les seuls employeurs. On ne peut accepter plus longtemps que des montants dérisoires soient reversés à la Sécu (330 M d'euros en 2003), alors que les sommes concernées représentent vraisemblablement plusieurs milliards.
Au total, il est très loin d'être évident que des hausses de prélèvements soient à court terme nécessaires, dès lors que ces deux propositions seraient sérieusement appliquées. Une estimation modérée de leurs effets permet, en effet, de penser qu'elles suffiraient largement à combler le déficit actuel. Pour peu qu'une véritable politique d'emploi, d'une ambition et d'une ampleur identique à celle mise en œuvre de 1997 à 2002, soit simultanément mise en place, on peut être assuré qu'il serait possible de mener une politique de santé ambitieuse sans qu'il soit besoin de hausses des prélèvements avant longtemps.
c) Redistribuer par la fiscalité
L'impôt en France n'assure pas la redistribution des richesses, le salarié payé au SMIC (les femmes étant les plus souvent concernées), supportant un taux proche de celui qui gagne 15 fois le SMIC (45 % contre 56 % de prélèvements obligatoires). Il n'incite pas à créer des emplois stables, est indifférent aux pratiques des entreprises dans la gestion de leur main d'œuvre. Il pèse presque exclusivement sur le travail. Le constat est connu, reste à définir les voies de la réforme.
Une première piste doit être de repenser la fiscalité du capital et des revenus du capital. Dans les grandes entreprises les dividendes reçus sont taxés à 30 % quand les revenus du travail le sont à plus de 48 %. On doit rapprocher ces taux de prélèvements à l'égard des grandes entreprises non créatrices d'emploi. Au-delà, la modulation si ce n'est la suppression des abattements existants sur les dividendes payés par les entreprises au regard du niveau d'investissement engagé par celles-ci au regard de leurs résultats devra désormais s'imposer : les actionnaires d'une entreprise réalisant de forts bénéfices parce que celle-ci sous-investit, ne doivent pas pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux sur les dividendes distribués.
Concernant l'imposition des salaires, les baisses d'impôt des catégories les plus favorisées doivent être stoppées. La logique de la baisse de l'impôt ne fait pas partie de notre logiciel, elle implique nécessairement des conséquences en terme de perte de recettes et pénalise les politiques publiques déjà difficiles à financer. La fiscalité est un instrument de redistribution que nous devons pleinement assumer et utiliser. Le poids de la dette devra nous conduire à assumer la nécessité devant l'urgence nationale d'augmenter les impôts sur les catégories qui ont bénéficié des baisses.
Enfin, une réforme d'ampleur de la fiscalité locale doit être décidée. Il faut mettre fin à l'explosion des inégalités territoriales et à l'impossibilité pour des élus locaux de boucler leur budget sans renoncer à des services publics locaux quand des villes ou des départements regorgent de recettes provenant par ailleurs d'impôts absolument injustes et parfois même aberrants dans leur assiette. Une réforme d'ampleur, globalisée et planifiée de la fiscalité locale est désormais indispensable dans notre pays. Corollaire d'une décentralisation qui doit se combiner avec le maintien de principes égalitaires sur tout le territoire, elle doit assurer des ressources stables et justement répartie aux collectivités territoriales dans les charges s'alourdissent au moment où les ressources deviennent plus rares.
d) Redistribuer par les services publics
(cf. contribution thématique NPS : Pour rénover l'action publique)
Et il n'est qu'à écouter Nicolas Sarkozy pour se persuader que l'un des axes forts de la campagne présidentielle de la Droite sera l'instauration d'un nouvel équilibre entre le marché déréglementé et la puissance publique cantonnée au maintien de l'ordre. Les socialistes ne doivent pas se laisser enfermer dans l'alternative entre l'immobilisme défensif et le fatalisme libéral. Pour cela, il ne lui suffit plus d'énoncer un nouveau " ni-ni ". Il lui faut reformuler sa conception de l'action publique.
L'abandon des territoires et des catégories sociales les moins favorisés : dans une logique financière, les services publics se désengagent des secteurs non rentables à court terme. La Poste a engagé un plan drastique de fermeture de ses bureaux de plein exercice, transformés en simples points de contact gérés par des communes consentantes ou des commerces de proximité. Un processus de banalisation de la banque postale, jusqu'ici destiné à l'accueil des comptes des plus démunis et au financement du logement social, a été enclenché. La Poste est redevenue bénéficiaire en 2004 mais, pour son président, un résultat net de 3 % est insuffisant ; il faut tendre vers 7 ou 8 % comme certains concurrents privés…
L'énorme gâchis financier : à l'échelle de l'Europe, les entreprises nationales des différents Etats-membres, voire du même pays (EDF et GDF), se sont lancées dans une guerre économique sans merci. Sur chaque marché, leur perspective est devenir le champion européen ou de mourir. La course à la dimension internationale a suscité de multiples opérations hasardeuses. Au début des années 2000, France Télécom (mariage malheureux avec Deutsche Telekom, acquisitions du britannique Vodafone, de l'allemand MobilCom, du polonais TPSA, de l'américain Equant…) s'est retrouvé avec des pertes abyssales et une dette de 70 Mds€, le record mondial en la matière. EDF a vu ses comptes plombés durablement par une série échevelée d'acquisitions tous azimuts (Light au Brésil, Edenor en Argentine, Seeboard en Grande-Bretagne, EnBW en Allemagne, Edison en Italie) dont elle commence à se remettre péniblement aujourd'hui.
En attendant les immenses besoins financiers nés de ces déboires ont servi de prétexte pour ouvrir le capital des entreprises, prélude de leur privatisation, et donner la priorité à la valeur boursière plutôt qu'aux valeurs du service public.
Le mensonge économique : les avantages théoriques de la libéralisation ne résistent pas à l'épreuve des faits. Myope et imprévoyant, guidé par la quête de profits immédiats, le marché est inapte à piloter les grandes industries de réseaux qui nécessitent des investissements particulièrement importants, souvent indivisibles, rentables à moyen et long terme. Il privilégie les productions au moindre coût quitte à sacrifier l'avenir.
Sur le marché de l'électricité destiné aux entreprises, où la concurrence est désormais totale, les prix n'ont pas baissé. Ils sont devenus plus volatils et plus spéculatifs. La déréglementation a introduit un risque grave de sous-investissement. Ses effets désastreux sont déjà visibles dans les pays européens où elle est la plus avancée (Royaume-Uni, Suède, Danemark, Espagne, Italie) : les pannes de courant sont de retour. Malgré ce constat inquiétant, l'Union européenne n'a en rien revu son dispositif de libéralisation : en vertu de la directive de juin 2003, l'ouverture de la concurrence devrait totale pour les particuliers le 1er juillet 2007 !
En Grande-Bretagne, la dérégulation des chemins de fer (création de 25 compagnies privées) a entraîné des problèmes inextricables de billetterie, des retards et des accidents à répétition. Elle s'est finalement soldée en 2001 par la mise sous administration judiciaire de Railtrack, la société chargée de gérer les voies, marquant ainsi l'échec retentissant de la privatisation, engagée par le conservateur John Major et poursuivie par le travailliste Tony Blair, contraint de décider la recapitalisation par l'Etat avec la création de Network Rail. Un bel exemple de la réussite du modèle britannique en matière de services publics !
Dans les télécommunications, la baisse des prix, présentée comme une certitude scientifique, est en réalité bien difficile à démontrer. La différenciation des services proposés aux consommateurs aboutit à une telle complexité des barèmes que plus personne n'est capable de dire si une offre téléphonique est moins chère qu'une autre.
L'option libérale peut faire illusion un temps, en profitant des infrastructures construites et amorties sous la responsabilité de la puissance publique. Mais, dès qu'elle peut être jugée sur son aptitude à anticiper les besoins de l'économie et des particuliers, sa dangerosité resurgit. La déréglementation n'a véritablement d'intérêt que pour les milieux financiers. Le dépeçage des entreprises publiques permet aux groupes privés d'accéder à d'énormes gisements de profit en exploitant des investissements réalisés par d'autres.
La déréglementation des services publics participe de la crise de nos démocraties occidentales. Avec ou sans privatisation totale, elle prive les Etats de leur capacité à piloter des politiques publiques dans des domaines essentiels à la lutte contre les inégalités sociales, à l'équilibre des territoires, au développement durable. Dans le même temps, dépourvue de véritable légitimité démocratique, l'Union européenne fait la démonstration permanente de ses blocages institutionnels, plus terribles encore depuis son élargissement mal préparé. Ce double constat de l'impuissance publique pousse immanquablement les citoyens vers l'indifférence civique ou la tentation du populisme.
En France, l'Etat et les collectivités locales doivent reprendre le pilotage des entreprises de services publics. Nous devons réaffirmer la légitimité de la puissance publique à incarner l'intérêt général. Les effets profondément néfastes de la déréglementation ont au moins le mérite de rappeler que l'intervention directe de l'Etat et des collectivités locales est incontournable pour garantir sur le long terme la production des biens publics indispensables tant à la cohésion sociale et territoriale qu'à l'efficacité économique. La puissance publique doit retrouver la maîtrise des entreprises qui, dans de vastes secteurs stratégiques (transports, énergie, télécommunications, poste) sont les instruments indispensables de la lutte contre les inégalités, de la politique de l'emploi, de l'effort de recherche-développement, de l'amélioration de la compétitivité économique. En les abandonnant à la logique financière, le pouvoir politique s'enferme délibérément dans l'impuissance.
Cette réaffirmation de la capacité du politique à définir l'intérêt général a un préalable déjà souligné : l'établissement d'une nouvelle démocratie des usagers qui en fasse les acteurs du débat sur l'analyse des besoins et l'évaluation des résultats de l'action publique.
Elle a aussi un corollaire : reprendre le pilotage des entreprises de services publics, retrouver le pouvoir d'en fixer la stratégie, d'arrêter le point d'équilibre entre missions d'intérêt général et rentabilité financière, implique de leur procurer les ressources nécessaires à leur développement raisonnable.
Nous proposons la création d'un pôle financier public, spécialisé dans l'apport des fonds propres indispensables au développement des services publics. L'Union européenne ne l'interdit pas dès lors que ces placements sont rémunérés. La Caisse des dépôts et consignations, rendue à sa vocation originelle, peut jouer le rôle de l'actionnaire stable. Il suffit de redéployer ses actuelles participations dans de nombreuses sociétés privées (20 milliards d'euros), notamment la moitié des sociétés du CAC 40 (Accor, Schneider, Saint-Gobain, Michelin, Air Liquide, LVMH, Véolia, etc.).
La gestion de l'eau : mettre fin aux rentes de situation. Deux ou trois groupes multinationaux en situation d'oligopole se partagent les contrats de distribution de l'eau et de l'assainissement. Ils réalisent sans risques, sur de longues périodes, des bénéfices considérables, avoués ou non ("frais de siège" invérifiables), qu'ils réinvestissent ensuite à leur guise dans d'autres secteurs de l'économie. Le contrôle par la puissance publique de la qualité et du prix des prestations devient impossible faute de disposer d'une véritable capacité d'ingénierie. Les collectivités locales doivent donc reprendre la maîtrise de ces services publics fondamentaux.
Nous proposons que la durée maximum des contrats de délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement soit portée à six ans, afin que tout maire ou président d'exécutif intercommunal ait la possibilité, une fois au cours de son mandat, de ramener ces services en gestion publique en s'appuyant, le cas échéant, sur une structure d'assistance technique, à créer, à l'échelle départementale ou régionale.
e) Education : pour une politique de l'égalité
(cf. contribution thématique NPS : Pour une nouvelle politique éducative)
Les valeurs mêmes de l'école sont contestées. égalité, autonomie, laïcité, respect…se voient préférer compétition, consumérisme, individualisme.
La loi Fillon nous a donné un avant-goût du renoncement et du désengagement qui menacent l'Education nationale.
Pour reconstruire le service public performant que les Français attendent pour leurs enfants, nous appelons non à une ultime et bureaucratique réforme de façade, mais à une refondation.
Depuis le service public de la petite enfance permettant la scolarisation dès 2 ans, jusqu'à l'Université où la Nation doit réinvestir massivement, nous dessinons une politique de l'égalité pour l'Education dans la vie République.
L'ouverture de l'école aux parents progressera s'ils sont acceptés non comme des usagers mais comme les acteurs à part entière du réseau éducatif local, associant au-delà des enseignants et des familles, les intervenants périscolaires pour le sport, la culture, l'aide aux devoirs, mais aussi psychologues, médecins, travailleurs sociaux. Le budget participatif, dans les collèges et dans les lycées, permettra d'associer chacun à une vraie démocratie locale.
Cette refondation ne sera possible sans un nouvel engagement des enseignants, confrontés à l'impuissance dans un contexte social dégradé. Mieux formés, mieux rémunérés, mieux soutenus et moins isolés, les enseignants doivent s'engager dans cette " bataille " de la réussite scolaire pour tous, en privilégiant le travail en équipe, l'innovation, la pédagogie différenciée, l'évaluation.
La mobilisation des territoires scolaires renforcera la coéducation, pour bâtir dans chaque quartier et chaque village de France un projet éducatif et culturel local. C'est à ce prix que l'école républicaine échappera à la marchandisation des savoirs.
Un renfort massif et mieux ciblé doit être apporté aux établissements concentrant les enfants des familles en difficulté avec un taux élevé d'échec scolaire. Régulièrement évalué pour ne pas devenir une rente automatique, ce renfort en encadrement et en crédits pédagogiques doit pouvoir atteindre 50% et permettre ainsi le dédoublement de classes, les travaux en groupes, et l'accompagnement personnalisé, pendant et après les heures scolaires.
L'égalité territoriale nous impose de revaloriser l'offre scolaire dans les établissements ruraux trop souvent victimes de fermetures de classes, d'options et de filières.
L'éducation est l'affaire de tous. C'est à la communauté éducative de définir les connaissances et les compétences que chaque jeune citoyen(ne) doit avoir acquis à l'issue de la scolarité obligatoire. Il faudra créer une plus grande communication entre les savoirs et un réel équilibre entre compétences intellectuelles et apprentissages techniques et manuels. De quoi permettre une orientation réussie pour tous.
Nous proposons pour tous les Français, un droit à une " deuxième formation ", pouvant aller jusqu'à deux ans, en particulier pour les chômeurs, pour ceux dont la formation initiale fut la plus brève, pour ceux qui sont brutalement ou durablement exclus de l'emploi. Elle aura pour objectif un nouveau métier, une autre qualification ou l'apprentissage de nouvelles techniques.
Ce droit sera ouvert à tous, modulable en fonction du capital scolaire et de la situation de chacun, négocié avec les collectivités publiques et les partenaires sociaux, et facilité par une rémunération.
Sa mise en œuvre s'appuie sur l'offre de formation des adultes, renforcée par l'Education nationale et privilégie la proximité sur les territoires.
Mais regardons les choses en face : qui peut croire qu'il suffira de définir des objectifs d'actions renouvelées pour régler ces problèmes dont certains se posent avec continuité depuis 20 ans ? Qui peut croire que des mesures nouvelles, des actions plus fortes suffiront à réformer ces terrains de la réforme impossible ? Qui peut croire encore qu'il suffirait de rajouter des moyens supplémentaires pour venir à bout des maux profonds de notre pays ?
La redéfinition de notre projet et de ses objectifs de transformation de la société n'y suffiront pas. A ces objectifs nouveaux doit nécessairement s'ajouter la transformation de nos façons de faire et de pouvoir faire : l'une et l'autre sont indissociablement liées.
Il en va de la réussite même de la rénovation de gauche.

