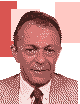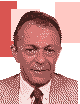| | Au lendemain de l'université d'été de La Rochelle, la famille socialiste apparaît idéologiquement plus divisée que jamais. Est-ce un épisode conjoncturel ou le symptôme d'une régression systématique du socialisme français vers le mythe révolutionnaire ?La famille socialiste française reste hélas divisée comme elle l'est depuis un siècle, mais pas plus qu'avant. Ne parlez pas de régression ! La gauche se trouve dans un relatif marasme idéologique - mais, à bien y regarder, elle y est, en fait, depuis toujours ! Ou, disons, depuis 1905, date de la fondation du Parti socialiste.
Mais encore ?C'est Jules Guesde qui a gagné en 1905 contre Jean Jaurès - et on y est toujours ! Pour le dire autrement, la caractéristique du moment présent, c'est qu'on y observe une incompatibilité grandissante des enjeux stratégiques. Ou disons un éloignement, un divorce, entre, d'un côté, la vision social-démocrate d'une société solidaire, dans un marché globalisé et, de l'autre, une revendication plus intransigeante et radicale, qui s'exprime par la volonté de « rupture avec le capitalisme », que d'autres traduisent par le « grand soir » ; mais cette radicalité-là ne peut avoir de chances que pays par pays et avec l'appui décisif de gouvernements conquis par une gauche vigoureuse.
Et donc, elle a peu de chances d'aboutir ?Je ne crois pas à l'éventualité de son succès, justement en raison de la forte unification mondiale du marché. A cet égard, discuter de l'éventualité d'une scission, comme on l'a fait depuis deux semaines, est un peu absurde. Je n'ai voulu évoquer par là qu'un danger, pas un souhait. Et je me suis borné à dire que la cohabitation entre ces deux tendances les paralyse chacune.
François Mitterrand, conscient du problème, semble s'être donné pour ligne de conduite l'axiome du cardinal de Retz selon lequel on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens... Tout à fait vrai ! En tout cas, cette ambiguïté n'est pas seulement affaire des leaders - quels qu'ils soient. L'ambiguïté tient à ce que nous sommes dans le même parti et que nous n'arrivons pas, ce faisant, à décider d'une stratégie convaincante.
Vous dites que ce flottement doctrinal a un siècle. Pourquoi ?Le référentiel de 1905 - à forte dominante marxiste - aboutit au large soutien de Jules Guesde par l'Internationale, au détriment, bien sûr, de la ligne prônée par Jean Jaurès, minoritaire et vaincue. Mais ce référentiel triomphant ne se contenta pas d'infliger une cuisante défaite à Jaurès, il imposa surtout, par-delà son ambition, de collectiviser les moyens de production et d'échange, son présupposé idéologique central : le primat de l'économie.
Ce socialisme-là était un économisme ?Le socialisme à dominante marxiste a une vision du changement social centrée sur le système productif, et guère sur les processus politiques. Au sein de la famille socialiste, la contradiction idéologique entre réformistes et révolutionnaires est donc très ancienne, et elle s'est illustrée avec éloquence sous le Front populaire. En 1936, lorsque Léon Blum est devenu président du Conseil - à l'époque, le titre du premier ministre -, il lui a fallu expliquer à ses camarades que la révolution n'était pas à l'ordre du jour, parce que le rapport de forces favorable n'existait pas. Autrement dit, d'après son analyse, il convenait, pour les socialistes, d'exercer le pouvoir sans avoir vraiment les moyens de le conquérir. Et si, par exemple, le gouvernement issu de la SFIO a nationalisé la SNCF, c'était uniquement parce qu'elle était en faillite et que c'était là, l'unique solution pour la sauver. Car cette nationalisation n'était pas inscrite au programme.
D'accord, mais Léon Blum ne se défaisait pas de toute ambition transformatrice... Bien sûr, et les réformistes non plus, ni moi-même... Tout est dans le rythme et dans les moyens. Nous croyons, comme Blum, aux petits pas - et non au « grand soir ». Disons que le corps de doctrine socialiste, à cette époque-là, prétendait associer l'idée de la « dictature du prolétariat » - un mot encore employé par Blum dans son discours de 1920, après la scission de Tours d'avec les « bolcheviks » - avec la préservation des libertés dites bourgeoises. D'où, quinze ans plus tard, l'étrange analyse idéologique de Blum. Une fois au gouvernement, il s'essaye, tout ensemble à améliorer la situation des moins bien lotis, à renforcer, par exemple, l'assurance-maladie, à mettre en place les premiers éléments d'un système de retraites et de sécurité sociale, à instaurer les congés payés et à réduire le temps de travail à quarante heures hebdomadaires. Mais ce faisant, il met soigneusement tout horizon révolutionnaire de côté. Les gouvernements de la Libération produiront ensuite des versions pâles de ce compromis blumiste. Et - paradoxe suprême - le gouvernement de Charles de Gaulle, s'il opte pour les nationalisations, le fait en fonction d'une recommandation du Conseil national de la Résistance, et contre l'avis des forces de gauches d'inspiration marxiste ! Il faut se souvenir qu'à ce moment, dans Fils du peuple, Maurice Thorez (qui, en 1945, va accepter un portefeuille et se résoudre tardivement aux nationalisations), avait instruit un procès véhément contre les nationalisations pour cause de collaboration de classes et de renforcement de la technocratie...
Sautons les décennies. En 1983, les socialistes renoncent définitivement aux nationalisations...En 1981, le PS arrive aux affaires avec un programme marxo-guesdiste. Et se cogne vite, à la fois, sur la balance des paiements et au fait que la relance de la consommation n'a pu s'adresser qu'à l'importation et non à l'économie interne, parce que celle-ci venait d'être surchargée exagérément avec une prodigieuse augmentation des impôts, des cotisations sociales et un allongement des congés... Les trois dévaluations et le programme de rigueur et d'assainissement accompagnant la troisième, qui s'ensuivent alors (avec le blocage corrélatif des prix et des salaires pendant trois mois), auraient dû être une occasion de réfléchir. Et de tracer une voie de sortie doctrinale originale - comme les Suédois, un demi-siècle auparavant.
Et ce ne fut pas le cas, d'après vous, pour les socialistes français des années 80 ?La rectification de 1983 n'était pas un drame. Ce qui le fut, en revanche, c'est de la baptiser « parenthèse ». Car l'intention était de donner le sentiment que rien, des illusions post-révolutionnaires - c'est-à-dire de la transformation sociale massive et solidaire -, n'était au fond abandonné. A l'inverse, en 1932, les sociaux-démocrates suédois ont eu le courage insigne, cinq ou six mois après leur accession au pouvoir, d'expliquer à leur peuple que le programme marxiste sur lequel ils avaient été portés au pouvoir s'avérait impraticable. D'où, entre autres, leur décision précoce, prise à la lumière des ratés de l'URSS, de surseoir à la transformation du système économique, en mettant au contraire l'accent sur la démocratie politique et la démocratie sociale. François Mitterrand est resté, lui, tributaire de l'ambiguïté globale du discours socialiste français. Contrairement à nos amis suédois, il a essayé obstinément d'aménager les conditions d'une cohabitation équivoque du réformisme (incarné, par exemple, avant lui, par Jules Moch ou André Philip) et du mythe révolutionnaire (façon Marceau Pivert ou Paul Faure). Au 63 ème Congrès, celui de Valence, en 1981, les sociaux-démocrates ont tenu bon face au bavardage marxiste et fait adopter le terme - proposé par Jean Poperen - de « compromis social », en lieu en place de celui de «rupture», qui continuait à exprimer le rêve inconscient chez les socialistes dont, pourtant, la possibilité était à l'évidence condamnée par les faits. Ce choix fut la première affirmation claire d'un rejet de la perspective révolutionnaire. Mais il ne fut pas pour autant assez net.
Faut-il comprendre que, depuis, la naissance d'une authentique social-démocratie française a avorté ?Il n'existait pas, hélas, dans le texte de Valence, de ralliement solennel à l'économie de marché pour la partie productive de nos sociétés. Or la social-démocratie suppose justement que la partie productive de notre société soit réorganisée sur la base de l'économie de marché et de la liberté d'entreprise, mais régulée et corrigée de ses inégalités outrancières. A côté de cela, la social-démocratie insiste sur l'existence de vastes secteurs non marchands, couvrant les services publics, l'éducation, la culture, la santé et la protection sociale, qui donnent un moyen d'échapper au marché et de créer une société réellement solidaire et indépendante des effets et soubresauts de celui-ci.
Que faire, aujourd'hui, face à l'héritage renaissant de Marceau Pivert et de Jules Guesde ? Face à ce socialisme antilibéral qui courtise l'ultragauche ?Un chiffre éloquent, d'abord : on dénombre 850 000 socialistes allemands. Et, dans un pays - l'Autriche - de 14 millions d'habitants, pas moins de 600 000 socialistes ! La malédiction du socialisme français, c'est sa faiblesse numérique (100 000 adhérents au PS). Les idées émergent institutionnellement hors du parti. Mais, hélas, elles prennent corps au sein d'une société civile qui n'a pas reçu d'enseignement d'économie et d'histoire économique et qui, partant, confond le capitalisme (compris dans ses visées autoritaires et monopolistes) et le marché. L'altermondialisme naît précisément de cette ignorance de tout un pan de l'histoire récente : celle du compromis.
Bref, l'altermondialisme annule les acquis des histoiriens des Annales ! Si vous voulez... Avant tout, cette mouvance est née de notre impuissance à corriger l'absence, dans le système d'enseignement secondaire, de cours d'économie, d'histoire sociale, de droit social ou encore de sociologie, au bénéfice de l'abstraction conceptuelle. Le résultat, c'est que personne n'est éduqué au compromis en France. Et que cette malédiction du compromis - compromis qu'on tient, bien souvent, pour une « compromission » - se double, désormais, d'un retour en grâce du romantisme du fusil. Le « grand soir » fait à nouveau rêver et, avec lui, l'horizon trompeur des « ruptures radicales ».
Pourquoi trompeur ?Trompeur, d'abord parce qu'impossible. Mais aussi, parce que mensonger sur la liberté. L'actuel capitalisme fait d'énormes efforts pour nous vendre une escroquerie intellectuelle : sur le marché, selon les monétaristes, la liberté se définit par l'absence de règles. Injustices, fraudes, souffrance humaine – autant d'entraves à la liberté véritable – découlent de ce que le capitalisme actuel accepte de moins en moins de règles, s'il en a jamais accepté. Dès lors, comment une victoire contre ce « turbocapitalisme » pourrait-elle être remportée par les tenants d'une ligne néoguesdiste, sur une base purement nationale ? A contrario, il s'agit bien d'une bataille mondiale, longue mais gagnable.
Face à la dérégulation absolue, les vieilles recettes marxistes sont, d'après vous, impuissantes ?Evidemment ! La vision folle de la dérégulation absolue est devenue non seulement l'obstacle principal à tout progrès social, mais même l'instrument majeur de la grande régression que nous vivons aujourd'hui, et notamment des vertigineux déséquilibres américains qui nous menacent gravement. Laisser supposer, à travers une alliance de mots douteuse, que le ralliement des socialistes, et notamment des socialistes français, à l'économie de marché impliquerait de leur part l'acceptation de l'absence ou de l'insuffisance de règles qui caractérise le capitalisme actuel est un assez ignoble procès d'intention, vain de surcroît sur le plan de ses retombées politiques effectives, qui traduit en fait le désir de dévier ou d'éviter le débat de fond. Qu'on en finisse, au moins entre nous, avec ces procédés !
|