Arcelor,
l'Europe doit dire non
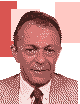
Point de vue signé par Michel Rocard, ancien premier ministre, député européen, paru dans le quotidien Libération daté du 07 février 2006
Arcelor, |
|
Point de vue signé par Michel Rocard, ancien premier ministre, député européen, paru dans le quotidien Libération daté du 07 février 2006 | |
L'offre publique d'achat hostile de Mittal sur Arcelor est logique. Elle est dangereuse. Elle ne devrait pas surprendre. Dans le combat qui s'engage, l'Europe a de grandes chances de perdre, ou plutôt Arcelor a de grandes chances de perdre, puisque le groupe Mittal, société de droit néerlandais, est lui aussi européen. Faut-il s'attrister ? A priori, ce n'est pas évident. L'acier n'est pas une matière symbolique. Nul ne peut lui porter un intérêt affectif analogue à celui que les Français portent aux produits de leur viticulture, de leur haute couture ou d'Airbus, ou les Allemands à ceux de Mercedes. Nous avons accepté, mieux, nous avons choisi de faire l'Europe autour du concept de marché commun qui suppose la recherche de l'allocation optimale des ressources et des investissements sur le territoire, indépendamment de sentiments extra-économiques telle la « satisfaction propriétaire ». En outre, le « patriotisme économique » qui s'exprime ici ou là sur ce sujet manque particulièrement de pertinence. D'abord, parce qu'Arcelor a cessé voici quelque trois ans d'être français pour devenir plutôt luxembourgeois, et en tout cas européen. Ensuite, parce qu'il faudrait savoir ce que l'on veut. On respecte et on applique des règles, ou on ne les respecte ni ne les applique. Les OPA font partie de ces règles. Le patriotisme économique, même étendu à l'Europe, est un concept d'un flou effrayant, dont nul ne sait à l'avance à quoi il pourrait bien s'appliquer, et dont nul organe respecté n'a la responsabilité de définir le champ. Nul ne saurait travailler, aucune économie ne saurait fonctionner en référence à un principe pareil. L'OPA est légitime, et que le marché fasse son œuvre. Il nous reste à implorer la providence pour que la solution réponde favorablement à nos affects ou à nos craintes. Il y a cependant une autre manière d'analyser le problème. Depuis une trentaine d'années, le capitalisme a subi une mutation profonde. Il a dramatiquement changé. Souvenons-nous : 1950-1975. Croissance rapide et régulière en Europe, Amérique du Nord et Japon. Plein emploi à peu près partout. Quasi-disparition de la pauvreté de masse en pays riches. Quelques faillites nationales, jamais de crises financières systémiques mettant en danger une dizaine de pays à la fois. Et bien sûr, état de bien-être (ce que l'on a appelé à tort Etat-providence) florissant et efficace. 1990-2005. La croissance est ralentie partout bien qu'inégalement. La pauvreté de masse refait son apparition en pays riches. Un bon cinquième de la population active est frappé en proportions inégales selon les lieux et les traditions locales par le chômage et la précarité du travail, les petits boulots, les rémunérations inférieures au seuil de pauvreté, et manque par là à sa fonction de consommation. Les inégalités de revenus s'aggravent vertigineusement aussi bien à l'intérieur des nations qu'entre elles. Les crises financières systémiques se multiplient, cinq en quinze ans, pour le moment limitées - mais pour combien de temps - à de grands ensembles régionaux. Les déséquilibres financiers et commerciaux atteignent des niveaux records fort dangereux. Ils sont surtout en constante augmentation sans qu'aucun mécanisme correcteur ne pousse au rééquilibrage. A cela s'ajoutent, toujours en pays développés, la réduction sensible du champ des services publics et celle, partielle, de la fonction redistributrice de la Sécurité sociale. De ce fait, la fragilisation du travail et la réduction relative du niveau moyen des salaires par rapport au PIB entraînent des souffrances sociales plus grandes et moins bien compensées que par le passé. Les budgets publics sont presque tous en déficit, les ressources fiscales des Etats évoluant en gros plutôt comme la masse des salaires que comme le PIB. Tel apparaît le capitalisme contemporain, producteur de rejet, de colère, d'apathie démocratique. Le non au référendum européen s'explique largement ainsi. Il n'y a pas consensus parmi les économistes sur les causes d'une mutation aussi profonde et aussi dangereuse. On a évoqué les changes flottants (Nixon a séparé le dollar de l'or en 1971), l'intensification de la substitution capital travail, l'irrépressible montée du coût de l'énergie. Les facteurs sont probablement multiples, mais aucun de ceux-là ne paraît suffisamment convaincant. Le symptôme le plus marquant est la baisse significative de la part des salaires dans le PIB. Elle est difficile à mesurer. La comparabilité internationale n'est pas assurée. Mais au niveau de généralité qui nous suffit ici, il est peu contestable qu'elle a diminué de 6 à 10 % aux Etats-Unis de 1980 à 2005 et d'au moins autant en France. C'est la masse des revenus financiers, intérêts, loyers et surtout profits qui en a bénéficié, masse qui est beaucoup moins bien imposée que celle des salaires et qui surtout est beaucoup moins affectée à la consommation. Si l'on avait partagé le revenu national français de 2005 selon les ratios observés en 1980, on aurait 120 à 150 milliards d'euros de plus de salaires directs et indirects, c'est-à-dire une large centaine de milliards d'euros de plus de consommation, et les recettes fiscales et sociales y afférentes. Cela implique plus de croissance, plus d'emplois, et moins de déficits de l'Etat et de la Sécurité sociale. Une politique de meilleurs revenus serait possible, et la dette augmenterait moins, améliorant la stabilité du système. Je considère donc ce symptôme comme le plus déterminant dans l'évolution en cause. Comment en est-on arrivé là ? Quelque chose s'est passé dans le jeu des acteurs du système. Toute entreprise vit une négociation permanente entre les entrepreneurs, les banquiers, les fournisseurs, les clients, le personnel et les actionnaires. Or la balance des forces a changé. L'actionnaire était le grand oublié de la période 1945-1975, dite des Trente Glorieuses. De toute façon, personne physique que l'on ne consultait que lorsqu'il avait un certain poids, il était sensible au destin de l'entreprise, à ses besoins de recherche, d'investissement et de politique sociale avancée. La mutation, c'est qu'il a changé. A travers les fonds de pension, la représentation de l'actionnaire est devenue collective. Des dizaines de millions d'actionnaires autrefois silencieux sont maintenant intégrés à cette représentation. Et ces bureaucraties d'actionnaires n'ont qu'un seul mandat, celui d'exiger au terme le plus proche le plus gros dividende possible. Les préoccupations propres de l'entreprise disparaissent, et la pression se fait énorme, voire atteint les limites de l'absurde. On se souvient de la consigne donnée par certains fonds de pension, d'exiger une rentabilité de 15 % du capital investi. Dans une économie en croissance de 3 ou 4, ou même 5 % par an de profit distribuable, pour que quelques entreprises atteignent 15 %, il faut que beaucoup d'autres fassent 0 ou meurent, et il faut surtout payer moins bien les salariés. C'est ce que le système fait depuis deux ou trois décennies. Même si ce chiffre n'est plus guère cité car il est trop visiblement hors de portée, la pression est là et elle va dans ce sens. Aucune autre pression contraire n'est suffisante pour l'endiguer, surtout pas celle des salariés. Bien entendu le système est mondial, et la pression se transmet par les OPA. Toute entreprise qui n'atteint pas les rendements exigés par les actionnaires nouvelle manière est opéable. Les engagements de respect de l'emploi et de non-délocalisation pris par les acteurs de ces OPA sont peut-être sincères certains sont de vrais industriels mais ils ne sauraient tenir longtemps devant cette pression actionnariale. C'est là le sens de l'opération Mittal-Arcelor, même si elle a en plus des motivations de stratégie industrielle propres. Cette OPA rentre dans un corps de règles que nous avons acceptées. Mais elle nous aide à comprendre le système. Et le système va à sa perte. Toute l'Asie émergente sera dans les vingt ans qui viennent en état de conquérir par OPA toutes les entreprises d'Europe et d'Amérique du Nord. En effet, les prix étant maintenant homogènes sur un marché mondial unique, les différences de niveaux de salaires assurent aux entreprises asiatiques et pour très longtemps une profitabilité actionnariale hors de proportion avec ce qui est possible en pays développé. Le Japon, notamment, sera le premier à ne pas s'en remettre. Je ne vois hélas aucune autre solution que celle d'arrêter cela tout de suite, et par la loi. Car il n'y a aucune raison que cela s'arrête. Si nous laissons passer celle-là, des centaines d'autres suivront. Les OPA sont admissibles et utiles dans un ensemble à peu près homogène, relativement maître de sa cohésion sociale, et capable de maintenir un certain équilibre entre profits, salaires, services publics et protection sociale. Une déstabilisation massive venant de l'extérieur est annonciatrice de convulsions sociales gravissimes. L'Union européenne doit interdire les OPA sur son territoire à tout groupe dont 20 % de l'activité ou plus viennent d'ailleurs. C'est une question de survie. |
 |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
| ||