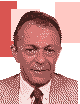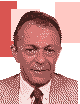| | L'adhésion de la Turquie est-elle compatible avec une intégration accrue de l'Union européenne ?Je ne vois aucune incompatibilité entre l'essence du projet européen et la perspective d'une adhésion éventuelle d'Ankara à l'Union. La candidature turque n'aurait pas été envisageable dans l'Europe à six. Il est certes évident que cette candidature turque ne facilite pas l'émergence d'une cohésion politique en Europe. Mais dans un contexte planétaire hautement troublé, une adhésion de la Turquie constituerait une contribution précieuse à la pacification du monde, une aide à un début de « détente ».
En quoi l'adhésion d'Ankara pourrait-elle déjouer le risque d'un « choc des civilisations » ?Nous autres, Occidentaux, sommes visés par un terrorisme apocalyptique nourri d'humiliation qui recrute au sein des élites musulmanes occidentalisées. L'urgence, c'est d'isoler ces activistes des populations dont ils instrumentalisent la misère ou le désespoir. Il faut aussi trouver des alliés, au sein du monde arabo-musulman, pour triompher des forces de destruction qui s'y donnent libre cours. La politique menée par George W. Bush depuis le 11 septembre 2001 court le risque d'apparaître comme une agression indiscriminée contre le monde musulman dans son ensemble ! Et la prophétie de Huntington, celle du « choc des civilisations » - que l'auteur du livre du même nom voulait à tout prix prévenir - constitue désormais une menace imminente.
C'est-à-dire ? Pensez-vous à la réélection de George W. Bush ?Bien sûr, car le président des Etats-Unis, en attisant l'antagonisme avec le monde arabe, pourrait, si nous n'y prenons garde, déchaîner le « choc des civilisations », avant même que nous ayons pu, en Europe, progresser sur la voie de l'intégration. En l'absence de politique étrangère concertée, l'Europe a tout de même une chance : une nation musulmane, exemplaire par sa modération, frappe à sa porte. Ne serait-ce pas folie que de lui adresser une fin de non-recevoir ? Pourquoi devrions-nous manquer une occasion unique de nous démarquer de la diabolisation « bushiste » globale du monde arabo-musulman ? L'adhésion de la Turquie est à mes yeux une affaire d'assurance-vie.
Même si une majorité de citoyens de l'Union exprime les plus vives réserves ?Reste en effet que nos opinions publiques renâclent visiblement à la perspective de l'adhésion turque, parce qu'elles manquent des outils intellectuels pour en saisir la nécessité.
Ne craignez-vous pas, avec ce type d'argument, de renforcer la défiance croissante de l'opinion française pour les « élites » ?Non, parce que la candidature d'Ankara oblige à se projeter au-delà de l'horizon de la pro chaine campagne électorale. Et force à s'arracher à l'hypnose du court terme. L'adhésion turque s'impose à l'horizon des quinze années à venir ; dans l'immédiat, elle posera certes plus de problèmes qu'elle n'en résoudra. Mais le « temps long » doit primer. Par ailleurs, une grande partie de l'opinion française est ignorante des raisons stratégiques qui rendent vitale pour nous l'adhésion d'Ankara. Enfin, nos opinions manifestent une incapacité à penser l'Europe présente autrement que comme des « Etats-unis d'Europe » imaginaires. Il faudrait, au contraire, tuer le cadavre des « Etats-Unis d'Europe » pour pouvoir commencer à réfléchir efficacement sur notre lien à la Turquie.
Au risque de renoncer à tout effort d'« approfondissement » ?L'Europe souffre d'une incapacité évidente à faire rayonner son modèle politique, pas seulement par les seules vertus de sa structuration économique et sociale, mais aussi sur le plan - plus fondamental et sans doute plus décisif - de ses valeurs. Mais, pour peu que nous considérions la longue durée, il apparaît que le risque d'une érosion de la cohérence de l'Union européenne a en fait été couru dès l'adhésion de la Grande-Bretagne. Nos amis britanniques ont, dès le départ, rejeté la vision d'une Europe intégrée autour d'un noyau dur. Partisans d'une compétitivité et d'une efficacité économique européennes dans une Union conçue comme un grand marché, ils se tiennent obstinément à distance du concept d'édifice politique.
L'approche anglo-saxonne de l'architecture de l'Union serait, à vous entendre, la cause réelle de la crise de vocation que traverse l'Union...Oui, parce que cette approche prédomine chez les derniers Etats à avoir bénéficié de l'élargissement. D'où, notamment chez les nouveaux adhérents, l'appel à des « valeurs chrétiennes » censées parer au lézardement inéluctable de l'édifice. Or il est extrêmement dangereux de ressusciter le rêve carolingien et hautement périlleux de promouvoir une idée de l'Europe qui, se pensant comme un « club chrétien », se définirait par opposition aux autres démocraties du mon de - et notamment à la démocratie turque. Il serait dommage qu'une Europe qui doute de son identité en rajoute sur les exclusivismes civilisationnels, quitte à recaler la Turquie. L'issue réservée à la candidature turque aura d'ailleurs valeur de test dans l'ensemble du monde arabe.
L'argument selon lequel un non à Ankara équivaudrait à jeter les Turcs dans les bras des islamistes ne ressemble-t-il pas à un chantage ?Je ne le crois pas, et ceux qui se font une spécialité de la dénonciation du « chantage » d'Ankara seraient plus inspirés de s'interroger sur l'autisme croissant de nombreux Européens.
Que voulez-vous dire ?Je suis extrêmement navré que les Européens, et notamment les Français, n'arrivent pas à prendre conscience de ce que l'Europe est devenue. Ce qui frappe, c'est, d'abord, la chute vertigineuse du poids de l'Europe dans les affaires du monde. Autocontemplation morose et désenchantement conditionnent le regard que portent la plupart des Européens sur le rayonnement de leur continent, notamment en matière de politique étrangère...
Finalement, vous rejoignez les vues d'un néoconservateur américain comme Robert Kagan !Ecoutez, il suffit, par exemple, de voir notre impuissance passée en Yougoslavie et la réédition de cette impuissance au Proche-Orient. Cette impuissance n'a rien à voir avec une quelconque « féminisation » de l'Europe, que Kagan a cru pouvoir dénoncer. Non, c'est bien plutôt d'une illusion présomptueuse de puissance et d'influence que souffrent les «vieux Européens». Ils ressassent indéfiniment l'inaboutissement du rêve européen, dont la condition symbolique serait le vote de la politique étrangère à la majorité : un vote, proposé, puis refusé, coup sur coup, à Amsterdam, à Maastricht, à Nice, dans le projet de Constitution élaboré par la Convention et dans celui de conférence intergouvernementale qui a suivi.
A quoi attribuez-vous justement l'inaboutissement du rêve fédéraliste européen ?L'un des drames de l'Europe est qu'elle est vouée à l'« intendance », pour reprendre les termes - profonds et toujours valables - de Charles de Gaulle. Il est attristant que l'Union soit le domaine exclusif de l'argent, du travail, du capital, de l'investissement et de la fiscalité - domaines arides qui ne suscitent aucune adhésion émotionnelle ! L'Europe n'a pas compétence pour la paix, la guerre ou la souffrance du monde.
N'est-ce pas la difficulté à absorber les élargissements successifs qui suscite une crise de confiance dans l'Union ?Je ne renie pas mon attachement envers la construction européenne. Et ma « mélancolie » n'est nullement un déguisement de la résignation. Sans l'Europe, les Vingt-Cinq auraient aujourd'hui 4 millions de chômeurs supplémentaires, dont près de 300 000 en France ! Mais le vrai problème, c'est que l'Europe est incapable d'être un rassemblement efficace de volontés. Elle s'avère ne pas être un espace régi par la volonté politique - mais par le droit et la règle !
Un espace dominé par le « processus vital » décrit par Hannah Arendt ?Exactement ! Dans cette Europe fonctionnelle nous partageons la gestion de nos affaires communes, tout en préservant la souveraineté de nos gouvernements dans les matières fiscale, sociale, éducative et culturelle. Nous nous sommes dotés de blocs de règles d'une extrême efficacité - ils ont l'immense mérite d'être les déclencheurs d'une meilleure prospérité et aussi de puissantes incitations à la réconciliation, à commencer par les Français et les Allemands -, mais d'une portée limitée.
Pourquoi cette dynamique pacificatrice et créatrice de richesse bute-t-elle, à vous entendre, sur un obstacle ?Peut-être parce que la volonté de faire l'Europe fut, dès le départ, d'essence géopolitique.
Géopolitique, c'est-à-dire fondée sur le désir de paix – non d'actions politiques communes ?Exactement. Ce qui a porté l'Europe sur les fonts baptismaux, c'est le vœu de rendre la guerre impossible entre nos pays. Vœu ô combien louable, évidemment - mais insuffisant. Jean Monnet avait parfaitement compris les leçons du passé et il avait redonné une actualité aux plaidoyers pour les Etats-Unis d'Europe qui se sont succédé à partir de celui de Victor Hugo, en 1851. Le deuxième grand plaidoyer, qui apparut après la guerre de 1914-1918, fut l'oeuvre de Briand et Stresemann, et il resta lettre morte. Mais Jean Monnet dut vite revoir ses ambitions à la baisse.
A cause de l'échec de la CED ?Monnet eut l'intuition que les symboles de souveraineté étaient intransférables, et il préféra opter pour la création d'interdépendances techniques capables de ne pas heurter les susceptibilités nationales, tout en gardant une force de cohésion suffisante et leur aptitude à créer de la prospérité. Les standards paneuropéens passent sous silence la question fondamentale de la sécurité.
Que voulez-vous dire ?Si l'on veut remonter aux sources du malaise européen actuel, il faut comprendre que la sécurité demeure le souci principal qui agite l'inconscient de chaque peuple. On doit bien garder à l'esprit les méfiances suscitées par la guerre froide. Je suis convaincu qu'elles demeurent extrêmement vivaces. Souvenons-nous : à l'époque de l'antagonisme Est-Ouest, les Anglais ont joué «solo», en se dotant, au terme d'un traité plaçant l'armement nucléaire britannique sous le commandement commun de l'alliance, d'un droit d'en faire seuls usage, au cas d'une menace pour les intérêts vitaux du royaume. Tous les non-nucléaires d'Europe ont prié pour que la garantie nucléaire des Etats-Unis leur reste acquise. La France comprit vite qu'elle avait intérêt à se doter de l'arme nucléaire. Or, quand la France s'est dotée de la bombe nucléaire, il s'agissait d'une bombe Otan, et Paris siégeait paisiblement à l'ombre d'une organisation prônant la doctrine des représailles massives.
Rappelez-nous en quoi consiste alors cette doctrine de l'Otan...La doctrine des représailles massives consistait à faire peser sur l'autorité soviétique, au cas de la moindre velléité d'agression contre le territoire de l'Europe ou de l'Amérique du Nord, la menace d'une riposte indiscriminée et massive, susceptible de détruire 200 millions de personnes. Cette garantie était d'autant plus efficace qu'elle était valable pour tous les alliés, quelle que dût être la forme de l'attaque russe. Mais elle entraînait, du même coup, par son caractère automatique et aveugle, la crainte d'une utilisation accidentelle du feu nucléaire, comme en témoigna le succès du film Docteur Folamour. Sous l'influence de son secrétaire d'Etat à la Défense, Robert McNamara, qui l'alerta sur les potentialités ravageuses de la riposte massive, John Kennedy infléchit rapidement la doctrine stratégique des Etats-Unis et de l'Otan en doctrine de riposte flexible. Les Américains, en adoptant cette doctrine, ont donc indiqué aux Soviétiques qu'ils ne tireraient pas le feu nucléaire les premiers. Traduction libre pour les Européens : « Nous viendrions vous délivrer en cas d'attaque soviétique, mais, le cas échéant, après l'utilisation du feu nucléaire par votre envahisseur.» De Gaulle se donna quatre années, de 1962 à 1966, pour prendre acte du changement de stratégie des Etats-Unis.
Et que fit le Général ?Il décida de se doter du même niveau de privilège diplomatique que la Grande-Bretagne – ce qui supposait, en l'absence de protocole annexe pour la France, le retrait pur et simple de ses troupes de l'Otan. Henry Kissinger m'a confié en 1991 que de Gaulle avait raison d'être méfiant et qu'effectivement aucun président des Etats-Unis n'aurait déclenché le feu nucléaire pour défendre autre chose que son territoire et son propre peuple. Et Kissinger ajoutait que, si les Américains avaient compris assez tôt quels malentendus leur doctrine de riposte flexible était susceptible de causer, il y aurait eu moins de malentendus dans le pilotage de l'Otan. J'ai eu l'occasion de relater cette discussion... à McNamara. Il donnait entièrement raison à Kissinger sur le premier point, mais lui donnait tort sur le second. Sur le premier point, m'a expliqué McNamara, Kissinger avait entièrement raison parce qu'il était évident pour les Soviétiques que la doctrine de riposte flexible leur ouvrait un boulevard pour des actions guerrières conventionnelles, en Pologne, aux frontières de l'Allemagne de l'Est ou même en territoire autrichien, pour lesquelles les Soviétiques possédaient une force conventionnelle bien supérieure à la force cumulée de la Bundeswehr et de l'armée française... Sur le second point, il m'a dit qu'à ses yeux les Américains étaient beaucoup trop arrogants pour accepter de tirer d'un raisonnement exact une conclusion de partage du pouvoir. Du coup, quand de Gaulle a pris la décision de retirer les troupes de l'Otan, en 1966, l'Elysée et le Quai d'Orsay se sont confinés dans un tête-à-tête agressif avec les Etats-Unis, toisant avec mépris les « nains » (les « non-nucléaires ») dont la France a, dès lors, donné l'impression de négliger la sécurité.
Ne chargez-vous pas la barque des responsabilités françaises ?J'évoque des pans d'histoire tombés dans l'oubli. Le sentiment qui prévalait chez tous les Etats européens continentaux non nucléaires était que la France passait leur sécurité par pertes et profits et qu'en irritant les Etats-Unis, en mettant à l'épreuve la nécessaire confiance transatlantique, elle prenait le risque de fragiliser la sécurité européenne. L'Europe pouvait bien tenter d'ériger la prospérité en nerf de l'économie tout en cherchant à faire échec aux tentatives monopolistiques des Américains, aucun peuple européen ne voyait sa sécurité reposer sur une autre puissance que les Etats-Unis. Et, lorsque cinq ou six ans après la chute du mur de Berlin la France a offert de rentrer dans l'Otan en évoquant, par la voix de Jacques Chirac, la nécessité d'un transfert du commandement sud sous le contrôle d'un amiral européen, cela a été ressenti comme une provocation déplacée et superflue contre le commandement américain...
Vraiment ?Oui, parce que le commandement sud est un poste à double casquette qui, même au sein de l'Otan, ne peut pas se partager : l'amiral du commandement sud est aussi l'amiral qui commande la sixième flotte et il appartient, donc, à la chaîne du commandement nucléaire américain ! Plutôt que de projeter l'impression d'une arrogance de la France, Chirac aurait dû expliquer ce qui motivait sa proposition. Il aurait dû plaider qu'avec la fin de la guerre froide les Américains ne souhaitaient pas forcément être inclus dans les moindres décisions des Européens sur des conflits les concernant (Afrique, Maghreb), comme cela s'était déjà vu en Yougoslavie. Or l'histoire est autant le produit des représentations que des événements. Conséquence : aucune émergence d'une politique étrangère européenne n'est observable, et le rêve européen auquel j'ai adhéré dans ma jeunesse - celui des Etats-Unis d'Europe - n'a jamais abouti.
Vous déplorez qu'il n'existe pas de politique étrangère commune. N'est-ce pas donner raison aux partisans du non à la Constitution ?Je l'ai dit : les Etats-Unis d'Europe sont un rêve évanoui. Et l'Europe, en effet, n'a pas de politique étrangère commune. Même si, sur de nombreuses questions - comme celle du Proche-Orient -, des convergences frappantes existent entre Etats membres. Reste - et c'est ma divergence de fond avec les partisans du non au traité constitutionnel - que l'Europe constitue d'ores et déjà, dans un monde mis à feu et à sang par le « clash » entre « McWorld » et « Jihad », un espace précieux de pacification et de stabilisation. Arnold Toynbee avait raison d'affirmer que « le déclin des civilisations commence quand elles se militarisent ». Les vertus d'extension de la paix par osmose sont plus nécessaires que jamais dans le monde d'aujourd'hui. L'avenir pour l'Europe, face au terrorisme en provenance du monde musulman, c'est, contrairement à ce que s'imaginent les « faucons » de Washington, le choix du « soft power » et de l'action stabilisatrice. Donner leur première victoire aux forces de désagrégation européenne en votant non à la Constitution, ce serait commettre un geste mondialement dangereux, car contribuant, dans un tel climat, à l'aggravation des haines et des conflits.
|