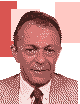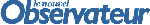| | Comment expliquez-vous l'ampleur du conflit d'Air France ?
Plus encore que dans d'autres conflits, c'est l'excès d'injustices qui a provoqué la colère. Quelqu'un, quelque part, n'a pas compris que l'idée d'exécuter un accord d'entreprise datant de 1982 - qui donne une prime à certains navigants au moment même où l'on restreint les salaires des non-navigants qui sont beaucoup moins bien payés - allait provoquer un choc. Cette grève est très symbolique. Elle me rappelle celles de Berliet et de Saviem au début de l'année 1968. Même colère de la base, même démarrage hors contrôle syndical, même mise en cause des hiérarchies, même ampleur, même unité syndicale pour tenter de contrôler le mouvement, même solidarité de l'opinion avec les grévistes.
Cette référence à l'hiver 1968 vous fait-elle penser qu'il pourrait aussi y avoir un printemps 68 ? Edouard Balladur en tout cas l'a redouté. Non, Mai-68, c'est la société tout entière qui bouge. On n'en est pas là. Et puis Mai-68, c'est aussi une période de croissance et de plein emploi. On n'en est pas là non plus !
Le gouvernement a-t-il eu raison de reculer ?Il a surtout eu tort d'avancer comme il l'a fait ! Durcir le plan du PDG, qui passe de 3 000 à 4 000 suppressions d'emplois, faire le fanfaron en affirmant « le plan est irrévocable », puis, en pleines négociations, d'un seul coup, lâcher tout et laisser le PDG à découvert, ce n'est pas exactement l'idée que je me fais d'une bonne gestion gouvernementale. D'autant que cela devient une habitude. Souvenez-vous : il y a un mois et demi, Edouard Balladur a soi-disant découvert, en lisant la presse, que les différents plans de restructuration de plusieurs grandes entreprises nationales tombaient en même temps et provoquaient la suppression de 17 000 emplois. Et le Premier ministre de feindre une colère publique et de demander aux chefs d'entreprise de revoir leur copie ! De qui se moque-t-on ? Qui connaît la machine de l'Etat sait que ces plans ont nécessairement été soumis à Matignon et qu'ils n'ont pu être annoncés qu'avec son feu vert.
Donc, selon vous, le gouvernement Balladur est incompétent ? Disons que depuis le début ses qualités de communicant m'impressionnent plus que ses qualités de gouvernant, surtout aux premiers signes de tempête.
A sa place, le dimanche 24 octobre, vous n'auriez pas cédé ? Je pense sincèrement surtout que je ne me serais pas laissé acculer comme il l'a fait. J'entretenais avec mon cabinet, les Finances et le ministère de tutelle, les Transports, des relations qui m'auraient sans doute évité de me retrouver dans cette situation.
Pensez-vous que le conflit d'Air France peut avoir des conséquences politiques pour le gouvernement Balladur ? Je ne veux pas mettre d'huile sur le feu. Je dis seulement qu'il y a de quoi être inquiet pour l'avenir.
Faites-vous confiance à votre ami Christian Blanc pour redresser les comptes d'Air France et préparer la privatisation de la compagnie ? Pourquoi le gouvernement est-il allé le chercher ? Parce que c'est un homme qui, à la fois, a le sens du dialogue et résiste dans les tempêtes. Je suis sensible au fait qu'il y ait un certain nombre d'hommes de cette qualité parmi mes amis. En le nommant, le gouvernement a aussi voulu prouver que le PDG d'Air France avait une certaine autonomie, une capacité de décision. Mais il s'agit d'une entreprise publique. Le PDG est responsable devant son actionnaire unique, l'Etat, qui est le décideur ultime. Le gouvernement sera-t-il capable de passer un accord durable avec le nouveau PDG et de tenir ses engagements ? Quant à la privatisation que vous évoquez, faut-il rappeler que j'y suis résolument hostile ?
Passons aux 32 heures... Je préfère parler de la semaine de quatre jours. Il faut d'abord faire comprendre aux Français qu'il ne s'agit pas seulement d'un moyen de lutter contre le chômage mais aussi d'un changement de mentalité et, à terme, d'un changement de société. Que constate-t-on aujourd'hui ? La réussite sociale se mesure presque exclusivement au succès professionnel. Très peu de gens tirent leur épanouissement personnel d'autre chose que de leur travail. C'est cela qu'il faut commencer à changer. Il faut pouvoir vivre autrement. Avec trois jours d'arrêt hebdomadaire, des hommes, des femmes pourront s'accomplir différemment, par exemple en participant à la vie associative, à des activités sportives, culturelles, ou tout simplement en consacrant davantage de temps à leur famille, à leurs amis, etc. Pour certains, ce sera l'occasion de compenser les frustrations de leur vie professionnelle. C'est pour cela que j'insiste sur le décompte en jours plutôt qu'en heures : il s'agit de casser cette référence exclusive à l'organisation du travail.
Comment expliquez-vous les réticences très fortes à vos propositions ? Je suis frappé du blocage de beaucoup d'esprits qui pensent que nous sommes brusquement devenus utopistes, irresponsables, fous, ou qui s'imaginent que la France va pouvoir continuer longtemps comme ça. Il faut tout de même conserver quelques références historiques. L'horaire moyen de travail était de 60 à 80 heures en 1850. Nous en sommes à mi-temps. Depuis quarante ans, alors que la productivité a fait des progrès considérables, alors que la révolution de l'informatique bouleverse tout, nous sommes bloqués autour des 40 heures. Puis-je rappeler qu'en 1930 un certain Keynes, qui n'était ni un irresponsable ni un révolutionnaire, écrivait : « Peut-on imaginer que dans cinquante ans d'ici on travaillera autour de 30 heures par semaine ! » La vérité, c'est que nous avons cessé d'avoir de l'audace. Quand on fonce droit dans le mur, il faut faire quelque chose. Le moment est venu de casser les tabous, les conformismes.
Puisque vous citez Keynes, on vous reproche souvent de ne pas avoir évolué au cours des dernières années, d'être resté précisément trop keynésien. On m'a plutôt reproché le contraire : avoir conduit selon certains une politique trop orthodoxe ! Mais laissons tomber ce qui se dit et allons à l'essentiel : la vision keynésienne est beaucoup plus orientée vers l'expansion et la croissance que ne l'est la vision monétariste. Cette dernière, on la découvre enfin pour ce qu'elle est : malthusienne. Il nous faut revenir à Keynes. Mais le maniement de ses outils suppose un espace délimité et un pilotage compétent et unique. L'Europe n'en est malheureusement pas encore là.
Revenons aux quatre jours hebdomadaires. N'est-ce pas une utopie alors qu'en Allemagne on parle d'augmenter le temps de travail ? Je rappelle d'abord que les Allemands travaillent moins que nous. Mais le problème n'est pas là. Qui parle de travailler moins ? Nous disons nous aussi : il faut travailler plus. Mais travailler plus, cela veut dire mettre au travail un plus grand nombre de Français.
Quand vous étiez à Matignon, vous ne parliez pas de réduction du temps de travail. Quand avez-vous été convaincu ? Il y a un peu moins d'un an. A Matignon, le chômage a été ma préoccupation constante. 800 000 emplois ont été créés en deux ans et demi. Le chômage a diminué de 260 000. Ce résultat encourageant était dû à une croissance de 3 % et à mes différents plans pour l'emploi. Ma faute, ou mon excuse, c'est que j'étais satisfait de voir le chômage baisser de mois en mois. Lorsque la croissance a chuté, il a augmenté à nouveau. Le fait de quitter Matignon m'a donné une liberté intellectuelle plus grande. J'avais conscience du caractère déflagrant du chômage mais je n'avais pas encore mesuré que, même avec une gestion attentive de la croissance, il nous faudrait quinze ans pour traiter le problème. Or quand il devient facteur de délinquance et de désintégration de la cohésion sociale, on n'a pas ces quinze ans !
Vous avez dit au Bourget que les réductions du temps de travail devraient être assorties de réductions de revenu. Pouvez-vous être plus précis ? Plus précis, oui. Directif, non. Il ne faut pas procéder de manière autoritaire, par la loi. En juin 1936 et en janvier 1982, on a beaucoup bloqué en prenant des mesures unitaires et forfaitaires. Les compensations ne peuvent pas être les mêmes dans le public, le privé, l'administration, les charbonnages, la sidérurgie, les transports routiers ou la restauration. Tout doit être négocié branche par branche, peut-être même région par région. La loi, dans un premier temps, doit seulement donner une perspective et fixer un calendrier. Dans un deuxième temps, au bout de six mois ou un an, là où les négociations auront échoué, l'Etat pourra intervenir. C'est aussi à lui d'organiser des systèmes compensatoires. Naturellement, je l'ai dit au Bourget, il ne faudra pas diminuer les revenus qui sont en dessous de deux fois, deux fois et demie le Smic.
En dessous de 12 000 francs de revenu mensuel, on ne touchera donc à rien ? Tout à fait. Mais, je le répète, il ne faut rien formaliser, rien brusquer, sinon, on va se planter. On ne change pas la société par décret. Mon souhait, c'est une loi directement inspirée par des accords interprofessionnels entre le CNPF et les syndicats ouvriers.
Contrairement aux autres, vous dites qu'il ne faut pas que la compensation porte uniquement sur le salaire mais sur l'ensemble des revenus. Mieux vaut parler des compensations plutôt que de la compensation. Elles seront multiples. Mais, là encore, il faut, pour se donner de la souplesse, utiliser toute la gamme des possibilités : déductions d'impôt, subventions de l'Etat, TVA, cotisations, dispositifs de formation, etc. Pensez seulement qu'on dépense actuellement plus de 200 milliards de francs d'allocations de chômage. Pourquoi ne pas en réorienter au moins une partie vers l'activité ? D'autant que les gens remis au travail redeviendront productifs : ils créeront de la valeur ajoutée, ils verseront des cotisations sociales, ils consommeront, etc.
Si les autres Etats européens ne sont pas d'accord pour réduire le temps de travail, peut-on jouer seuls, n'est-ce pas une utopie ? Vous posez le problème de la compétitivité de nos entreprise, c'est-à-dire le problème du coût horaire de la main-d'œuvre. Faites-moi confiance, j'y ai réfléchi. L'équilibre financier, je connais. Quand Chirac m'a passé le relais en 1988, le déficit budgétaire était de 135 milliards ; quand j'ai quitté Matignon, il était de 90 milliards. Il n'est pas question de mettre les équilibres en danger. Il est question d'organiser les choses de manière telle que les comptes d'exploitation des entreprises restent équilibrés. Si c'est le cas, on peut même jouer seuls et réussir. Cela dit, je préfère que d'autres pays européens nous suivent.
Vous avez proposé un grand emprunt européen de 50 milliards d'écus pour relancer l'emploi. Mitterrand vous a approuvé, mais il a doublé la mise...Tant mieux ! J'avais dit au moins 50 milliards d'écus mais, naturellement, tout ce qu'on pourra faire au-delà sera bienvenu. L'efficacité de ces 300 milliards de francs d'emprunt dépendra en outre de ce que pourront y ajouter les autres Etats européens, les provinces, les villes, le privé. Or, si l'Union européenne est peu endettée, les pays, eux, le sont. Mais 300 milliards venus de l'Union, cela signifie au minimum 1 000 milliards de francs concrètement injectés dans l'économie européenne. En tout cas, la prise de position du président renforce ma démarche et prouve que nous avons les moyens de raisonner sur de gros chiffres. Et Jacques Delors vient, lui aussi, de se prononcer pour un « new deal » européen.
Les autres Etats sont-ils prêts à un tel effort ? Ne nous cachons pas que nous entrons dans un combat doctrinal. Nous sommes engagés dans une contre-offensive idéologique contre les dérives libérales qui nous ont menés là où nous sommes. Dans tous les pays d'Europe on prend conscience des dangers de la dérégulation et des excès de la bulle financière, et du fait que seule la puissance publique peut garantir la protection et la cohésion sociales. Les socialistes ont gagné les élections en Espagne, en Norvège, en Australie, en Grèce. Les conservateurs ont été laminés au Canada. Leurs vainqueurs, les libéraux, sont beaucoup plus sociaux. Et le Bloc québécois est pratiquement social-démocrate. Il y a un mouvement. En 1981, la gauche française a gagné à contretemps. En 1993, c'est la droite qui l'a emporté à contretemps. J'avoue que j'espère beaucoup un retour au pouvoir des sociaux-démocrates allemands en 1994, britanniques... et français en 1995. Les Espagnols étant déjà au pouvoir, les quatre grands pays d'Europe seraient dirigés par des sociaux-démocrates. Croyez-moi, ça changerait beaucoup de choses.
Vous travaillez à un programme commun européen avec les autres partis socialistes ? Oui, il y a déjà une esquisse de programme qui fait cinquante-cinq pages. Je travaille aussi sur deux autres textes. Le premier est un engagement commun pour la campagne européenne, et le second un résumé de nos raisons politiques de vouloir l'Europe. Mais il y a mieux : nous avons créé le Parti socialiste européen. Les partis de l'Internationale socialiste constituaient une espèce de club. Désormais, ceux qui sont membres de l'Union européenne sont rassemblés, ils votent leurs orientations à la majorité avec obligation de discipline commune.
Pour les élections européennes, comment justifiez-vous la spectaculaire initiative que vous avez prise en imposant une parité d'hommes et de femmes sur la liste socialiste ? Vous savez qu'aux Etats-Unis l'exigence d'un quota, d'abord pour les Noirs, ensuite pour les femmes, a suscité des débats passionnés. Peut-on donner priorité au sexe sur le mérite ? On ne peut pas considérer la moitié de l'humanité, même un peu plus, comme une catégorie ! La logique des quotas est multicatégorielle : les Blancs, les Noirs, les Jaunes, les homosexuelsµ Je me suis toujours refusé à employer des quotas généralisés. Qu'ai-je voulu ? Les femmes sont électrices à égalité. Il faut aider à ce qu'elles soient élues à égalité chaque fois qu'on le peut. Le Parlement européen est récent, c'est un domaine presque vierge. Nous avons des femmes de qualité, nous les présentons. Et permettez-moi de relever que, sur les listes européennes, c'est dans la situation antérieure qu'on donnait priorité au sexe - à condition qu'il soit masculin - sur le mérite. Nous rééquilibrons. Si on ne le faisait pas quand c'est à la fois juste et possible, quand le ferions-nous ? Pour les élections uninominales, c'est différent : il faut des candidats connus, enracinés, qui ont une implantation locale. Les données du choix sont donc moins libres.
Vous qui avez été le condisciple de Jacques Chirac, seriez-vous enclin à porter sur lui le même jugement que celui formulé, à la surprise générale, par le président de la République ? Je juge des orientations politiques et des actes. Pas la psychologie d'un homme.
Avez-vous une position plus précise que lorsque vous étiez au gouvernement sur l'opportunité et la possibilité d'endiguer les flux migratoires ? Quelle serait votre attitude si demain plusieurs centaines de milliers d'Algériens voulaient se réfugier en France ?Sur le premier aspect, un rappel : qu'est-ce qui nous épargne une pression migratoire fantastique en provenance d'Extrême-Orient ou d'Amérique du Sud ? Le fait que ces pays se développent. Le développement est le seul moyen de tarir à la source l'immigration clandestine. Tout le reste, ce sont des rustines. Sur le second sujet, second rappel : on n'a toujours pas vu les « centaines de milliers de réfugiés » qu'on nous annonçait venant de l'Est. Ce sera pareil pour l'Algérie. Cela dit, si doivent venir en France des Algériens menacés pour avoir combattu l'intégrisme, évidemment nous devons les accueillir.
François Mitterrand a rappelé qu'il avait fallu quinze ans à Blum pour parvenir à la victoire du Front populaire, et dix ans à lui-même pour accéder au pouvoir. Il a jugé que le temps qui vous était imparti jusqu'à la présidentielle de 1995 était bien court ! Mitterrand a pris le parti à 12 % en 1971, et il n'a perdu que d'un cheveu en 74. Moi, je pars de 19 %. Alors !
Dix-huit mois, c'est quand même bien court pour redonner une identité au PS. Vous avez vu ce que nous venons de faire en six mois. J'ai repris dans des conditions contestées un parti naufragé. Il a tenu des états généraux et un congrès dans l'unité, sans revenir à la culture inflationniste et tout en restant européen. En dix-huit mois, nous allons reconstruire la maison et faire connaître un projet de société centré, non plus sur la vie professionnelle seulement, mais sur la vie.
|