La social démocratie doit savoir ce qu'elle veut
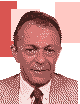
(12 juillet 2005).
La social démocratie doit savoir ce qu'elle veut | 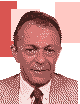 |
(12 juillet 2005). | |
Dans la situation d’incertitude où sont actuellement les socialistes, et particulièrement
les français, la priorité me paraît à l’évidence être celle de la clarté des objectifs et de la stratégie. Il n’y a d’alliances possibles pour les prochains combats et, parmi nous de réconciliation éventuelle et de restructuration de la Direction possibles qu’en fonction directe de cette redéfinition des objectifs et de la stratégie. Or entre ouistes et nonistes nous n’avons plus ni les mêmes objectifs ni la même stratégie ni les mêmes alliés. Ce n’est pas en faisant semblant de le nier que nous résoudrons le problème. Nous avons conduit nos derniers combats tant en France qu’en Europe, en limitant arguments et enjeux aux seuls aspects internes de ces batailles. C’était flagrant dans la récente campagne référendaire, et particulièrement dommageable parce que la construction et la perspective européennes ne prennent leur vrai sens qu’à l’échelle mondiale. Du coup nous avons perdu. Aucun socialiste ne peut souhaiter, ni même imaginer l’Europe comme un club de pays riches organisant en commun l’efficacité et l’harmonie de leur vie économique et sociale en s’isolant du reste du monde, et en opposant des politiques seulement défensives aux influences et aux pressions économiques et financières venant d’ailleurs et notamment d’outre Atlantique et d’Asie. Bien au contraire, l’évidence s’impose que les rudes problèmes de l’Europe - le vieillissement et ses conséquences sur nos régimes sociaux, la restructuration d’industries vieillissantes, la résorption d’un chômage important et durable - sont non pas du tout marginaux mais de deuxième ordre par rapport aux lourdes menaces qui pèsent sur le monde et frappent l’Europe comme le reste. Du temps de l’Empire romain comme de la Grande Bretagne au XIXème siècle, la puissance qui commandait le monde était aussi la plus riche. Inattaquable financièrement comme militairement, elle ne dépendait de personne. Aujourd’hui les Etats-Unis affichent une dette extérieure de 600 milliards de dollars. Mais ce n’est pas l’essentiel : l’élément le plus grave dans cette situation est que le système financier américain aujourd’hui ne tient qu’à la condition de pouvoir emprunter au reste du monde 1,9 milliard de dollars par jour et que cette somme est en constante augmentation. Il faudrait pour que le système reste stable et que la capacité d’emprunt des Etats-Unis se confirme tous les jours, que le dollar reste stable lui aussi et ne menace pas de perdre de la valeur, que le budget de l’Etat Fédéral américain, lui au moins, soit équilibré, et que l’appareil productif affiche une croissance réelle fiable. Or toutes ces conditions font défaut. Le dollar est sur une pente à long terme de dégradation lente : les banques centrales d’Asie, y compris de Chine Populaire, qui le soutiennent en ce moment, déjà pour des raisons purement politiques, pourraient bien finir par se méfier vraiment. Le déficit du budget fédéral approche des 6 % du PNB, presque le double de ce qu’on reproche à la France. Enfin et plus gravement l’économie américaine est une économie de « bulle ». Il y avait en 1970 aux USA 40 % de travailleurs « manufacturiers » comme on dit dans leurs statistiques. Il en reste aujourd’hui 18 %, or cette catégorie comprend les « manuels des services » entendez les coupeurs de viande de Mac Do. Si l’on exclut les métiers de cette nature de la définition, il reste 11 % de la main d’oeuvre totale qui soit effectivement manufacturière. Les Etats-Unis désindustrialisent à tour de bras. General Motors et Ford sont en faillite. Et l’argent qui tourne est de manière dominante à intention spéculative. L’explosion de la bulle « e-economy », les activités de traitement de l’information, en 1997 a volatilisé quelques milliers de milliards de dollars en quelques semaines, mais n’a évidemment pas tari l’appétit spéculatif qui caractérise le capitalisme actionnarial actuel. Après l’effondrement de l’informatique, on s’est replié sur l’immobilier, c’est un petit peu plus sûr. Ce parasitage de l’épargne du reste du monde pour spéculer porte sur des sommes immenses. De ce fait, par dessus la bulle spéculative immobilière qui se développe aux Etats-Unis, un peu comme on en avait connu une en France fin 1980 début 1990 et qui avait explosé à mi décennie, se développe à toute allure une bulle sur la bulle à partir du crédit hypothécaire. Lorsqu’elle explosera, elle risque fort d’affecter profondément le cours du dollar, la capacité d’emprunt américaine… Il peut arriver n’importe quoi. Ce sera naturellement différent dans la forme de la grande crise de 1929 qui contribua à mettre Hitler au pouvoir, mais peut-être pas différent par l’ampleur. Et incidemment il peut sans doute suffire de l'énorme choc pétrolier rampant que nous subissons actuellement pour servir de déclencheur. Enfin pour limiter les dégâts et remettre de l'argent dans le gouffre boursier, Bush travaille sur l'idée stupéfiante de voler les milliards de dollars accumulés dans les caisses de retraites publiques pour les recycler vers la bourse, à tous risques pour les retraités. Cette bataille là aussi pourrait être un déclencheur. Je vous entends déjà, mes camarades… « Michel, tu pousses, on prépare notre 74ème Congrès. Sommes nous capables de nous rassembler ? Qui nous dirigera l’an prochain ? Voilà les vraies urgences. Tes trucs on s’en occupera après… » Précisément, ma raison d’insister là-dessus c’est que : Or il va de soi qu’une stratégie de ce type, qui intéresse le monde entier si elle ne peut s’appuyer que sur l’Europe, n’a pas grand sens ni grande chance de succès si elle est uniquement défensive. Résister au caractère volcanique des déséquilibres actuels du capitalisme n’est pas seulement une question de survie, c’est une question de modèle de société. A quoi servirait-il d’empêcher une explosion proche si c’est pour retomber dans le même système, toujours aussi inégal, instable et cruel ? C’est ici qu’il est important de savoir ce qu’on veut, et de le définir, sur le fond. Un de mes vœux les plus chers est que notre 74ème Congrès, enfin, et pour la première fois depuis 1920 - la reconstruction de la « vieille maison » après la scission communiste - sinon depuis 1905, notre fondation, définisse les mots, ne s’embarrasse pas de faux semblants et de faux débats, et dise clairement qui nous sommes et ce que nous voulons. Le capitalisme est un système injuste, cruel, dangereusement instable, mais terriblement efficace. Notre système actuel est un combiné entre l’économie de marché - offre et demande des entreprises et des personnes sont libres et s’ajustent comme elles peuvent - et la propriété privée des moyens de production et d’échange, qui donne la totalité du pouvoir économique et financier aux seuls capitalistes. Les deux sont dissociables : on peut imaginer aussi bien un marché sur lequel ne se présenteraient que des entreprises publiques, coopératives, mutualistes ou municipales, qu’un système corporatiste dans lequel le consortium des entreprises privées administrerait l’offre, la demande et leur confrontation. L’économie hitlérienne n’était pas très loin d’un Gosplan privé ! Nous vivons dans le cumul des deux et nous sommes confrontés à ses dérives. Dès l’origine - fondation de l’Internationale Socialiste par Jaurès en 1889 et du parti français en 1905 - nous avons choisi de défendre la liberté, et concrètement les libertés, fussent-elles bourgeoises, adjectif qui fut accolé à rien moins que les libertés de pensée, d’expression, de religion, d’association (y compris syndicale) et de vote, ou sociales comme les libertés d’accéder à l’école, à la santé et à l’emploi notamment. En 1920 l’Internationale fait un choix plus net encore : elle exclut Lénine et les bolcheviques, et refuse l’emploi de la contrainte pour imposer la société socialiste. Ce choix est toujours valide : il veut dire que nous rejetons la perspective d’une stratégie violente offensive –la révolution dans sa définition la plus limitative, car au sens strict la révolution est un changement de système quels qu’en soient les moyens- et que nous vivrons donc dans la forme du capitalisme née au XIXème siècle, ce combiné de marché et de propriété privée des moyens de production et d’échange, jusqu’à ce que nous en sortions démocratiquement. Le marxisme - ou pour être strict sa dérive Kautskyenne, mais laissons tomber cela - a pourtant conduit beaucoup de socialistes, il y en a encore dans nos rangs, à penser que jamais l’humanité ne pourrait corriger la cruauté, l’injustice et l’instabilité du capitalisme autrement que par une très vigoureuse intervention de l’Etat jusque dans le secteur productif. Ainsi s’explique la tentative communiste, ainsi s’expliquent aussi des tentatives beaucoup plus timides et limitées, infiniment plus démocratiques au demeurant, de maîtriser le système grâce au poids dans l’économie d’un état aussi puissant que le secteur privé : c’est le cas français, c’est celui de la Suède un temps, et après la deuxième guerre mondiale de l’Autriche. Rien de tout cela n’a marché. En URSS, le totalitarisme nécessaire à ce que le système tienne debout était un prix inadmissible, et les sociaux démocrates que nous sommes ont été soulagés autant que l’humanité tout entière de sa disparition. A l’ouest c’est l’inefficacité qui a mis ces efforts en doute. On ne produit pas et ne vend pas sans inventivité, rapidité, et discrétion. L’Etat n’est pas fait pour cela. Qu’il fixe de bonnes règles serait déjà beaucoup. Il n’y a pas de sociologie dans le marxisme, et Marx avait oublié que si l’homme est à la fois courageux, créatif, cruel et égoïste, il est aussi quelque peu paresseux : il lui faut la compétition pour travailler. Le génie de l’invention du marché, c’est de mettre la totalité de l’humanité au travail pour son avenir. Devant le constat d’échec de toutes les tentatives alternatives, les sociaux démocrates se sont progressivement ralliés à l’économie de marché - pas au capitalisme, à l’économie de marché. Les suédois l’ont fait en 1932, les allemands en 1959, les espagnols en 1979 peu après la sortie du franquisme. L’Internationale Socialiste l’avait fait dans ses textes reconstitutifs dès 1946, sans encore entraîner tous nos partis. Nous socialistes français n’avons jamais - c’est un de nos drames aujourd’hui et un sujet majeur sur lequel il faut que le Congrès tranche - fait ce choix de manière claire, conflictuelle et explicite. Le choix le plus net que nous ayons fait, qui exclut la perspective révolutionnaire et admet de fait la longue cohabitation avec le capitalisme et une sortie inévitablement progressive, mais en tous cas démocratique, nous l’avons largement oublié. Il est moins glorieux parce que moins courageux que les choix suédois, allemand ou espagnol puisque nous l’avons fait, étant au gouvernement, sous la contrainte de la balance des paiements. Pourtant il est essentiel. C’est Jean Poperen - nous étions en recherche de synthèse, mais grâce lui en soit rendue - qui a trouvé la formulation nécessaire pour décrire le mode de progression du socialisme auquel nous pensions tous : le compromis social. Cela se passait à notre 63ème Congrès, à Valence à l’automne 1981. Une phrase malheureuse, prise d’ailleurs à contre sens de ce qu’elle voulait dire, à propos de têtes à couper, a complètement occulté tout autre souvenir de ce Congrès. Sur le plan théorique, c’est pourtant ce jour-là, par ce vote là, que nous avons rejoint nos camarades sociaux démocrates. Simplement nous avons été, nous sommes toujours, plus timides que beaucoup d’autres pour en tirer les conséquences. Nous sommes donc sociaux démocrates, et fiers de l’être. C’était le nom initial de la 1ère Internationale, c’est toujours le nom de nos plus anciens partis, l’allemand et l’autrichien. Nous le sommes par signature des actes constitutifs de la 2ème Internationale et par notre propre choix, de ralliement à l’économie de marché et non bien sûr, jamais à la société de marché. La société de marché, elle, est devenue notre ennemie principale, l’objet central de notre combat. Mais avant de continuer pour décrire ce que cela implique pour l’Europe et la France d’aujourd’hui, il y a une autre controverse à traiter. Nous sommes sociaux démocrates, pas sociaux libéraux. Concernant notre Parti et nous-mêmes, socialistes de France au XXIème siècle cette alliance de mots a des connotations qui se veulent insultantes. Soyons donc clairs. La liberté fut sur près de deux siècles maintenant la valeur guide qui éclaira notre démarche. C’est elle par exemple qui nous a écartés de l’économie administrée. Combien de socialistes, partout, sont morts pour la liberté d’expression et d’association, pour le suffrage universel ou pour lutter contre la tyrannie. En matière politique, parce que nous défendons la liberté nous sommes des libéraux. Mais en politique justement la liberté s’exerce dans le cadre des règles qui en définissent le champ et les limites. C’est dit dès la Déclaration des Droits de 1789 et nous y sommes toujours fidèles. Or en matière économique le capitalisme actuel fait d’énormes efforts pour nous vendre une escroquerie intellectuelle monstrueuse : sur le marché la liberté se définit pour ses zélateurs par l’absence de règles. Injustices, fraudes, souffrance humaine découlent de ce que le capitalisme actuel accepte de moins en moins de règles, s’il en a jamais accepté. Techniquement cette vision folle sort d’une théorie économique dite monétariste, maintenant quadragénaire. On l’appelle aussi ultra-libéralisme. En tous cas elle est devenue non seulement l’obstacle principal à tout progrès social, mais même l’instrument majeur de la grande régression que nous vivons aujourd’hui, et notamment des vertigineux déséquilibres américains que j’évoquais ci-dessus. Laisser supposer, à travers une alliance de mots douteuse que le ralliement massif des socialistes, et notamment des français, à l’économie de marché implique de leur part l’acceptation de l’absence ou de l’insuffisance de règles qui caractérise le capitalisme actuel est un assez ignoble procès d’intention, qui traduit en fait le désir de dévier ou d’éviter le débat de fond. Qu’on en finisse au moins entre nous avec ces procédés. On ne peut l’éclairer, ce nécessaire débat de fond, qu’en précisant ce que nous voulons, notre projet de société. Le Parti y travaille, pour l’an prochain : bonne chance à nous tous. Je me limiterai donc au coeur du sujet. Le projet socialiste, c’est un mode de vie pacifique, digne, apaisé, combattant constamment toute forme d’injustice, et permettant à chacun d’accéder à des moyens d’existence décents pour pouvoir vivre dans le bonheur et l’épanouissement. Paul Lafargue le rappelle clairement dans cette inoubliable brochure qu’est « Le droit à la paresse ». Et tous les combats des socialistes depuis toujours - chez nous Baboeuf, Proudhon, Pierre Leroux, Jaurès et tant d’autres - ont toujours eu la dignité des hommes en première priorité, et les niveaux de salaires, de revenus et de protection sociale comme autant de conditions nécessaires à la manifestation de cette dignité. En bref les droits collectifs, l’égal respect dû à tout individu humain vivant, et la dignité profonde de l’être humain sont le coeur du projet socialiste, dont les conditions de production, de rémunération et de travail ne sont que les moyens de réalisation, tout indispensables qu’elles soient. Dans le travail précaire par exemple, la précarité est une situation encore plus indigne que la modicité de la rémunération. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement pour aujourd’hui : nous sommes en économie de marché mais elle marche très mal. Dans le cadre de l’économie de marché les urgences concernent : Mais l’essentiel concerne non pas le marché lui même mais sa relation avec le reste de la société. Il s’agit d’abord de ses limites, ou de ses bornes : Il s’agit ensuite des fonctions de l’Etat, qu’il y a urgence à restaurer : Tout cela est assez évident, emporte probablement l’accord de tous les socialistes, et
ne présente de difficultés que dans l’action : comment distinguer à chaque moment le possible
de l’impossible, et surtout dans quel cadre géographique : la France, l’Europe, le Monde ? J’y
viens. Mais à cette liste manque encore ce qui est à mes yeux l’essentiel, et fera la force de conviction du projet socialiste demain. Je veux parler du non marchand, du gratuit, du temps libre, de l'activité créatrice des hommes, du don, de l'échange des savoirs et des savoirs faire, de nos relations interpersonnelles, de l'associatif, du bénévolat et de tout ce qui ne se paye pas. Peut on accepter un système social dans lequel la dignité de chaque être humain ne se mesure qu'à ce qu'il gagne ? Peut on accepter de voir dériver notre relation au sport et à la culture vers des spectacles payants que l'on consomme passivement, alors que faire du sport, de la peinture, de la musique ou de la randonnée ne coûte à peu près rien si l'école vous y a initié et si la vie associative vous soutient, et vous fait vivre de toutes autres émotions ? Dans la vie professionnelle peut on tolérer que l'expérience, le savoir faire, la qualification professionnelle et les travaux réalisés comptent pour rien ou peu de choses lorsqu'il s'agit de licencier ? Tous ces exclus dont nous parlons tant ont bien sur besoin d'une solidarité financière, mais ils ont encore plus besoin que leur dignité soit reconnue et respectée. C'était un peu cela, l'insertion dans le RMI. Cette jeunesse en déshérence, et qui parfois nous fait peur, ne le serait elle pas un peu moins si dans nos temps de vie il y avait plus de place pour les relations parents-enfants et le suivi scolaire ? Peut on ignorer plus longtemps que dans toute vie humaine les plus belles émotions, d'amour, d'amitié, de performance sportive ou artistique, de création, n'ont en général pas grand rapport avec l'argent ? Nous sommes un peuple qui ne chante plus guère, ou qui chante faux. Pourtant, quelle joie de chanter. La vie, la vraie, c'est cela aussi. Pour les riches comme surtout pour les moins riches. Notre devoir de socialistes est d'assurer le minimum juste et décent sans lequel rien n'est possible. Mais notre devoir est aussi de rendre possible cet épanouissement. J'ai même le sentiment que notre discours économique est reçu avec des réserves - pas plus dans les classes populaires qu'ailleurs les gens ne sont naïfs, ils savent très bien le poids du capitalisme, les contraintes, la longueur du temps nécessaire - alors que le discours du temps libre, du gratuit, de la création, de l'amitié, de la pratique sportive et culturelle est, lui, nécessaire, attendu, et rapidement porteur de confiance. Les politiques nécessaires sont multiples mais connues : Nous devrions être capables de nous mettre d'accord sur ce que nous voulons. Mais je
reste surpris de ce que si peu de socialistes attachent de l'importance à ce qui se passe en
dehors du travail et de l'argent. Pour moi c'est au contraire principalement dans le non
marchand que se situe l'espoir de vivre autrement, et que peut se refonder la confiance dans le
combat des socialistes. Une telle vision du projet des socialistes n'a rien de purement français. Nous en partageons l'essentiel avec toute l'Internationale Socialiste, la plus importante formation politique présente dans le monde entier, mais surtout avec tous nos camarades du parti des socialistes européens. Un projet de société ambitieux, chaleureux, mais réaliste est une condition majeure des succès futurs. Mais il est inopérant s'il n'est appuyé sur une stratégie. Or c'est là que ça commence à coincer. Il y a en effet des conditions de validité à ce projet : la disparition de la pauvreté, la réduction des inégalités, la restauration de la puissance de la sécurité sociale et de l'Etat, responsable, lui, des services publics, de la fixation des règles et pour une part majeure de l'invention de l'avenir. Or ce sont justement ces éléments là que le capitalisme actuel s'acharne à interdire. Les forces économiques, financières et politiques conservatrices qui jouent dans ce sens dominent pour le moment le monde presque entier, et ont une telle puissance qu'à l'évidence aujourd'hui aucune nation isolée n'y peut résister, pas même complètement la Chine et sûrement pas, c'est visible, les Etats Unis. Si la France tentait de jouer seule à ce jeu, elle se trouverait rapidement mise en faillite par le système et placée sous surveillance par les marchés aussi bien que par le Collège des grandes nations capitalistes. Résister à ces pressions négatives, imposer une autre régulation, et infléchir le système avant qu'il ne nous mène dans le mur est la grande affaire, la notre, des vingt ou trente ans qui viennent. Pour tenir ces enjeux chacun devine, tant elles sont évidentes, les quatre conditions majeures : 1. la masse, expression de la puissance. Seule l'Europe l'a. 2. l'organisation : il faut que cette masse soit commandée et puisse mettre en oeuvre une politique. Bonne ou mauvaise cela s'appelle une Constitution. On vient de perdre dix ans. Mais ce combat titanesque est à l'échelle séculaire... Or si certains dirigeants politiques ne sont pas pressés, les chômeurs et les précaires le sont. 3. la cohésion et la précision doctrinale et théorique. 4. la volonté politique, ce qui suppose une victoire politique sociale démocrate dans toute l'Union Européenne. C'est manifestement la troisième condition qui a le plus fait défaut jusqu'ici, au point
que les deux premières figurent à peine dans notre culture collective - malgré Jaurès Briand
Blum et Mitterrand - et que certains dirigeants du Parti ont pu récemment ignorer notre
immersion dans cette masse, nécessaire quoi qu'il arrive, et rejeter une petite avancée
constitutionnelle arrachée à la droite, au nom d'un pointillisme juridique que l'on avait jamais
vu dans l'histoire bientôt biséculaire des combats du socialisme. L'erreur grave ici est la
double sous estimation de la fragilité de l'Europe et de la puissance des forces de
désagrégation. Il y a là un noeud de raisonnement stratégique qui est au coeur des doutes et
des désaccords du Parti : encore un qu'il faut bien explorer. La construction européenne n'est à peu près pour rien dans le changement de nature du capitalisme qui nous affecte si gravement depuis une vingtaine d'années bientôt. L'affaire est mondiale, il faut la rappeler pour y voir clair. Le capitalisme, en tant que mélange d'économie de marché et de propriété des moyens de production et d'échange est efficace - nos revenus par tête ont été multipliés par plus de cent en deux siècles -, puissant - il s'est relevé de nombreuses guerres et crises, il a gagné au XXème siècle contre le fascisme et le communisme et même temporairement contre nous sociaux démocrates - cruel - la saga des crises, des grèves, des souffrances et des répressions meurtrières est immense, et enfin terriblement instable. L'histoire a parlé : dans l'état actuel des choses nos sociétés ont accepté la cruauté pour bénéficier de l'efficacité. Restait l'instabilité : elle a failli emporter tout le système mondial entre 1929 et 1932. Le combat social démocrate, des luttes ouvrières et l'intelligence humaine ont inventé des correcteurs à cette instabilité, trois en l'espèce. Par chance, ce qui n'est pas le cas pour ces immenses inventions humaines que sont l'agriculture, l'écriture ou la monnaie, ces trois correcteurs portent des noms d'inventeur. Le premier est la sécurité sociale. Beveridge expliquait qu'en créant les retraites, l'assurance maladie, l'assurance chômage ou les allocations familiales, non seulement on humanisait le système mais on le stabilisait largement puisqu'un tiers des revenus allait échapper aux variations et aux crises. Le second porte le nom de Keynes. Il consiste à dire que les Etats, commerçant sur un marché mondial unique mais émettant chacun leur monnaie, feraient mieux d'utiliser celle ci et leur pouvoir budgétaire comme pompe aspirante et foulante pour corriger les oscillations du système, plutôt que de respecter des équilibres financiers, artificiels pour quiconque crée sa monnaie. Le troisième est tout bonnement la politique des hauts salaires. Le capitalisme est un système génial de production de masse, qui évidemment ne fonctionne que s'il y a consommation de masse en quantité comme en qualité. L'inventeur était Henry Ford le constructeur automobile quand il a dit au début des années Trente, pour sortir de la grande crise : " je paie mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures ". Ces trois correcteurs sont puissants. Inventés trop tard ils n'ont pas réussi à éviter la 2ème guerre mondiale. Mais ils ont joué à plein juste après. Cela nous a valu, de 1945 à 1972-73, ce que Jean Fourastié a appelé les " Trente Glorieuses ", près de trente années de croissance à peu près régulière, sans crise financière systémique, en situation de plein emploi continu, et avec même dans quelques pays dont le notre l'amorce d'une légère tendance à la réduction des inégalités. Il ne nous restait plus qu'à contester la " société de consommation ", ce que nous faisions d'ailleurs allègrement. Inouï. La sociale démocratie tempérait et maîtrisait le capitalisme, pour le plus grand bien de l'humanité développée. C'était l'époque où Michel Albert baptisait capitalisme rhénan ce capitalisme principalement européen à forte composante sociale. C'est dans cette période et dans ce cadre international de pensée et d'action que commence la construction européenne. Ses objectifs sont d'abord politiques - rendre la guerre impossible entre nous - mais la volonté de précaution de ne pas heurter les souverainetés politiques (qui avaient tué les efforts de Briand et Stresemann vers les Etats Unis d'Europe dans les années 1920 et par là permis la guerre) a conduit les pères de l'Europe à proposer le détour par la mise en commun des économies. La Communauté Economique Européenne qui naît là, en 1959 exactement, est déjà définie comme marchande et libre échangiste : l'exigence de la concurrence libre et non faussée est écrite à ce moment. Mais elle est keynésienne d'inspiration, et sous large influence sociale démocrate. Collectivement nous sommes parmi les pères fondateurs : Savary fut rapporteur de ce Traité, qui fut négocié par un gouvernement socialiste conduit par Guy Mollet et qui comprenait Christian Pineau le négociateur et François Mitterrand. Tout baignait dans l'huile pour l'ensemble des pays développés - à la guerre froide près bien sûr - et normalement dans la décennie 70 l'humanité n'aurait du se poser qu'un seul problème, celui de savoir comment faire bénéficier l'Afrique l'Asie et l'Amérique Latine d'un système aussi remarquable. Et c'est à ce moment, fin des années 60 début 70, que se produit le drame. Une décision et une idée. Toutes deux américaines, et pas européennes. Non pas en provenance de ce grand peuple démocratique qui avait inventé le New Deal, sauvé l'Europe de la barbarie nazie et s'attachait à corriger ses inégalités, mais d'un clan, toujours le même, les Républicains de droite, Président Nixon, intellectuel chef de file Milton Friedmann, Prix Nobel d'économie, hélas. La décision, c'est le décrochage du dollar et de l'or, décidé par Nixon en novembre 1971. Il s'agit de manque de courage politique pour attaquer la résorption d'un déficit extérieur gigantesque, déjà, et sans doute aussi de la volonté d'échapper à un système trop bien coordonné et trop contraignant pour les Etats-Unis. Depuis rien ne va plus. Il n'y a guère de règle monétaire internationale, les parités sont dangereusement volatiles - on a vu le dollar évoluer entre 0.6 et 1.6 Euro - et les crises financières systémiques sont de nouveau possibles : on l'a vu en Europe en 1992 et en Asie en 1997. L'idée c'est en gros celle du capitalisme actionnarial. Les idées tuent, on le sait depuis longtemps mais au niveau de dangerosité de celle là il y en a peu dans l'histoire depuis le travestissement étatique de l'oeuvre de Marx. L'école de Chicago produit dans la décennie 60 et convient sous l'impulsion de son créateur Milton Friedmann de se baptiser monétariste. D'autres les appelleront ultralibéralistes. On peut faire avec les deux appellations mais sûrement pas avec celle de libéraux car les vrais libéraux - les grands fondateurs des XVIIIème et XIXème siècles - savaient tous qu'il n'y a pas de liberté sans règles, même en économie. Que dit cette école, vers 1960 ? Que nous vivons une période inouïe - c'est vrai - que nous le devons à un système génial, le capitalisme - c'est encore vrai - que ce qui est génial dans le système c'est à la fois le moteur, le capitalisme, et le carburant, le profit. Aucune réflexion sur les inégalités, la cruauté sociale ni l'instabilité. Le raisonnement continue : tout cela a tellement de puissance que ça marcherait encore beaucoup mieux et avec des résultats beaucoup plus spectaculaires si vous tous braves gens en faisiez aussi, du profit, et beaucoup. Qu'est ce qui vous en empêche ? Les impôts, les taxes, les charges sociales, les règlements limitateurs de croissance pour cause de droit social, d'écologie et de tout le reste. Débarrassons nous de tout cela. Question d'un élève à ce professeur : " M'sieur, M'sieur, j'ai des enfants, je veux qu'ils fassent de bonnes études, comment on paye les profs si je ne paie plus d'impôts ? " Réponse professorale : " Si l'accumulation de vos profits triplait vos revenus, vous accepteriez de payer l'école et elle marcherait mieux ! " Dans cet esprit de multiples gros livres pleins de formules mathématiques prétendent démontrer que l'équilibre spontané du marché, de chaque marché sectoriel, est " optimal " et que par conséquent toute intervention publique visant à en corriger le contenu social aura plus d'inconvénients que d'avantages, plus de victimes que de bénéficiaires et sera donc contre performante. Cette doctrine contraire au bon sens et à l'observation la plus élémentaire a fait le tour du monde. Le petit peuple américain anglais ou japonais, dans la culture très financiarisée où il baigne plus que nous, y a vu un merveilleux moyen d'améliorer ses revenus, et surtout les forces économiques y ont vu un excellent moyen de limiter en grande partie la pression fiscale et les règlements de toutes natures qui les gênent. C'est ainsi que la plupart des forces politiques conservatrices dans le monde développé s'y sont ralliées. L'Europe institutionnelle n'y est pour rien. Il faut se souvenir d'ailleurs, impérativement, qu'il n'existe pas encore de forces politiques européennes. Les forces politiques conservatrices nationales sont devenues ultralibéralistes - à la relative exception près des gaullistes français - et ont oeuvré dans ce sens depuis trois décennies à leur niveau national comme au niveau européen, qui est en matière politique une gigantesque confrontation de forces à définition nationale, même si elles pensent de manière convergente. Les choix des Commissaires, qui sont faits par les états, illustrent ce que cela veut dire, et pour quiconque n'aurait pas compris, le projet de Directive Bolkestein sur les services décrit fort bien ce que cela signifie. Ce changement de doctrine est un changement de mode d'emploi du capitalisme. Il a rallié des forces qui ont su faire des majorités électorales aux Etats Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Grande Bretagne, aux Pays Bas, dans l'Espagne d'Aznar, l'Italie de Berlusconi, la France de Chirac 1986 version Madelin, la Suède, la plupart des démocraties rescapées de l'URSS - et bien entendu le FMI et la Banque Mondiale. Le résultat est écrasant. On est entrain de démolir les trois correcteurs qui ont humanisé le capitalisme pour les trente années de l'après guerre. La pauvreté de masse a réapparu en pays développé, les inégalités augmentent vertigineusement aussi bien entre pays du Nord et pays du Sud qu'à l'intérieur des pays développés. Le travail se précarise partout, le chômage devient incompressible ou alors il est remplacé par des " petits boulots " payés en dessous du seuil de pauvreté. La solidarité budgétaire internationale diminue. Partout les services publics et la protection sociale sont attaqués, érodés, affaiblis parce qu'ils sont autant d'entraves à la possibilité de soumettre à la loi du profit l'essentiel des activités humaines. La culture a le plus grand mal à résister, pourtant défendue par le respect de la diversité culturelle, principe largement admis sur la scène internationale hors USA, à la différence de la défense des services publics ou de la sécurité sociale. Enfin et surtout, le système retrouve son instabilité originelle. Il faut compléter le tableau en ajoutant que quelques pays émergents - les dragons asiatiques - se sont ralliés à cette vision, et que la Chine et l'Inde ont commencé sur des bases analogues un développement vertigineux dans une cruauté sociale insoutenable. Pour le reste du Tiers Monde ou du Sud, c'est la marginalisation aggravée. Pauvreté, famines, guerres locales s'y multiplient, même si en statistiques globales, grâce à la Chine et à l'Inde, la pauvreté régresse. C'est dans ce décor de ruines du capitalisme humanisé par la Social Démocratie que nous devons agir maintenant. Le combat est mondial, l'Europe n'est qu'un moyen mais peut être le principal. Que nous reste t il ? A l'échelle historique les chances sont immenses. Il nous reste la plus grande organisation politique mondiale, l'Internationale Socialiste et son instrument européen concentré, le PSE. Ils sont petits par rapport aux enjeux mais ce sont les seuls. Etrange pensée que celle de ceux qui veulent s'en séparer. Pour aller où, avec qui ? Il nous reste le projet de société. Son embryon s'appelle le modèle européen : démocratie représentative, économie de marché plus services publics puissants plus sécurité sociale développée. Le projet socialiste en sera le développement plus accompli. Le monde entier nous l'envie, c'est aussi vrai en Afrique qu'en Palestine ou en Amérique Latine. La puissance de rayonnement mondial de ce modèle est énorme, elle sera un appui. Le fait que ses caractéristiques dominantes soient attaquées par le capitalisme actionnarial ne fait que souligner l'importance des enjeux. Il nous reste, c'est essentiel, le front de la pensée. Tous les fondateurs du socialisme étaient des penseurs. Camarades, pour le 74ème Congrès, il faut travailler lire et penser. Le Jury du Prix Nobel d'économie, quinze années de suite, nous a honoré de monétaristes. Voilà dix ans qu'il a cessé. Entre Amartyra Sen, le considérable économiste alternatif de la pauvreté, ou Joseph Stiglitz, maître d'oeuvre du système qui, quand il a compris , a démissionné décrit et dénoncé, ou même le malheureux Tobin, coupable d'avoir demandé de la régulation, le Jury du Nobel ouvre la voie de la suite. Tout ce qui pense aujourd'hui ne peut que rejeter un système injuste fou et dangereux. Cette force intellectuelle immense va jouer un rôle croissant. Il nous reste surtout l'Europe, à la condition essentielle de ne pas se tromper sur ce qu'elle est et ce qu'elle peut. Comment lui en vouloir d'être dominée par les forces nationales conservatrices qui nous dominent chez nous ? Le capitalisme n'a pas besoin de règles, et moins encore de puissance publique. Le fait de lui avoir arraché dans l'euphorie des Trente Glorieuses une puissance publique à l'échelle immense de ce continent est déjà une manière de miracle. L'Europe est interdite de politique étrangère, sauf aux marges, parce qu'une majorité de gouvernements des Etats Membres ne veulent pas de conflit avec les Etats Unis. C'est dommage, c'est grave, il faudra des décennies pour surmonter cela. Est ce une raison pour abandonner le reste ? L'Europe actuelle est principalement un outil à fabriquer des règles pour la bonne marche de l'économie capitaliste. Déjà les USA n'ont plus l'équivalent. L'Europe refuse les monopoles. C'est pourquoi il y a une quinzaine d'années Boeing et Douglas n'ont pas pu fusionner. Ils auraient fait par là une entreprise unique contrôlant à près de 80 % de la construction aéronautique et spatiale du monde. Cela aurait à l'époque tué Airbus. 7 ou 8 ans après ce sont Honeywell et Général Electric, menaçant de faire l'entreprise mondiale unique contrôlant 60 % du marché de l'informatique, qui voulaient fusionner et ne le purent à cause de l'Europe. Galiléo, projet européen, est le premier accroc dans la domination stratégique absolue des Etats Unis dans ce domaine, de l'utilisation de l'espace. Il n' y a que l'Europe pour obtenir devant l'OMC la condamnation et la fin du procédé fiscal américain de subventionnement des exportations par la détaxation des Sociétés off shore, et c'est là un peu de justice dans le commerce mondial. Il n'y a que le Parlement Européen pour faire obstacle à la volonté de Microsoft d'étendre la brevetabilité des logiciels c'est à dire du savoir mathématique pour en faire de profitables monopoles et il faut bien ajouter l'Airbus A380 et ITER. C'est peu ? C'est déjà énorme. L'Europe en fait, déjà, nous protège de monopoles mondiaux, américains japonais ou même européens, qui chacun dans son secteur commanderaient le monde de manière absolue. Et l'Euro de son côté nous protège déjà des soubresauts financiers du monde. Nous n'avons rien subi de la crise asiatique en 97 - l'Euro n'était pourtant qu'en préparation à cette époque - ni de la crise russe postérieure. C'est déjà une forte base de départ. Mais de plus l'Europe est en partie démocratique. J'ai la conviction que dans les dix ans qui viennent la pression de nos électeurs imposera la consolidation des services publics et de la sécurité sociale. Pour le reste de l'Europe sociale la consolidation constitutionnelle de la charte des droits aurait été nécessaire. Nous paierons le refus français. Il suffit de tout cela pour rendre l'Europe insupportable aux capitalistes qui n'en ont pas besoin. Les forces qui jouent déjà la désintégration, le détricotage, sont puissantes. Leur première victoire à propos de la Constitution va les encourager. L'Europe est de trop dans leur schéma. Leur donner une première chance a été une erreur tragique. Je demeure persuadé que les marges de liberté de la France seule sont faibles au point de ne guère lui permettre de changer notablement les conditions sociales présentes chez elle, ce qui n'empêche pas de devoir y défendre classes moyennes et classes populaires et y limiter les dégâts sociaux du système. Mais il y faut gagner les élections en présentant la cohérence globale du projet et en confirmant cette cohérence par les alliances recherchées : c'est aux niveaux européen et mondial que les batailles essentielles pour notre niveau de vie et nos emplois se livrent et se gagnent. Je ne vois en effet aucune autre stratégie que celle ci : un projet socialiste convaincant, proposé au niveau de l'Europe entière, une victoire sociale démocrate en Europe appuyée sur une stratégie claire concernant la mise en cause du capitalisme actionnarial et la meilleure régulation du système, et l'usage de l'énorme force de l'Europe pour contribuer à réorienter tout le système mondial, en appliquant chez nous puis en exportant notre projet de société. Le problème essentiel de toute stratégie, c'est la cohérence qui l'anime. L'objet du 74ème Congrès, c'est de déterminer notre stratégie et notre cohérence. J'ai voulu participer à ce débat en soumettant les miennes à votre réflexion. |
 |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
| ||