Loi Fillon : les brutaux et les " mollettistes "
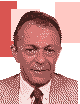
Michel Rocard, ancien premier ministre, est président de la commission de la culture au Parlement européen.
Point de vue paru dans les pages " Horizons " du quotidien Le Monde daté du 19 juin 2003
Loi Fillon : les brutaux et les " mollettistes " |
|
Michel Rocard, ancien premier ministre, est président de la commission de la culture au Parlement européen. Point de vue paru dans les pages " Horizons " du quotidien Le Monde daté du 19 juin 2003 | |
Il n'y a pas d'évidence que le problème des retraites se soit clarifié ou simplifié aux yeux des Français depuis quelques semaines. Il est donc utile d'y revenir. D'autant plus que, pour ce qui me concerne, le fait d'avoir rendu public un désaccord avec le Parti socialiste a complètement occulté le constat central sur lequel il faut bien insister : c'est d'abord la maladresse gouvernementale qui a créé la situation de blocage et de crise sociale que nous vivons, au détriment de millions d'usagers. On n'échappe pas au rappel de quelques évidences incontournables. Nous vivons tous de plus en plus longtemps. Notre espérance de vie gagne en moyenne presque deux mois chaque année. Si tout ce temps gagné est passé exclusivement en retraite, chacun comprend que cela va coûter plus cher. Toujours en moyenne, nous commençons à travailler de plus en plus tard : l'âge moyen de fin d'études était de 15 ans pour les générations nées avant 1930, de 17,5 ans pour celles de 1950 et de 21 ans pour celles de 1980. Si l'âge de départ en retraite reste fixe, on cotise donc de moins en moins longtemps alors que le temps de retraite, lui, s'allonge. Pour couronner le tout, nous ne faisons plus assez d'enfants pour renouveler nos générations. Le nombre de retraités pour 100 actifs n'est évidemment pas la seule variable, mais c'est une des plus déterminantes. Or il est en augmentation lente et régulière. Tout cela se passe dans un univers de croissance économique à peu près continue. C'est un gain régulier de productivité qui est à la source de cette croissance et qui la rend possible en parallèle avec une réduction elle aussi continue du temps de travail dans la vie (allongement de la durée des études, abaissement de l'âge de cessation d'activité, augmentation des durées de congés, diminution de la durée hebdomadaire). On travaillait en moyenne 70 % de sa vie éveillée en 1850, 43 % en 1900, 18 % en 1980 et on ne doit guère être loin de 16 % aujourd'hui. Tout cela fut compatible avec la multiplication par 8 du pouvoir d'achat des salariés en un siècle. Cette croissance, au total considérable, a rendu tolérable le poids lui-même croissant des pensions dû à l'allongement du temps de retraite et à l'augmentation du nombre des retraités par actif car ces tendances sont à l'œuvre depuis bien des décennies : 5 % du PIB en 1960, 12 % en 2000 et, selon le Conseil d'orientation des retraites créé par Lionel Jospin, 18 % en 2040. Jusqu'ici, à quelques comblements de déficits près, et sauf pour les fonctionnaires, ce sont les cotisations qui ont financé le système. Cela va dans l'avenir coûter beaucoup plus cher, tout le monde le sait et personne n'y peut rien. Il n'y a pas désaccord là-dessus. Il n'y en a pas non plus, heureusement et c'est essentiel, sur le choix de préserver le système par répartition. Le gouvernement s'est vite rendu à l'idée que d'éventuels fonds de pension (c'est-à-dire la transformation profonde et l'extension de l'assurance-vie, déjà très répandue en France) ne pourraient fournir que des compléments. Cette première victoire politique considérable laissait espérer une issue négociée de toute la réforme. Le premier désaccord, et au fond le plus grave, vient tout de suite après. Faut-il affecter au financement de nos retraites d'autres ressources que nos cotisations ? Nous vivrions en économie fermée, que je n'hésiterais pas à répondre oui. Cela ralentirait légèrement la croissance mais, pour des raisons écologiques, on a justement besoin qu'elle se modère sérieusement, au moins dans tous les pays développés. Mais le drame qu'ont du mal à admettre certains de mes camarades de gauche, c'est que le capitalisme a gagné. Nous sommes en économie mondialement ouverte, il n'y a ni régulation, ni limite à la violence de la concurrence. Nous ne construisons pas la société de nos rêves : croissance lente et socialement harmonieuse, temps libre voué aux relations interpersonnelles, au sport et à la création culturelle plutôt qu'à la consommation marchande. Nous nous défendons. A ce titre, nos retraites nous sont essentielles comme le sont d'autres besoins publics : éducation, sécurité, santé, accès aux biens de culture... Mais surtout, nous ne pouvons le faire, par des politiques nationales, que sous la condition absolue de ne pas affaiblir notre appareil productif national dans la compétition mondiale sauvage que nous connaissons aujourd'hui. C'est malheureusement une condition subie et non choisie. La violer se paierait à terme sous forme de délocalisations et de chômage. En plus, je suis convaincu que tout le monde le sait, et que le débat à gauche porte sur le refus ou l'acceptation de cette évidence. L'outil principal disponible ici est la CSG. C'est moi qui l'ai créée, je peux donc rappeler pourquoi. L'accroissement vertigineux des inégalités que provoque le système qui nous a vaincus, appelons-le pour faire bref le capitalisme d'actionnaires, appelait et appelle toujours des corrections et des limitations. Pour le financement de la Sécurité sociale, les revenus non salariaux, et notamment ceux du capital, devaient être amenés à contribuer. Mais je sais ce que j'ai fait : proportionnelle au premier franc, la CSG est un impôt redoutable, et elle pèse aussi sur les salariés. Trop lourde, elle deviendrait intolérable. Les impôts sur le capital ne sauraient répondre à l'ampleur du problème, il s'en faut de beaucoup, et ce sont les plus énergiques incitateurs à la délocalisation et donc au chômage. Il est une deuxième raison, aussi forte s'il se peut : chacun souhaite naturellement que le système soit aussi souple que possible et permette de partir en retraite quand on le souhaite, bien avant ou bien après l'âge de 60 ans, ou même en plusieurs étapes. Cette personnalisation souhaitable de la retraite n'est possible que si le lien entre la cotisation et la retraite de chacun couvre tout le problème, c'est-à-dire si le système repose sur les cotisations exclusivement. De toute façon, le nécessaire redressement de la part des salaires dans le PIB doit se faire sur le salaire direct et non pas grâce à la protection sociale, et découler de négociations plutôt que de l'impôt. Dans ces conditions, il n'y a bien que 3 paramètres principaux sur lesquels jouer : le taux des cotisations, celui des pensions, et la durée de cotisation. Le maniement de chacune de ces variables a un coût social important, absolument indéniable. C'est pourquoi leur pondération doit être recherchée dans des conditions qui lui assurent la plus grande légitimité possible. Seule la négociation peut assurer cela, établissant la réforme par un accord dûment signé des partenaires sociaux et ensuite seulement entériné par la loi. Cette négociation aurait dû être d'autant plus longue et délicate qu'elle comportait un vaste préalable : introduire plus d'équité dans le système. Cela devait viser l'équilibre secteur public-secteur privé, les tarifs de bonification-pénalisation pour départ anticipé ou retardé, les modalités d'indexation, le traitement des primes, l'éventuelle variabilité de l'âge de départ en fonction de la pénibilité des métiers, etc. Tout cela étant douloureux, exigeait du temps, celui de l'accord sur les données puis celui de la prise de conscience et enfin celui de l'équilibrage des efforts. C'est là que le gouvernement a accumulé les erreurs : il n'a jamais établi si ses conversations avec les syndicats étaient de l'ordre de la consultation ou de la négociation. Le premier ministre a beaucoup trop parlé du problème, dessaisissant ainsi le ministre en charge, ce qui donnait un caractère fort incertain aux auditions de ce dernier. Enfin, s'agissant de la plus difficile des réformes à faire par un gouvernement qui avait à l'origine encore trois ans et demi de calme avant les prochaines élections, il était ridicule et dangereux de se donner un délai de quelques mois seulement. Cela obligeait à devoir passer en force sur tous les symboles. Ainsi s'est créée la situation de blocage que le gouvernement essaie de réduire par le vote parlementaire, ce qui, que cela " passe " ou non, se paiera par une profonde détérioration du climat social qui pèsera sur toutes les négociations à venir, à commencer par l'assurance-maladie. Ce qui m'a paru critiquable dans l'attitude de la majorité syndicale soutenue par le PS, ce sont deux éléments conjoints qui résultent de la même position. Tactiquement, demander le retrait du projet pour en exiger un autre revenait à accepter le principe d'un projet de loi plutôt que d'un accord négocié. Dans toute négociation, le texte du partenaire n'a pas à être accepté ou rejeté, il doit être amendé jusqu'à devenir acceptable. C'était au contraire l'occasion ou jamais de maintenir le préalable absolu d'une négociation, surtout une fois les fonds de pension écartés. Et, sur le plan des symboles, cette attitude laisse croire aux salariés qu'une solution complètement différente et beaucoup plus avantageuse est possible. Or c'est faux, et cela constitue donc une faute grave. Car, à supposer que nous arrivions à bloquer le processus et que, revenue au pouvoir, la gauche doive assumer cette réforme devenue plus pénible à cause du temps passé, nous proposerions certainement à la négociation un cocktail un peu différent des grands paramètres. Un peu, mais certainement pas beaucoup. Nous serons alors accusés d'avoir trompé les travailleurs. Dans ma jeunesse, nous appelions " mollettisme " cette attitude de double langage qui promettait trop et décevait du même fait. C'est ainsi qu'à l'époque s'est érodée la confiance des électeurs dans l'action des socialistes. Il vaudrait mieux éviter de recommencer. |
 |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
| ||