La France
et son nombril
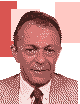
Point de vue signé par Michel Rocard, président de la commission de la culture au parlement européen, ancien premier ministre, paru dans le quotidien Le Monde daté du jeudi 14 février 2002
La France |
|
Point de vue signé par Michel Rocard, président de la commission de la culture au parlement européen, ancien premier ministre, paru dans le quotidien Le Monde daté du jeudi 14 février 2002 | |
Je veux dire mon effarement devant les débats préparatoires à la campagne présidentielle que l'on entend aujourd'hui. Tout se passe presque comme si le monde extérieur n'existait pas. Nous parlons
chômage et licenciements comme si les grandes restructurations n'étaient pas le fruit d'une frénésie mondiale d'intensification de la concurrence et de boulimie des opérateurs financiers. Nous parlons fiscalité comme si nous n'étions pas soumis à une énorme pression baissière et homogénéisante, qui nous vient du monde entier, puissamment relayée par l'Union européenne. Préserver dans cette atmosphère notre niveau de redistribution, notre protection sociale et l'ampleur de nos services publics exige, au contraire, une stratégie explicitement internationale, d'abord européenne et vigoureusement offensive. Nous parlons violence urbaine, ce qui est un peu plus local en effet, en faisant semblant d'ignorer qu'elle sévit partout dans le monde et qu'elle y a partout des fondements analogues, et en oubliant qu'une de ses dimensions majeures aujourd'hui est sa relation fortement croissante avec la drogue, qui elle-même fait l'objet de trafics mondiaux en augmentation rapide et inquiétante. Sur ce même sujet, il y a plus à dire : l'accord se fait parmi les observateurs pour estimer que la perte, ou l'absence d'identité, constitue l'un des facteurs les plus incitatifs à la violence. C'est de sens que les jeunes d'aujourd'hui ont besoin, de projet de société. Or, à la différence des plus anciens, ils sont mondialisés, par la musique, le vêtement, le goût des voyages, le refus de tout racisme et pour beaucoup d'entre eux par Internet. Une part notable de ceux qui ont des problèmes sont d'origine africaine : où leur parle-t-on de l'Afrique, de leurs racines ? Ils sont tous hors d'état de faire leur un projet de société borné aux limites de l'Hexagone. Nous parlons aussi santé, mais sans citer le sida ou le paludisme. Or, faute d'efforts internationaux suffisants, ces deux pandémies sont en pleine expansion. Combien de temps croit-on que nos frontières seront étanches ? Nous parlons surtout autorité de l'Etat, comme si le problème essentiel n'était pas justement le fait que les leviers majeurs de la transformation sociale échappent de plus en plus à l'Etat. Sur tous ces sujets, plus quelques autres, les mesures et stratégies dont on débat sont purement défensives, et d'horizon national. C'est la ligne Maginot généralisée. La France contemple son nombril. Pourtant, il faut s'y faire. La technique et la finance ont unifié le monde, un monde dans lequel, contrairement à ce que l'on a pu penser entre 1929 et 1932 ou aux lendemains de la seconde guerre mondiale, le capitalisme a gagné. Eussions-nous réussi à mettre en place à la fin des années 1970, ou au début des années 1980, une Europe efficace, décidant vite, parlant d'une seule voix, et maniant aussi bien l'économie ou la finance que la diplomatie ou les armées, que cette Europe aurait sans doute pu peser en tant que telle sur les affaires du monde, et contribuer à limiter la violence mondiale et l'aggravation vertigineuse des inégalités. Mais nous n'en sommes plus là, ce fut une affaire ratée. Les égoïsmes nationaux y ont pourvu. De ce fait, nous sommes maintenant dans une phase dangereusement inquiétante de l'histoire du monde. Nous avons vécu après la seconde guerre mondiale trente-cinq à quarante ans sans conflit majeur dans une croissance à peu près régulière dont les fruits, bien que très inégalitairement partagés, bénéficiaient à presque tout le monde dans les pays développés. Après les secousses menaçantes de l'entre-deux-guerres, et la guerre qu'elles avaient largement provoquée, trois grandes régulations, chacune portant la signature d'un homme, avaient contribué à la stabilisation générale du système. C'est d'abord Henry Ford, déclarant : " Je paie mes salariés pour qu'ils m'achètent mes voitures ", et illustrant par là la dynamisation de la demande par une politique de fort pouvoir d'achat. C'est ensuite John Maynard Keynes décrivant le maniement possible des finances publiques pour assurer la régularité de l'évolution du système, en économie contrôlée aux frontières. Et c'est enfin Beveridge théorisant la protection sociale non seulement comme un devoir de solidarité mais comme un filet de sécurité protégeant le système contre une baisse excessive de pouvoir d'achat en cas de crise grave. Cela marcha longtemps fort bien. Le problème des décennies 1960 et 1970 aurait dû être d'élargir le bénéfice de ce développement régularisé aux pays pauvres d'alors qui en étaient exclus. Au lieu de quoi, on a fait l'inverse. Milton Friedman et son école monétariste, qui ont remporté un succès mondial de propagande, se sont efficacement attaqués à ces trois régulations, obtenant pour ce faire l'accord de la majorité des gouvernements. Ils ouvrent ce débat au moment où l'essentiel des habitants des pays développés ont atteint pour la première fois dans l'histoire un pouvoir d'achat leur permettant de s'occuper de leurs loisirs et de leur santé, et pas seulement de se nourrir et de se loger. Anthropologiquement, la lutte contre les impôts, les règlements et l'excès d'importance de l'Etat correspond à l'exigence d'épanouissement individuel, d'où son triomphe. Mais la définition en est limitée à l'avoir, au quantitatif, à la consommation. En tout cas, le résultat est acquis. Les grandes régulations stabilisantes ont disparu. La pauvreté de masse a réapparu dans les pays développés, les inégalités se creusent à une vitesse qui s'accélère : le rapport des revenus moyens par habitant était de 1 à 5 ou 6 en 1900, de 1 à 30 vers 1970. Il est maintenant de 1 à 75. Cette situation est dangereusement explosive, et l'écho rencontré par Ben Laden dans le tiers-monde y trouve largement sa source. Pis encore, le système mondial est financièrement gravement déstabilisé. Nous avons connu entre 1990 et 2001 cinq grandes crises financières dans le monde. Elles furent endiguées, à plus ou moins grand coût. Le seront-elles toujours ? Déjà, les Etats-Unis font pression pour réduire les pouvoirs du FMI. Tout cela n'est pas sans rapport avec la violence collective. Si les guerres internationales classiques sont en voie de disparition, une quarantaine de guerres plus ou moins civiles sont en cours, toutes liées à la pauvreté et à l'âpreté des revendications de territoires ou de ressources naturelles qu'elle provoque. Nous sommes dans ce monde-là. Il s'agit peut-être de la première campagne électorale présidentielle qui se déroulera dans une situation et une atmosphère où tout le monde sait que notre sécurité, nos emplois, la préservation de nos services publics dépendent d'abord d'éléments extérieurs à nos frontières. C'est dans ce contexte que doit être traité le problème fameux et récurrent du "projet de société". Contrairement à ce que beaucoup imaginent, il n'y a guère de mystère sur les pistes à explorer pour donner à nos enfants et petits-enfants, en France, en Europe et dans le monde, une société plus humaine et plus généreuse que celle d'aujourd'hui. Elles sont principalement trois : la première consiste à consolider alors qu'il est menacé, à améliorer et à diffuser le modèle aujourd'hui européen d'équilibre entre le bien-être marchand que chacun acquiert par son travail, la protection sociale qui cherche à ne laisser personne sur le bord de la route et le développement des services publics qui assurent à tous l'accès à l'école, à la santé, à l'eau potable, à l'électricité et au système de transports. La deuxième consiste à redonner son sens et son ampleur à la notion de solidarité. C'est son affaiblissement qui permet l'irrépressible montée de la grande pauvreté, l'aggravation effrayante des inégalités et l'approfondissement constant du fossé Nord-Sud. Le réveil de la solidarité est déjà nécessaire en France, mais c'est à l'évidence sur le plan mondial qu'elle prend tout son sens et qu'au demeurant, la jeunesse d'aujourd'hui l'exige. La troisième piste est au moins aussi évidente. Elle consiste à tenter de limiter et de réduire, par tous moyens et en tous lieux, la place excessive de l'argent comme référence exclusive dans l'organisation de la société. Que les biens et services de culture, comme l'éducation et la santé, soient protégés des règles usuelles du marché. Que le sport soit préservé des pressions capitalistes par des règles négociées et transparentes, et qui bien sûr ne peuvent être que mondiales. Que les facteurs constitutifs de nos identités nationales, et d'abord nos langues, soient préservés. Que soient soutenues et défendues les activités économiques qui n'ont pas pour but l'enrichissement personnel : coopératives, mutuelles, associations, entreprises "intermédiaires" de réinsertion sociale, réseaux d'échanges de savoirs, réseaux de commerce équitable ; en bref, toute l'économie sociale et solidaire. Toutes ces structures existent, leur développement passe par une reconnaissance et un statut européens, puis par leur pleine intégration dans les règles du commerce mondial telles qu'elles s'élaborent à l'OMC. Faire progresser l'humanité dans ces directions exige une meilleure gouvernance mondiale en matière de paix ou de guerre, de lutte pour le développement, de réduction des inégalités, d'environnement et de progrès social. Ce qui est nouveau est que maintenant notre vie quotidienne elle-même en dépend. On ne tarira l'immigration excessive qu'en redonnant à tous les peuples un espoir d'avenir chez eux. La France est ici devant un choix majeur. La grandeur et la violence de son histoire l'ont conduite à penser en termes universels plus que d'autres ne l'ont fait. Ses valeurs républicaines affirment un équilibre entre liberté et égalité mieux fondé qu'il ne l'est en culture anglo-saxonne. La solidarité, traduction pragmatique de la fraternité, y est mieux enracinée. Mais c'est surtout la laïcité qui est le concept majeur d'organisation sociale dont le monde a besoin pour mieux cohabiter. Allons-nous, pour protéger ces valeurs, nous isoler de l'Europe et du monde, souligner nos différences, raréfier les contacts et influences, que nous prenons pour des contaminations, et défendre mordicus des institutions et des procédures à la place des valeurs dont elles sont le produit ? Ou allons-nous nous immerger dans le mouvement de l'Europe et du monde, mouvement bien incertain et qui ne sait guère où il va, pour y proposer et faire triompher un corps de valeurs dans lequel nous croyons si fort parce que nous sentons que ce sont les meilleures ? Pour ce dernier choix, le seul qui vaille parce que le premier n'annonce que le déclin, notre particularisme institutionnel jacobin est un obstacle. L'assouplir pour le rendre compatible avec la compréhension et le mouvement des autres, d'abord en Europe, est difficile. Le but essentiel d'un programme électoral doit être de décrire ce chemin. Qu'il s'agisse de paix ou de guerre, de développement, de stabilité financière, de lutte contre les inégalités ou la criminalité, une meilleure régulation mondiale rencontre aujourd'hui un problème dominant, dont tous les autres dépendent : l'unilatéralisme résolu que les républicains américains imposent au reste du monde et même à 45 % de leur propre nation. Il n'y a pas de priorité politique plus forte et plus immédiate que de rechercher l'alliance de tous ceux qui, riches ou pauvres, aspirent à la démocratie dans un monde aux règles équitables, stables et respectées, pour faire contrepoids à cet hégémonisme dangereux. Le temps n'est pas à souligner les différences. Mais si ce combat est gagné, alors, et alors seulement, nous ne protégerons que mieux nos particularismes ! |
Reproduit avec l'aimable autorisation du quotidien ©  |
|
 |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
 | ||