Comment repartir
du bon pied gauche ?
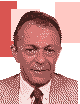
Comment repartir | 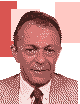 |
Ce n'est pas seulement le Parti socialiste, c'est bien toute la gauche qui est à reconstruire après le drame du 21 avril et le grave revers qui l'a logiquement suivi aux élections législatives. Je ne crois pas un instant que cette entreprise soit possible si l'on ne se pose pas toutes les questions, et d'abord celles qui font mal. Car le désastreux résultat que nous venons d'enregistrer n'est pas une surprise, mais le produit d'un long tassement, et il traduit une situation stratégiquement inquiétante : le relatif repli du PS conjugué à l'effondrement de ses partenaires laisse un étiage des voix de gauche de l'ordre de 35 %. C'est bien pire qu'en 1993. Avec une telle base de départ, il n'y a aucune victoire possible avant une bonne décennie, et au prix d'une reconstitution complète. Le reflux est mondial en pays développés et non propre à la France. Si l'on compare la France et l'Italie aux autres démocraties développées, on observe que ce qui résiste le mieux, ce sont les grandes forces qui portent leur nom : travaillistes, démocrates, socialistes, sociaux-démocrates. Ce qui s'effondre le plus, ce sont les coalitions dont la division est telle que leur seule appellation commune possible n'évoque ni programme, ni substance, ni tradition, mais simplement une relation à l'autre. " La gauche " se définit par rapport à " la droite ", pas en elle-même. Le mot est vide de toute référence autre qu'à la géographie des sièges parlementaires. " L'Olivier " italien, à défaut de consistance, était joli... Je suis socialiste, j'entends non seulement le rester, mais démontrer fermement que c'est par rapport à la densité de convictions que cela implique que les autres doivent se situer, et non pas moi par rapport à eux. Robert Hue, Noël Mamère, Christiane Taubira-Delannon, mes amis, à quoi diriez-vous qu'a servi votre récente prestation à l'élection présidentielle ? Avez-vous le sentiment d'avoir fait progresser une cause quelconque, et tout particulièrement celle de vos propres amis politiques ? Tout cela était du bon travail pour Chirac. Êtes-vous sérieusement convaincus, vous qui êtes des hommes et des femmes de pouvoir, qui entendez gouverner et savez ne pouvoir le faire qu'avec le PS, qu'il est indispensable à vos convictions de maintenir en vie des structures, des partis, dont la seule existence affaiblit le seul parti capable de vous amener au pouvoir ? D'accord, je sais, le PS est peu sympathique. J'aurais là-dessus de quoi enrichir largement votre information. Ce vieux paquebot fait eau de toutes parts et il est lent à manœuvrer. Il faut beaucoup de temps, de batailles et de crises pour lui faire adopter un cap sensiblement nouveau. Mais a-t-on le choix ? Et vos boutiques à vous, franchement, sont-elles tellement plus chaleureuses, démocratiques, adaptables, efficaces ? De quoi avez-vous peur ? De ne pas vous y faire entendre ? Vous savez bien que c'est faux : gagner les congrès y est difficile, s'y faire entendre pas du tout : il nous reste un peu de démocratie, largement autant que chez vous. En outre, je n'ai jamais vu que l'on puisse débattre, approfondir et faire avancer des idées dans un parti politique tout simplement parce qu'on ne peut pas mélanger la réflexion intellectuelle et les stratégies de pouvoir. Aussi longtemps que tel mot tabou - capitalisme, multinationales, laïcité, ouvriers - est accolé à l'image d'un leader qui l'affectionne et l'emploie souvent et dont la clientèle interne est stabilisée autour de x %, l'intelligence est interdite de séjour et les votes valident des stratégies de groupes. Là encore, ou on fait avec ou on renonce, ce qu'à mes yeux vous êtes en train de faire. La droite a alors un grand avenir devant elle. On discute plus librement et plus intelligemment hors structures. C'est le moment. Mettons-nous y tous, ce sera aussi le moyen d'associer aux débats tous ces intellectuels aux mains propres, nos amis, qui se lamentent fraternellement avec nous sur l'état de la gauche mais se gardent bien de se compromettre dans des structures collectives. Le PS et la gauche plurielle auraient perdu parce qu'ils n'étaient pas assez à gauche ? Je crois plutôt qu'on a perdu parce qu'on n'a rien compris à la société contemporaine et qu'on n'a même pas su expliquer à nos concitoyens ce qui se passe, où nous sommes, les causes de ce qui nous arrive, toutes choses préalables à l'idée d'agir pour corriger des situations pénibles ou dramatiques et les tendances dangereuses. Pas assez à gauche ? Après tout, peut-être. Mais d'abord, qu'est-ce que cela veut dire ? Dans notre dernier demi-siècle de paix civile, nous avons connu trois " marqueurs " de la plus ou moins grande proximité avec la gauche. Le premier - Jean-Paul Sartre nous l'avait assez répété - était la proximité avec le Parti communiste français. Du temps du regretté camarade Staline, cela avait un sens. Mais aujourd'hui, où est le projet communiste par rapport auquel se situer ? Ce marqueur a disparu, et il y a peu de gens pour le regretter. Le deuxième marqueur, plus persistant, est lui aussi fragilisé. C'est l'étatisme. Tout est politique. Le gouvernement est l'émanation du ou des partis qui le composent et c'est essentiellement par la loi qu'il change la société. L'économie obéit à la politique. Mais sur la longue période, deux évolutions se sont produites, qui ont brisé cette certitude : En outre, nous avons échoué à rajeunir, dynamiser et décentraliser l'État. Du coup, ses lourdeurs bureaucratiques sont devenues insupportables à tout le monde, classes moyennes et classes populaires comprises. Le deuxième " marqueur à gauche " a lui aussi perdu son sens. Reste le troisième : le syndrome de la demande. Souvenez-vous de l'" actualisation du programme commun ", pour éviter la cruauté de prendre des exemples plus récents : il fallait exiger une revalorisation du smic d'au moins 15 % pour être reconnu comme de gauche. A 5 %, vous étiez fâcheusement réactionnaire. N'importe quel dirigeant syndical sait fort bien qu'à ce jeu une bonne phase d'inflation a vite fait de liquider l'avantage arraché... le symbole demeure. Bref, le marqueur par l'ampleur de la revendication, que certains enjolivent du beau nom de radicalité, est lui aussi en panne de signification. Il ne suffit pas, bien entendu, des positions et des pratiques de la droite pour que le seul fait de s'y opposer définisse une politique. L'urgence est donc de se définir et de se reconstruire par rapport à ce que nous voulons et à ce que nous sommes. Le socialisme a derrière lui une longue et riche histoire. Dès ses premiers balbutiements, il se définit comme internationaliste, refuse dans l'État-nation alors en train de s'enraciner à la fois sa structuration sociale et l'incitation à la xénophobie qu'il recèle par nature. En ce début de millénaire où toutes nos raisons de craindre - et éventuellement d'espérer - ont un champ mondial, alors que la France doit la campagne présidentielle surréaliste qu'elle vient de vivre au fait que, tout entière, elle avait oublié le monde extérieur, ce rappel apparaît comme une des clés de la refondation. L'autre élément fondateur du socialisme est, s'il se peut, encore plus décisif. Ce sont bien sûr la souffrance et la misère ouvrières qui furent les raisons initiales de la colère anticapitaliste et du mouvement qu'elle fonda : mutuelles et coopératives d'abord, puis syndicats, puis partis. Mais jamais le mouvement socialiste n'a limité sa dénonciation ni son projet aux seuls aspects matériels et financiers de la condition salariale. Owen, Fourier, Godin, ont voulu construire des sociétés radicalement nouvelles, des communautés ; Proudhon dénonçait l'hypocrisie globale de la société tout entière, et d'abord en ce qui concernait la propriété. Marx a commencé sa démarche en travaillant sur l'aliénation. C'est à Kautsky, Guesde, Lénine et quelques autres que nous devons la trahison de l'œuvre de Marx et sa transformation en une vision totalement étatisée et exclusivement quantitative ou financière de la société à construire. Au contraire de cette vision, le noyau dur du socialisme a toujours été une conception exigeante de la dignité humaine et de la part de responsabilité et de pouvoir pour chacun qu'elle appelle. Smic, niveau des salaires, protection sociale et impôts en font partie bien sûr mais plus comme des résultantes que comme les éléments-clés du projet. Franchement, y a-t-il message plus actuel ? Le vrai danger, la menace dont aujourd'hui tout le monde a peur, c'est la mondialisation. Le monde a achevé son unification commerciale et financière, et les Etats-nations ont empêché que ce mouvement soit accompagné de la mise en place d'instruments de puissance publique capables d'édicter des normes et de contrôler la régulation du système. Les conséquences sont catastrophiques. L'humanité va dans le mur. La détérioration constante de notre niche écologique menace la vie sur la planète et l'humanité peine énormément à trouver des réponses. Le système économique capitaliste que l'on avait non sans mal un peu stabilisé entre 1945 et 1975 s'est remis à produire de la pauvreté de masse même dans les zones riches, à aggraver toutes les inégalités, et d'abord Nord-Sud. Ce monde économique et financier est en outre redevenu instable. Une crise financière grave tous les quatre ou cinq ans ; tous les pays émergents étranglés de dettes. Les prix des matières premières, les parités monétaires, les mouvements de capitaux sont volatils comme jamais. La puissance dominante, les États-Unis, vit à crédit dans des conditions dangereuses. L'économie criminelle, peu combattue - il n'y a guère de règles et de police mondiales -, frise les 10 % de la production mondiale annuelle et, de ce fait, le trafic mondial de drogue augmente rapidement, menaçant notre jeunesse. Le plus nouveau : c'est maintenant notre quotidienneté locale qui subit cette menace, et tout le monde le sait. Tous les travailleurs de France savent que les licenciements dont ils sont menacés dépendent d'un Monopoly mondial dans lequel la France seule ne peut rien, sinon faire des plans sociaux. Et la violence civile elle-même, qui maintenant met en cause notre sécurité physique, est liée pour une petite part à l'extension du trafic de la drogue, qui est mondial, et pour une bien plus grande part à cette destruction des identités, des repères, des traditions et des cultures qui est le résultat majeur du nivellement par le bas auquel nous soumet l'uniformisation télévisée des messages, des rythmes musicaux et des vêtements. Ajoutez-y la pauvreté, et le cocktail est prêt à exploser. J'ai l'absolue conviction que les électeurs, avant de voter pour des programmes de réponses à tout cela, se rapprocheront d'abord de ceux qui le leur expliqueront. Pour pouvoir prendre en main son destin, ce qui est le cœur de la démocratie, il faut commencer par comprendre ce qui le détermine et de quoi il est fait. Au jeu politique français personne ne comprend rien parce qu'aucune stratégie n'est raccrochée à une analyse crédible de ce qui nous arrive et des raisons de nos misères. C'est vrai dans la plupart des pays d'Europe, comme ce l'est des démocrates américains. L'exception, c'est Tony Blair, qui, lui, explique, rend compte... et gagne. Les axes des réponses à cette crise de société sont bien connus, multiples et diversifiés, mais ils se ramènent à trois : La nouveauté de la période n'est pas dans ce rappel des valeurs permanentes du socialisme, mais dans le champ géographique - mondial - qui s'impose pour les mettre en pratique. Tous les grands problèmes appellent en urgence des traités mondiaux à l'application vigoureusement contrôlée. Certains sont presque prêts. Ce doit être l'objet principal du militantisme d'aujourd'hui. L'institution européenne est à l'évidence le principal outil dans cette bataille : sa taille et sa puissance lui donnent une authentique faculté de protection de ses membres contre tous les dangers planétaires, et son influence mondiale a la force suffisante pour imposer des solutions mondiales. Que l'Europe soit libérale n'est pas une surprise : c'est le monde qui l'est. Ce n'est en rien une raison pour renoncer à la construction de l'instrument essentiel qu'elle peut représenter. Mais il y a trois conditions : achever la construction de l'outil, même libéral, formuler au niveau européen la doctrine du socialisme d'aujourd'hui, et puis gagner. Ce sera long Les fondateurs du socialisme pensaient à l'évidence en termes de siècles. Raccourcir l'horizon, c'est renoncer à l'ambition. Au point où nous en sommes, c'est maintenant la survie de l'humanité qui est en question. Dans un tel cadre, les politiques de proximité prendront tout leur sens. Il faut soulager des misères, il faut aussi faire rêver. |
Reproduit avec l'aimable autorisation du quotidien ©  |
 |
[Les documents] [Les élections] [Les dossiers] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
| ||