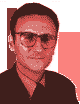Le grand bond en arrière |
| |
Point de vue d'André Vallini, député de l'Isère, secrétaire national du Parti socialiste chargé de la justice, des institutions et de la réforme de l'Etat, paru dans le quotidien Libération daté du 4 mai 2005 | ||
La justice traverse dans notre pays une crise de confiance sans précédent.70 % de nos concitoyens pensent qu'elle fonctionne mal, 53 % pensent que ça s'aggrave et c'est le plus haut magistrat de France, le premier président de la Cour de cassation lui-même, qui déclare dans le Figaro magazine : « Ça ne peut pas continuer comme ça. » Face à cette situation, que fait le garde des Sceaux ? Il crée des commissions, il demande des rapports. Sur la procédure civile, sur la procédure pénale, sur le suicide en prison, sur les délinquants sexuels... La politique pénale de M. Perben semble, en fait, surtout varier au gré des humeurs de l'opinion publique. Un jour c'est la psychose sécuritaire qui l'oriente vers le tout-répressif au mépris de la présomption d'innocence, le lendemain c'est l'affaire d'Outreau qui lui fait redécouvrir l'importance de cette présomption d'innocence. Un jour il fait voter des lois dangereuses qui remettent en cause les droits de la défense, le lendemain il cherche tous les moyens de calmer la colère des avocats. Un jour il fait voter des lois répressives qui remplissent des prisons de plus en plus inhumaines, le lendemain il cherche tous les moyens d'en éviter l'explosion. Il y a en revanche un objectif duquel M. Perben ne dévie pas : c'est ce qu'il faut bien appeler la reprise en main de la justice. L'affaire d'Albertville est à cet égard emblématique : alors qu'une juge d'instruction mène une enquête importante sur une affaire grave de pollution, et sans qu'aucun incident de procédure ne puisse lui être imputé, on apprend que le procureur de la République, « conseillé » selon ses propres dires par la chancellerie, tente d'obtenir le dessaisissement de sa collègue pour, selon l'expression consacrée, «dépayser» de dossier. Et l'on apprend que cette tentative a lieu précisément au moment où est évoquée l'éventualité d'une mise en examen, dans ce dossier, de plusieurs personnalités appartenant à la famille politique de M. Perben. Devant le refus courageux de la juge d'instruction, le procureur, toujours inspiré par la chancellerie, fait appel devant la Cour de cassation, qui va trancher dans les prochains jours. Cette affaire rappelle la déstabilisation qu'a tentée il y a quelques mois la chancellerie envers le procureur de Montgolfier, qui mène à Nice une action courageuse contre la corruption, et ces agissements nous ramènent, comme par un grand bond en arrière, aux décennies passées. Si les interventions directes du pouvoir politique dans les affaires dites sensibles ont longtemps défrayé la chronique, on pouvait en effet croire révolue l'époque des dossiers construits ou tronqués, démembrés ou dispersés, retardés ou accélérés. Il n'en est rien. S'inspirant des pires méthodes du gaullo-pompidolisme avec Jean Foyer, du giscardisme avec Alain Peyrefitte ou du chiraquisme avec Jacques Toubon, M. Perben rêve en fait d'un retour à une justice aux ordres et il ne recule devant rien pour y parvenir : nomination des magistrats contre l'avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), mise à l'index d'intervenants à l'Ecole nationale de la magistrature, nomination aux plus hauts postes de la hiérarchie judiciaire de «juges de proximité» (au sens bien sûr de leur proximité avec le pouvoir...), nomination au CSM de son propre directeur adjoint de cabinet, remise en cause du premier jugement dans l'affaire du financement du RPR, ou encore instauration de primes au mérite pour les magistrats permettant tous les favoritismes. Cette «innovation», à elle seule, mérite l'attention : pouvant représenter jusqu'à 15 % du traitement brut, la prime est censée récompenser les mérites de certains magistrats. Dans la pratique, pour gratifier un magistrat en lui attribuant un taux supérieur à la moyenne de 8 %, il faut que l'un de ses collègues reçoive moins. Mais comment évaluer et comparer, en toute transparence, le travail des magistrats au sein d'un même tribunal, sans critères objectifs ? Et comment éviter alors que ces primes soient détournées pour devenir une arme disciplinaire ? Une seule certitude : ce système exacerbe le malaise des tribunaux, déjà sous pression faute de moyens, et de nombreux magistrats ont ainsi rendu le montant de leur prime au premier président de leur cour d'appel. En fait, M. Perben n'en finit pas d'essayer de caporaliser la magistrature, à commencer par le parquet, auquel il accorde parallèlement, et en toute logique, des compétences accrues et quasi juridictionnelles. La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en est un exemple saisissant et alors que la Cour de cassation vient, après le Conseil constitutionnel, de remettre à son tour en cause cette procédure dite du plaider-coupable, que fait le garde des Sceaux ? Il s'empresse d'adresser une note à «ses» procureurs leur enjoignant de continuer à l'appliquer comme si de rien n'était... Ces manipulations sont à l'opposé du souhait des Français d'avoir une justice impartiale et indépendante. Il faut donc en finir avec cette conception d'un autre âge, celle d'une justice soumise et obéissante, dure avec les plus faibles mais faible devant les puissants, souvent conciliante avec le pouvoir mais toujours implacable avec ses opposants. Les premiers à rejeter ces pratiques sont au demeurant les magistrats eux-mêmes, qui pour la plupart, et notamment parmi les nouvelles générations, ne conçoivent pas d'exercer leur profession autrement qu'en toute indépendance. Alors pour lever le doute qui entache la justice, pour mettre un terme à la suspicion qui ronge l'autorité judiciaire, faut-il aller jusqu'à supprimer le principe hiérarchique entre la chancellerie et le parquet ? Sûrement pas ! Il suffit de se reporter à la pratique du gouvernement précédent. Dès juin 1997, en effet, Lionel Jospin avait fixé le cap : plus d'intervention politique dans les affaires judiciaires de nature à dévier le cours de la justice. Et ce cap, Elisabeth Guigou puis Marilyse Lebranchu l'ont tenu pendant cinq ans. A quoi il faut ajouter que, durant cette période, tous les magistrats, y compris ceux du parquet, et même les procureurs généraux, furent nommés après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. De 1997 à 2002, l'indépendance de la justice fut ainsi une réalité et pour autant, contrairement aux prédictions alarmismes sur la fin de l'action publique, la justice a fonctionné. Pour inscrire sa pratique dans la loi, le gouvernement précédent avait même initié une réforme qui donnait au garde des Sceaux la responsabilité de définir la politique judiciaire par des directives générales aux parquets dont ils devaient lui rendre compte pour que celui-ci puisse à son tour en rendre compte annuellement au Parlement. Cette réforme dite chancellerie-parquet, qui fut bloquée par le président de la République, prévoyait même qu'en cas de circonstances exceptionnelles le ministre disposerait d'un droit d'action propre pour déclencher l'action publique. Le jour venu, il nous faudra remettre cet ouvrage sur le métier parlementaire pour inscrire l'indépendance de la justice dans le marbre de la loi. Mais avec un corollaire : la responsabilité des magistrats. Aucune institution ne saurait effectivement être au-dessus de tout contrôle, et les juges, eux aussi, doivent rendre des comptes. A cet égard, on ne sait pas assez que la réforme ajournée en 2000 à cause de la droite prévoyait aussi de responsabiliser les magistrats : motivation des classements sans suite, possibilité de recours contre ces classements, comptes rendus publics par les procureurs de l'application dans leur ressort des directives pénales du garde des Sceaux, commission d'examen des réclamations des justiciables lésés par le comportement fautif d'un magistrat pouvant donner lieu à une saisine du Conseil supérieur de la magistrature, audiences publiques d'un Conseil supérieur de la magistrature modifié pour éviter les tentations corporatistes. Ces propositions, loin de marquer une défiance envers les magistrats, sont au contraire la reconnaissance de leur rôle croissant dans la société et de leur responsabilité accrue. En démocratie, le pouvoir ne saurait procéder que du suffrage universel : si la magistrature a des pouvoirs, elle n'est donc pas un pouvoir, et s'ils sont gardiens du droit, les juges doivent en être les serviteurs. Chargés d'une mission de service public parmi les plus nobles, ils peuvent donc être appelés, en cas de faute, à répondre devant celui au nom de qui ils rendent la justice : le peuple français. |