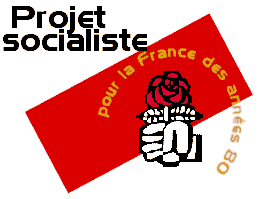| | Pendant trente ans, le capitalisme a connu une prospérité sans précédent. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire de la grande crise des années trente, la capitalisme disposait d'un nouveau modèle d'accumulation concentrant, dans les mains de l'État et de quelques grands groupes, l'essentiel du pouvoir économique. L'ampleur des destructions et donc de la reconstruction à opérer, le coup de fouet donné par la guerre au progrès technique, avaient créé des conditions favaorables à une nouvelle période d'expansion.
L'intensification de l'exploitation (allongement de la durée du travail, en France surtout, progrès du taylorisme et, par conséquent, de la proportion des travailleurs non qualifiés, accélération des cadences, travail posté) s'était accompagnée du recours parallèle à des réserves de main-d'œuvre jusque-là peu ou mal utilisées (femmes, exode rural, réfugiés, travailleurs immigrés).
Mais une des caractéristiques de la croissance capitaliste de 1945 à 1974 avait été l'augmentation de ce qu'il est convenu d'appeler la plus-value relative, grâce à la croissance de la productivité et à la baisse des coûts de revient, tout particulièrement dans le domaine de l'agriculture et des biens de consommation courante.
A ce dernier mécanisme il faudrait rattacher, outre le travail domestique, le gaspillage des ressources naturelles, la destruction de l'environnement et, surtout, le pillage du Tiers Monde à travers les bas prix des matières premières, l'échange inégal et l'importation d'une main-d'œuvre immigrée au coût particulièrement faible.
Enfin, la croissance du capitalisme s'est aussi traduite par l'extension de la sphère de la marchandise à tous les rapports sociaux (éducation, santé, culture) et à des éléments du patrimoine naturel (eau, soleil, air, mer, neige) lorsqu'il devient possible d'y produire du profit.
Les premiers signes de grippage apparaissent à la fin des années soixante aux États-Unis, avec le développement de l'inflation et les premières convulsions du système monétaire international. La crise éclate avec la suspension de la convertibilité-or du dollar en 1971, l'envol de l'inflation au sein du monde capitaliste, l'augmentation du prix du pétrole fin 1973 et enfin la récession généralisée des économies occidentales en 1974-1975, dont nous ne sommes pas encore sortis cinq ans plus tard.
Comme les précédentes, cette crise est une crise du profit. La baisse du taux de profit est une tendance fondamentale du capitalisme, liée au processus même de l'accumulation. Longtemps il contrecarre victorieusement cette tendance. Mais périodiquement, celle-ci finit par l'emporter ; c'est alors la crise. Délaissant peu à peu les secteurs traditionnels, la machine, pour ne pas s'arrêter, doit trouver à travers de nouvelles formes et de nouveaux champs d'exploitation, de nouvelles sources de profit. La crise actuelle trouve son origine dans l'épuisement des gains de productivité et des réserves de " plus-value relative ", dans la résistance accrue de la classe ouvrière (en France, en Grande-Bretagne et en Italie notamment), dans la volonté des pays du Tiers Monde ayant accédé à l'indépendance politique de mettre un terme au pillage de leurs richesses et, enfin, dans l'exacerbation de la concurrence entre les principaux pays capitalistes (U.S.A - Europe - Japon).
Les économistes bourgeois eux-mêmes invoquent les limites internes de la croissance : le ralentissement du progrès de la productivité lié au poids accru dans le produit national du secteur des services - où ce progrès est particulièrement faible - ou encore les rendements décroissants de certaines technologies du fait du coût de la recherche ou de l'allongement des délais nécessaires à l'innovation ou encore du fait des oppositions à son développement (mouvements de technophobie).
Ces explications restent cependant à la surface des choses. c'est dans la logique d'ensemble du système lui-même qu'il faut chercher l'explication d'un grippage dont toute l'histoire du capitalisme nous apprend qu'il procède de sa nature même.
Le capitalisme, en effet, ne peut reculer ses difficultés sans s'en créer de nouvelles, moins solubles encore que les précédentes : pour maintenir ses profits, le capitalisme américain avait exporté pendant vingt ans ses capitaux dans le monde entier, donnant son plein essor au phénomènes des sociétés multinationales. Le déséquilibre de la balance des paiements américaine allait à la longue déterminer la crise du dollar et enfin l'abandon du système des parités fixes, au profit d'un système à taux de change et capitaux flottants, livré à la spéculation.
Pendant un long moment, l'inflation dans les pays industriels avait pu servir de mode d'ajustement ; la hausse des prix permettait de corriger le rapport profits/salaires en faveur des premiers. Face à la résistance des travailleurs puis, à partir de 1971, à celle des pays producteurs de pétrole, cette stratégie allait provoquer un emballement inflationniste de plus en plus incontrôlable.
L'augmentation des prix du pétrole pouvait paraître en 1973 un bon moyen pour les États-Unis concurrencés par l'Europe et le Japon pour restaurer leur suprématie. Mais le déséquilibre ainsi créé dans leurs balances des paiements allait entraîner ces pays dans la récession et faire surgir de nouveaux problèmes. Loin que les contradictions entre pays capitalistes aient aujourd'hui été surmontées, le fossé s'est creusé entre les pays qui sortent relativement renforcés de la crise et ceux qui s'y enfoncent, tandis qu'une rivalité de moins en moins feutrée s'installe entre les trois principaux centres du capitalisme mondial (U.S.A. - R.F.A. - Japon).
Dans ce contexte, les politiques de régulation mises en œuvre par les différents États nationaux s'avèrent de moins en moins efficaces. Ainsi la relance opérée en France en 1975-1976 a débouché... sur le plan Barre... qui, trois ans après, n'a résolu aucun des problèmes fondamentaux de l'économie française.
La crise actuelle se caractérise par une interpénétration, plus étroite que jamais dans le passé, entre l'économique et le politique. Les principales variables de la crise, qu'elles touchent au système monétaire international, à l'endettement des pays du Tiers Monde, au prix des matières premières, aux conditions de l'échange international, à la mise en œuvre de technologies nouvelles, à la consommation d'énergie ou à la concertation des actions de relance entre les différents pays, sont devenues des questions de politique internationale soumises, en dernier ressort, à l'arbitrage des États-Unis.
L'enjeu de la crise pour le capitalisme est donc à la fois le rétablissement de son taux de profit et l'instauration d'un mode de régulation politique stable à l'échelle mondiale.
Le capitalisme cherche une solution à sa crise, dans la généralisation du chômage pour peser sur les salaires, dans la fermeture de capacités de production pour relever les prix et enfin, à plus long terme, dans l'utilisation de nouvelles technologies et dans la conquête de nouveaux espaces. La restructuration de l'économie mondiale s'opère ainsi sous l'action des grands groupes multinationaux qui maîtrisent les nouvelles technologies, déplacent les lieux de production vers les pays où la main-d'œuvre est peu coûteuse et le système fiscal bienveillant, et étendent leurs débouchés en ouvrant, comme au Moyen-Orient, de nouveaux marchés.
Les sociétés multinationales apparaissent ainsi à la fois comme les principaux agents et bénéficiaires de la crise, comme en témoigne l'essor de leurs profits.
Parallèlement, malgré la détérioration de leur position relative et la naissance de pôles rivaux qui tendent à assouplir la cohésion du bloc occidental, les États-Unis ont su, pour l'essentiel, maintenir les moyens de leur domination. Non seulement en effet, la plupart des sociétés multinationales sont des sociétés à capitaux américains, mais les États-Unis disposent de ressources naturelles immenses que valorise la hausse du prix des matières premières. Surtout, ils continuent à bénéficier de l'exorbitant privilège du dollar, apanage du " prince " qui peut, seul, battre monnaie pour le reste du monde. Aussi bien les pétrodollars sont-ils recyclés dans leurs banques. Enfin, l'Amérique dispose d'une puissance militaire qui fait toujours d'elle, en dernier ressort, le gendarme du monde capitaliste.
Le Japon et, dans une moindre mesure, l'Allemagne ont pu limiter les conséquences de la crise sur leur économie, grâce à la structure concentrée et moderne de leur capitalisme. L'amorce d'une multipolarisation du monde capitaliste se dessine qui n'exclut d'ailleurs nullement la conscience d'une solidarité générale d'intérêts.
En dehors des pays du Tiers Monde, pauvres en matières premières, ce sont en définitive les pays européens (en dehors de l'Allemagne) qui apparaissent comme les plus touchés par la crise.
Frappés par la crise du pétrole, déstabilisés par la stratégie des multinationales, ils sont aux prises avec une triple confrontation :
- une attaque commercial sans précédent de firmes américaines, japonaises et même des pays de l'Est ;
- des transferts d'activités de la part des multinationales dont certaines se désengagent des pays européens où les coûts de la main-d'œuvre tendent à rejoindre les coûts américains pour s'installer dans les pays où la main-d'œuvre peut être exploitée sans vergogne et où les avantages fiscaux et financiers sont importants ;
- enfin, la pression commerciale, industrielle et politique croissante des États-Unis, le seul de tous les pays industrialisés à ne pas être soumis à la contrainte de la balance des paiements, et à avoir pu ainsi poursuivre, depuis 1975, une politique de croissance et de création d'emplois.
Les États-Unis aspirent à trouver dans les pays européens des relais dociles de leur politique. D'où diverses formes de pressions comme la menace du désengagement militaire, la baisse délibérée du dollar ou encore la monopolisation des industries de pointe.
L'approfondissement de la crise se traduit ainsi simultanément par des transferts d'activités et par des transferts de pouvoir au niveau régional ou mondial. Tout d'abord par la mise en place d'une nouvelle division internationale du travail à travers le développement des sociétés multinationales. Et ensuite, par la réorganisation et le renforcement de l'hégémonie des États-Unis sur l'ensemble du monde industrialisé. Ayant tiré les leçons de la période historique écoulée (guerre froide et interventions directes dans le Tiers Monde, notamment au Vietnam), les États-Unis ont mis sur pied une stratégie beaucoup plus " économique " et probablement plus efficace de contrôle politique et idéologique à l'échelle mondiale.
De leur défaite au Vietnam ils ont fait la base de leur politique de coexistence, voire d'alliance, avec Pékin. Ils disposent ainsi d'un moyen de pression de première importance sur l'Union soviétique.
Plutôt que d'intervenir directement, par l'envoi massif de troupes, sur tous les continents et notamment dans le Tiers Monde, ils préfèrent reconquérir certains pays de l'intérieur et s'appuyer sur une hiérarchie d'États ou d'organisations-relais ; il est plus facile, en effet, de régler les problèmes à travers certaines organisations de type régional (O.T.A.N., O.E.A.-A.S.E.A.N., etc.) ou l'activité de certaines puissances ayant une " responsabilité particulière " dans des zones déterminées (Japon et Indonésie dans le Sud-Est asiatique, Brésil en Amérique latine, Egypte et Arabie Séoudite au Moyent-Orient, France en Afrique et en Méditerranée, Allemagne en Europe du Sud, etc.), qu'en faisant donner un corps expéditionnaire dont il convient cependant d'agiter la menace. Le gendarme demeure, mais la conception de son rôle a changé : davantage gendarme économique et toujours gendarme militaire mais, cette fois, à travers une force d'intervention appuyée essentiellement sur la marine (porte-avions) et les parachutistes.
Enfin, dans le monde industriel développé, il s'agit de s'assurer, comme le recommande d'ailleurs la Commission " trilatérale ", que les politiques européennes ou japonaises ne divergeront pas substantiellement d'avec les orientations de la politique américaine, quitte à instaurer progressivement, à travers un contrôle social de plus en plus sophistiqué, un nouvel ordre intérieur.
Reste qu'on ne peut passer sous silence les contradictions entre pays capitalistes, ni les obstacles que représentent encore les États-nations, ou le libre jeu de la démocratie à, l'homogénéisation culturelle, idéologique et politique du monde occidental.
|