La France en 2005
un diagnostic
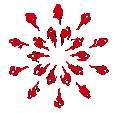
La France en 2005 |
|
IV. Et maintenant ? | |
Notre diagnostic sur la France montre l’urgence de renouer avec une ambition collective pour préparer l’avenir. Il est temps d’en finir avec une société qui installe la défiance et la crainte des uns vis-à-vis des autres pour une société qui donnera toutes ses chances à chacun tout au long de la vie. Une société juste doit lutter contre la marchandisation érigée en règle qui veut tout distribuer par le marché même les biens publics les plus essentiels, l’éducation, la santé, l’environnement, la sécurité. La qualité des relations individuelles et collectives en dépend. Sinon, comme nous en voyons, malheureusement, des manifestations, la loi du plus fort l’emporterait avec son cortège d’injustices et de violences. Notre société a besoin de retrouver du sens. Elle ne le fera pas dans le seul culte de la consommation qui crée autant et plus de frustrations que de contentements. Il y a une attente pour une ambition collective généreuse. C’est le moyen pour dépasser le 21 avril, trouver l’accord de toutes celles et de tous ceux qui agissent solidairement dans notre société, contrer les dérives du libéralisme financier dans notre pays, en Europe et dans le monde. Cette perspective est possible. D’autres pays en Europe du Nord sous l’influence des sociaux-démocrates, tentent de le faire aujourd’hui, sachant allier dynamique économique et innovation avec la solidarité et la sécurité pour tous. Attachés à la liberté des individus nous le sommes tout autant à l’égalité dans les actes. De notre histoire, en cette année du Centenaire de notre parti, nous avons appris avec Jean Jaurès, l’importance de la République, qui donne la priorité à l’éducation et à la laïcité, avec Léon Blum, celle des libertés, des droits de la personne et d’une démocratie vivante, avec Pierre Mendès-France, celle de la production et de la redistribution des richesses, qui définissent un réformisme conséquent, avec François Mitterrand, celle des réformes qui font avancer la société et de la perspective européenne dans laquelle s’inscrit notre avenir. Nous n’avons donc pas à nous interroger sur nos valeurs mais à les mettre en œuvre dans un monde et une société qui ont changé. La France de 2005 n’est déjà plus celle de 1997 ! Elle est certes reconnaissable…Mais le diagnostic auquel nous avons procédé montre que les problèmes français aujourd’hui appellent une réponse politique aussi nouvelle que forte. Il ne peut s’agir, en effet, d’appliquer mécaniquement les «recettes» d’hier, il ne peut pas s’agir non plus d’accompagner seulement mieux que la droite les évolutions économiques, sociales, culturelles, politiques du monde tel qu’il est. Pour ce faire, la volonté collective et les politiques publiques sont plus que jamais nécessaires. Certes, les échelles d’intervention sont nombreuses, du local au mondial, et l’action publique ne peut être vraiment efficace sans la responsabilité des citoyens et celle du mouvement social, mais les exigences demeurent : la régulation de l’économie de marché, la production de richesses et leur juste redistribution, la fourniture de biens et de services publics, la préparation de l’avenir, la participation des citoyens,etc. C’est à partir d’elles qu’il nous faut construire pour les Français et pour la France. Nous devons porter un projet authentiquement réformiste pour changer de société. Il ne sert à rien, en effet, de se laisser aller à une rhétorique ambiguë : les socialistes ne proposent pas une «rupture» avec l’économie de marché ou une sortie de la mondialisation. La pratique l’a démontré, le discours doit désormais l’assumer. La révolte légitime provoquée par les dégâts sociaux de la mondialisation libérale ne justifie pas une régression idéologique vers une posture seulement protestataire qui ne permet pas de construire les réformes nécessaires. Dénoncer sans agir, c’est en quelque sorte accepter l’impuissance, renoncer au volontarisme, et donc à la politique. Notre réflexion et nos politiques doivent porter sur la manière de surmonter les défaillances graves du marché, lequel privilégie le court terme, ne connaît que la demande solvable et distribue inégalement les richesses. Notre fil rouge dans ce projet doit être le combat pour l’égalité qui doit s’imposer comme la priorité politique de notre agenda. Pour nous socialistes, il n’y a pas de liberté sans égalité. Et le succès demandera, nous le savons, des efforts considérables. Quelques conclusions peuvent et doivent être tirées de notre réflexion. Elles fournissent en quelque sorte un cahier des charges pour la suite de notre travail. Une première exigence s’impose: la rénovation profonde de notre démocratie. Nous savons bien que l’érosion des valeurs traduit toujours un malaise social. Mais il n’empêche. Pour changer de politiques, il faudra changer la politique. Cela passe par une réforme profonde des institutions, celle de l’Etat, mais aussi de notre organisation territoriale, du renouvellement des mandats, des modes de scrutin et par un changement des règles de notre démocratie sociale pour mieux fonder la représentativité de ses acteurs et leur donner les moyens d’exercer leurs responsabilités. Mais cela demande surtout une mise en mouvement de la société en luttant contre le désintérêt, la désillusion, l’éloignement des pratiques démocratiques, qu’elles soient politiques ou sociales. La seconde exigence sera d’accroître l’influence de la France en Europe, de l’Europe dans le monde. Politique extérieure et politique intérieure sont désormais étroitement liées. Peser sur le cours de la mondialisation demande de mettre l’action de notre pays d’abord au service d’une Europe forte, capable d’assurer un partenariat équilibré avec les Etats-Unis, de défendre une approche multilatérale des problèmes du monde, de proposer avec d’autres pays et les ONG, dans le cadre de l’ONU et des institutions multilatérales des solutions aux problèmes criants d’aujourd’hui, la paix, le développement, le respect des équilibres écologiques. La dernière exigence, c’est de penser et de mettre en œuvre ensemble la production des richesses et une redistribution permettant de combattre les inégalités à la racine. De la croissance, en effet, dépend largement le financement de la solidarité au sens le plus large du terme. De l’existence de cette solidarité, que cela soit dans l’école, dans le logement, dans le travail, dans la maladie, etc. dépend le «vivre ensemble» dans les droits et les devoirs d’une République profondément rénovée. Il y a là un «cercle vertueux» qui doit commander notre projet et notre manière de poser les problèmes en voyant comment ils sont liés entre eux. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, la mise en œuvre d’une réforme du système fiscal, souvent annoncée, rarement tenue, n’a des chances que si elle affiche nettement ses objectifs pour la mettre au service de la production et de la redistribution. A partir de là se détachent cinq chantiers majeurs où nous devrons faire avancer concrètement l’égalité en luttant dans chacun d’entre eux contre les discriminations quelle que soit leur nature, qu’elles tiennent à l’origine, au sexe, au handicap, etc. 1) L’éducation et la formation pour faire entrer pleinement la France dans une société de la connaissance ; 2) La préparation de l’avenir par la recherche, l’innovation, la culture ; 3) Le travail et l’emploi pour garantir la sécurité et la réussite de tous ; 4) Le logement et l’organisation des territoires urbains comme ruraux pour offrir à chacun la qualité de vie à laquelle il a droit ; 5) Un développement durable pour préserver nos ressources et notre environnement. Il est évident que toutes nos politiques nationales auront besoin d’être insérées dans un
combat permanent pour une Europe plus politique et plus sociale. Ce que nous demande avant tout les Français, c’est d’affirmer une vision : un combat pour l’égalité des chances entre les individus, les territoires, les nations. Pour ce faire, nous avons naturellement besoin du service public et de l’Etat. La protection des plus faibles ou des plus démunis, la réduction des injustices, la lutte pour l’égalité d’accès à des fonctions essentielles, supposent un service public, efficace et performant, capable d’évoluer pour améliorer la prestation rendue aux citoyens. La mondialisation ne doit pas servir d’alibi pour réduire le service public, son rôle et ses missions, elle les justifie au contraire. Il ne s’agit pas, dans notre esprit, d’une défense de structures en place. La modernisation, la démocratisation, des services publics, la recherche de leur plus grande efficience, sont, non seulement indispensables, mais urgentes. C’est le mouvement qui fait la légitimité de l’Etat. Le service public ne représente pas simplement un clivage traditionnel entre la gauche et la droite. C’est un enjeu décisif pour la démocratie, tout simplement. C’est lui qui permet l’accès au droit de tous les citoyens, à travers les territoires. C’est parce que nous réussissons à mettre l’égalité dans la réalité que nous pouvons demander à nos concitoyens de respecter les règles, de respecter les autres, d’être solidaires. Notre action doit être en même temps animée par l’écoute, le dialogue permanent, la volonté de faire vivre la citoyenneté sous tous ses formes. Contre ceux qui prétendent la France « in-réformable », nous devons dresser la perspective d‘un pays capable de se retrouver, au-delà de l’émiettement, de la fragmentation et de l’individualisme, autour d’un projet collectif, négocié, discuté, accepté, un projet renouant avec la belle idée des Lumières, d’une maîtrise possible d’un destin collectif, un projet donnant la confiance dans la démocratie, un projet s’inscrivant sans réticence dans un avenir européen. La démarche du Parti socialiste n’est pas simplement de construire un programme de plus : nous en avons fait beaucoup dans le passé; ils ne produisent pas toujours la mobilisation attendue. Nous souhaitons aujourd’hui construire une stratégie de longue durée, fixant l’objectif que nous voulons atteindre pour les dix années prochaines. Nous souhaitons ainsi donner le cap, la direction, la perspective qui inspirera notre action lorsque de nouveau nous exercerons des responsabilités. Le travail qu’il nous faut maintenant mener ensemble sera inspiré par deux principes: reconnaître la vérité et faire preuve de volonté. Reconnaître la vérité, cela n’est pas simplement appréhender le réel, faire la somme des contraintes, recenser les rigidités. C’est aussi voir toutes les aspirations, toutes les ressources, toutes les possibilités, toutes les marges de manœuvre pour une politique de changement. La vérité c’est aussi d’assumer la cohérence: cohérence entre ce qu’on dit dans l’opposition, ce que l’on a fait au pouvoir et ce qu’on sera prêt à faire demain. La cohérence entre le discours et les actes, la cohérence entre l’idéologie affichée et la pratique qui en découle. C’est pourquoi le premier mouvement doit être celui de la vérité. La volonté politique, ensuite. Cette volonté qui consiste à affirmer et décider de ce que nous pouvons changer en un temps donné, et aussi à ne pas dissimuler ce que nous ne pouvons pas changer. C’est pourquoi la notion de projet est essentielle, l’inscription dans la durée est indispensable. La volonté politique, c’est aussi de considérer que le projet doit se construire en commun, à travers le dialogue, la concertation. Nous voulons prouver qu’il y a des façons de penser en commun autant que des façons d’agir en commun. Sur la base de ce texte d’orientation, la réflexion et le débat doivent continuer dans le parti et avec les Français, pour que nous précisions et enrichissions ce texte en vue de l’écriture finale du projet, et, surtout, que nous en déduisions nos principales propositions qui seront au cœur de nos débats dans les mois à venir. | |
 |
[Les élections] [Les documents] [Les entretiens] [Rechercher] [Contacter] [Liens] | |
| ||