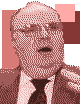Henri, | |
De la discussion jaillit, peu à peu, la lumière. En juillet dernier, Henri Emmanuelli, attribuait à la « dérive sociale-libérale » du gouvernement de Lionel Jospin la raison principale de la défaite du 21 avril. Mais, s'avisant, sans doute dans la torpeur de l'été, qu'il avait lui-même porté une appréciation flatteuse sur la politique de ce gouvernement en 2000, notre camarade nous propose aujourd'hui une analyse plus subtile. Au congrès du PS à Grenoble, Henri Emmanuelli qualifiait d'exceptionnels les résultats de l'action gouvernementale et déclarait : « Le retour à la croissance et à l'emploi ne s'est pas fait au détriment de la protection sociale et d'une extension de la solidarité, n'en déplaise aux libéraux et aux promoteurs de la troisième voie et du nouveau centre. La main invisible du marché n'a pas rendu obsolète le volontarisme politique. Cette réhabilitation de la politique nous la devons à Lionel Jospin et à son gouvernement. » En réalité confie-t-il dans un entretien à Libération du 13 septembre, la précédente législature se divise en deux périodes, une bonne jusqu'en décembre 2000... , et une mauvaise de janvier 2001 à avril 2002. « La première période incontestablement réformiste, autorisait Lionel Jospin à dire que son gouvernement était le plus à gauche d'Europe », concède-t-il désormais. Dans la seconde, au contraire « les réformes se sont arrêtées, nous sommes entrés dans une période gestionnaire à dominante sociale-libérale ». On ne peut que saluer cette première rectification. En quelques semaines, ce sont les trois premières années de la législature de Lionel Jospin qui se trouvent ainsi réhabilitées. On peut raisonnablement espérer que, d'ici peu, cette réévaluation s'étendra aux deux années suivantes. La bipartition que nous propose Henri Emmanuelli se heurte en effet à trois réalités qui lui ôtent beaucoup de sa pertinence. Tout d'abord il n'est pas exact de dire que « les réformes se sont arrêtées » à partir de l'année 2000. Il y a eu l'allocation personnalisée autonomie (APA en juillet 2001), le fonds de réserve des retraites (en juillet 2001), la loi de modernisation sociale (en janvier 2002), celle sur la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique (en janvier 2002), l'institution de la nouvelle constitution budgétaire, la prime pour l'emploi, la loi sur la présomption d'innocence, le passage au quinquennat... et bien d'autres. On peut discuter la pertinence ou l'opportunité de certaines de ces réformes, on ne doit nier ni leur réalité ni leur ampleur. D'autres s'en chargent, auxquels au contraire il convient de répondre. En second lieu, les grandes réformes initiées entre 1997 et 2000 n'ont pas été arrêtées en 2001 et 2002, mais au contraire poursuivies et confortées : les 35 heures ont été étendues à la fonction publique, la couverture maladie universelle (CMU) a été complétée, le budget de 2002 a confirmé les priorités gouvernementales définies en 1997 : emploi, éducation, justice, recherche, culture, environnement. Bien sûr, il y a eu l'arrivée de Laurent Fabius, Jack Lang, Bernard Kouchner, Jean-Luc Mélenchon, Marie-Noëlle Lienemann au gouvernement. Mais est-ce un événement suffisant pour casser en deux l'histoire de la législature ? La périodisation proposée aujourd'hui par Henri Emmanuelli est d'autant plus cocasse, que la plupart des mesures qu'il dénonce à tort comme emblématique du « social-libéralisme » ont été prises dans la première période (1997-2000), celle qui précisément trouve grâce à ses yeux. Il en est ainsi, par exemple, de l'ouverture du capital de France Télécom (1997) et d'Air France (1999) ; de la privatisation de l'Aérospatiale et de Thomson Multimédias ; des baisses d'impôt, de la réforme de l'assurance vie et des plans d'épargne en actions (décembre 1999)... Chacune de ces mesures peut être discutée, mais aucune ne met en cause les priorités qui engageaient le gouvernement devant les électeurs. Plutôt que se livrer à des périodisations fantaisistes, mieux vaudrait rechercher des réponses aux causes profondes de notre défaite : la montée de l'insécurité publique, la perte d'autorité de l'État, la persistance d'un chômage élevé, malgré la création de 2 millions d'emplois supplémentaires, le développement de la précarité du travail ; notre difficulté surtout à donner corps à cette « utopie réaliste » sans laquelle les citoyens se replient sur eux-mêmes et sur la défense exclusive de leurs intérêts à court terme. Cette utopie existe pourtant, et se résume en peu de mots : édifier une société du « bien-être », mais aussi du « bien-vivre », c'est-à-dire une société où chacun pourra réaliser les potentialités dont il est porteur, et en particulier les plus hautes : exercer sa liberté, accéder aux œuvres de la culture et de l'esprit, donner libre cours à sa créativité. Promouvoir un nouvel internationalisme, en faisant de l'Union européenne le levier d'une mondialisation équitable et solidaire. C'est ainsi que nous regagnerons la confiance de nos électeurs, et non en dépréciant nous-mêmes la réalité de notre action. | |
Reproduit avec l'aimable autorisation du quotidien ©  |