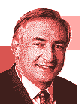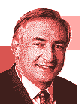| | Vous affirmez que la tendance en faveur de Ségolène Royal s'inverse, que vous êtes désormais en mesure de la battre. Sur quoi vous fondez-vous ?Depuis que les candidatures ont été déposées, début octobre, chaque jour qui passe, la donne change. Il y a un mouvement réel. Je le sens lors de mes déplacements et de mes contacts. Les sondages, qui ne concernent que les sympathisants, ne peuvent prédire le vote des militants. J'ai la conviction qu'il peut y avoir un deuxième tour et que, si tel est le cas, il sera très ouvert. Je ne vois pas la réserve de voix dont pourrait disposer Ségolène Royal.
Et la vôtre ? Qu'est-ce qui pourrait inciter les militants fabiusiens à voter pour vous ?Si nous avons eu des différences sur la question européenne, leur conception de la politique est très proche de la mienne.
Quelle est-elle ?C'est le sens de la responsabilité politique, c'est le rejet d'une démocratie d'opinion. C'est le sentiment qu'il faut construire le combat politique sur des convictions, et la conviction que les problèmes principaux des Français sont des problèmes économiques et sociaux et non des problèmes qui s'organisent principalement autour du rappel à l'ordre.
Plusieurs cadres jospinistes ont réclamé de pouvoir voter blanc lors du scrutin interne. C'est donc que vous n'êtes pas leur candidat naturel…Ce n'est pas ce que je constate sur le terrain – bien au contraire ! Ceux qui ont été déçus que la candidature de Lionel Jospin ne se traduise pas dans les faits ne voteront pas pour Ségolène Royal – d'ailleurs Lionel Jospin s'est lui-même exprimé là-dessus –, ne voteront pas pour Laurent Fabius, et ils voteront quand même, parce qu'aucun socialiste aujourd'hui n'a envie de rester à l'écart du choix qui va être fait pour 2007. Regardez ce qu'a écrit dans vos colonnes Alain Geismar, qui a été un jospiniste " pur et dur ", et qui donne une argumentation imparable : " J'ai vu trop de gens pleurer le 21 avril 2002 pour ne pas faire le choix de la raison. " Et ce choix, c'est : je ne veux pas voter pour l'une, je ne peux voter pour l'autre, donc je voterai pour Dominique Strauss-Kahn.
Ségolène Royal vous a ravi l'image de la modernité. Cela vous irrite-t-il ?Je n'ai jamais cessé de considérer que j'incarnais la modernité ! Pendant un temps, j'ai eu, c'est vrai, une difficulté à faire valoir dans les médias ce que je pensais. Il est vrai aussi que Ségolène Royal incarne quelque chose de neuf. Je partage avec elle le fait de vouloir une rénovation du parti, de la vie politique et du pays. Simplement, nous n'incarnons pas la même modernité.
Qu'est-ce qui vous distingue de vos deux rivaux ?Aujourd'hui, il y a deux stratégies politiques différentes entre lesquelles les adhérents vont devoir choisir – celle de Ségolène Royal et la mienne. D'abord, les priorités. La mienne est économique et sociale : il est vain de chercher à résoudre la crise de la représentation si les Français n'ont pas de réponse à leurs difficultés économiques et sociales. Or elle défend avant tout l'idée de l'ordre, juste dit-elle. Ensuite, la cohérence. La mienne est clairement social-démocrate, fondée sur un ensemble de convictions et ayant l'ambition de proposer une offre politique nouvelle. Je considère l'autre stratégie davantage " attrape-tout " : c'est d'abord une volonté de répondre au coup par coup à des demandes contradictoires de l'opinion. Enfin, la conception de la fonction présidentielle. Je veux un président de la République engagé, qui se batte pour les convictions sur lesquelles il a été élu. Je ne veux pas d'un président attentiste. De ces trois différences, j'en tire une quatrième, décisive pour battre la droite : la priorité économique et sociale, la cohérence des propositions et la présidence engagée, voilà ce qui semble nécessaire pour rétablir la confiance. Je suis pour une société de confiance alors que je vois assez fortement une société de suspicion sur certaines propositions qui ont été faites, comme celle sur les jurys populaires.
Et Laurent Fabius ?Il est volontiers critique à l'égard de la social-démocratie. Il a un programme traditionnel de la gauche française qui s'appuie presque exclusivement sur la décision d'Etat et qui, je le crains, est devenue insuffisante dans le monde d'aujourd'hui.
Que direz-vous aux militants si vous êtes qualifié pour le second tour ?Je les appellerai à voter utile. Voter utile, c'est avoir à l'esprit que la gauche ne peut gagner que si elle montre un autre chemin et que si ce chemin est jugé praticable. Les Français rejettent le libéralisme que proposent la droite et - plus encore - Nicolas Sarkozy, mais ne sont pas encore disposés à voir dans ce que proposent les socialistes un chemin praticable. Si nous ne sommes pas capables de montrer que notre modèle de solidarité peut survivre dans la compétition internationale et qu'il peut aussi apporter à la France la compétitivité nécessaire, alors les Français voteront pour Nicolas Sarkozy. Ma conviction est que seul mon projet d'une société de confiance peut le battre.
Pourquoi avoir combattu les 35 heures face à Martine Aubry alors que vous les aviez préconisées lors de la campagne des législatives de 1997 ?Les 35 heures étaient une réforme nécessaire. Mais, et j'en prends ma part de responsabilité, nous l'avons fait trop largement par la loi, en privilégiant une démarche étatiste. Il aurait fallu plus de négociation. J'en ai tiré les leçons. C'est là qu'interviennent le compromis social et la méthode social-démocrate. L'objectif des 35 heures était juste, la réduction du temps de travail nécessaire, mais nous l'avons conduite trop à l'ancienne.
Vous privilégiez donc la démarche contractuelle. Que reste-t-il au politique ?Beaucoup ! Il y a des domaines où il lui appartient de conduire les réformes. Il y en a d'autres où il doit impulser la négociation et faire en sorte que le rapport de force ne soit pas le même sous la droite ou sous la gauche. Quand je propose le " pacte de l'Elysée ", qui consiste à traiter d'ici à la fin 2007 des grandes questions qui minent la confiance des Français, il s'agit d'une négociation avec les partenaires sociaux où l'Etat est porteur d'un mandat politique, et non pas un arbitre neutre. Il ne s'agit pas seulement de dire que les partenaires sociaux se réunissent et que ce qu'ils décident sera transcrit dans la loi. Il s'agit de peser dans la négociation à partir du mandat politique reçu. Dans le combat dans les entreprises et l'économie de marché, le rôle de la gauche, c'est d'aider les salariés dans la négociation.
Mme Royal dit s'inspirer du modèle nordique. Le vôtre est-il anglo-saxon ?Il nous faut inventer ! Je veux une social-démocratie renouvelée, adaptée au temps de la mondialisation. Cela n'a rien à voir avec le modèle anglo-saxon ni avec le modèle nordique.
Qui, en Europe, a élaboré ce modèle de sociale-démocratie renouvelée ?Personne, et c'est bien pour cela que nos partenaires européens commencent à se tourner vers nous. La proposition du service public de la petite enfance qui a été inscrite dans le projet socialiste au titre de l'égalité réelle, après forte pression de ma part, est une illustration concrète du renouvellement de la social-démocratie. Celle-ci a été fondée sur une pratique de redistribution, certes indispensable, mais dont on voit les limites : cinquante ans après, les inégalités prospèrent toujours. L'idée que la gauche ne peut plus se contenter de constater les inégalités de marché pour les corriger après coup, mais qu'elle doit s'attaquer à la mécanique même de création de ces inégalités pour casser la machine à faire des pauvres, cette idée-là est clairement née ici et irrigue une partie de la réflexion de nos partis frères.
Vous parlez d'une " énorme " machine à redistribuer. Faut-il la faire maigrir ?Non, mais il faut la rendre plus efficace. Je ne dis pas qu'on redistribue trop, je dis que cela ne suffit pas et qu'il faut attaquer les inégalités là où elles se créent. Peut-être que cela permettra, dans dix ans ou quinze ans, d'avoir moins besoin de redistribution. C'est l'espoir qu'on peut former, mais on en est loin.
Vous souhaitez un président qui s'engage et soit responsable. Jusqu'à quel point ?Pour moi, un président engagé n'est pas la vigie du navire, mais le dirige. Ce n'est pas un président ambigu qui couvre à la fois la gauche et la droite. Il est certes le président de tous les Français, mais il a un mandat à remplir. Lorsque sa politique est désavouée massivement, il doit en tirer les conséquences. Il n'y a pas de procédure prévue dans notre Constitution, et je ne préconise pas qu'on en élabore dans l'urgence. Mais si les Français me choisissent pour occuper cette fonction, je serai le président engagé sur le mandat qu'ils m'auront donné. Devant un échec patent, j'en tirerai les conséquences en démissionnant. C'est ce qu'aurait dû faire Jacques Chirac au lendemain du référendum sur l'Europe.
Est-il normal que le président s'engage sur l'adhésion de la Turquie sans avoir le soutien de sa majorité ni de la population ?Le président de la République française se doit d'avoir une position. Il ne peut pas se réfugier derrière la future consultation du peuple français, ne serait-ce que parce qu'il sera amené à signer des documents engageant la France bien avant que le référendum soit à l'ordre du jour.
Doit-il avoir un mandat du Parlement ?Il ne peut pas être lié par un mandat impératif. Il a en revanche un mandat politique que lui ont confié ses électeurs. C'est pourquoi il est indispensable que la campagne permette de dire la vérité sur tous les problèmes auxquels nous serons confrontés.
|